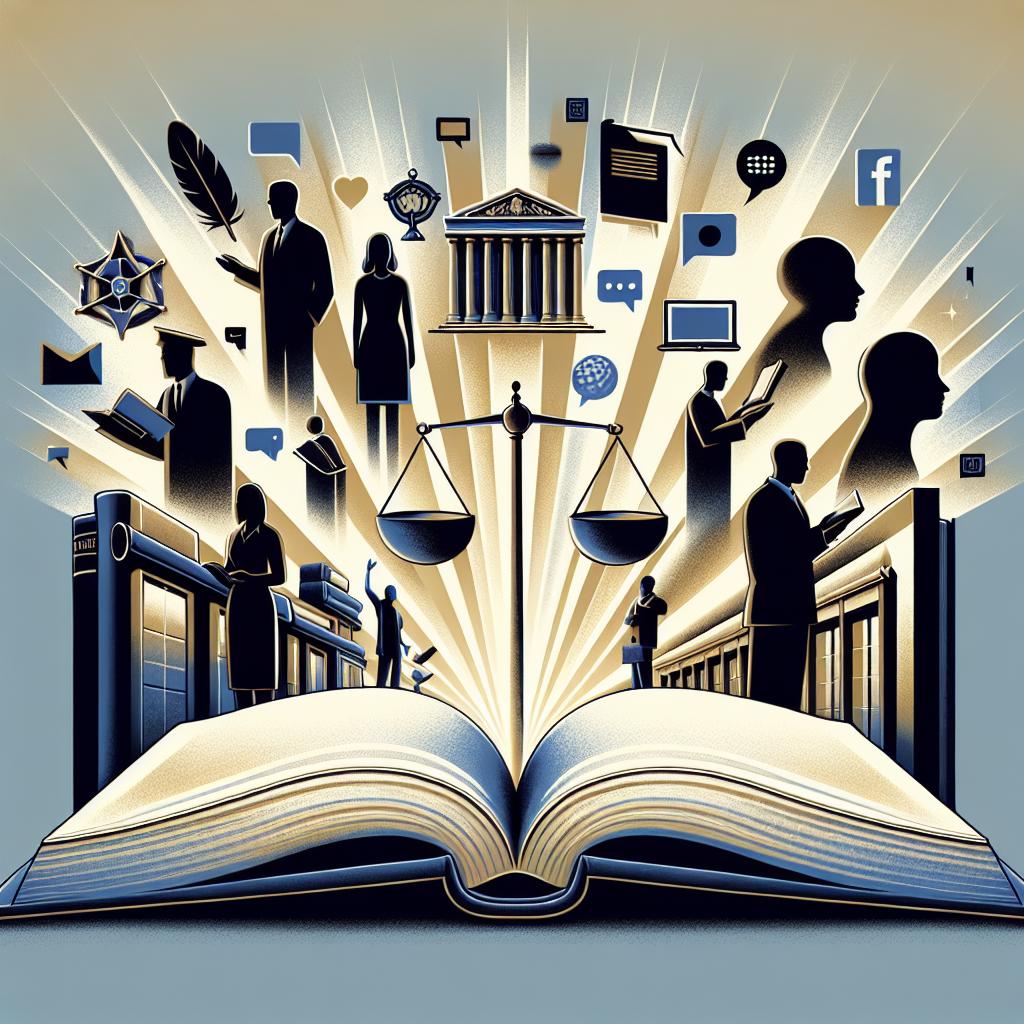Dans un rapport rendu public récemment, la chercheuse et directrice du Centre de recherches internationales Stéphanie Balme appelle à « favoriser, au sein de la société, l’émergence d’une culture partagée, vivante et exigeante de la liberté académique ». Cette proposition figure parmi les dix, sur soixante‑cinq, retenues par France universités, qui affirme ainsi sa volonté de « promouvoir une culture de la liberté académique dans la société ».
Pourquoi la liberté académique est-elle essentielle ?
La liberté académique n’est pas un privilège corporatiste ni la simple revendication d’un corps professionnel en quête de reconnaissance. Elle se conçoit comme un bien commun. Elle sert la démocratie, soutient le progrès scientifique et garantit la qualité de l’enseignement supérieur.
Permettre aux universitaires d’exercer et de transmettre librement leurs connaissances contribue à des débats publics mieux informés. À défaut, la société court le risque de voir s’installer des opinions fondées sur des informations partielles ou sur des contenus erronés. La liberté académique participe donc aussi à la protection des droits et libertés des citoyens.
Si la France entend conserver sa place parmi les puissances scientifiques, la défense de ce principe doit être inscrite parmi ses priorités. La formulation, la portée et les mécanismes de protection restent cependant déterminants pour transformer cet objectif en réalité.
Une liberté qui dépasse les campus
La liberté académique ne se limite pas aux « murs de l’université » ou aux « campus ». Elle rayonne là où se tiennent les débats publics : dans la presse écrite, sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux. Les chercheurs qui prennent la parole « hors les murs » enrichissent le débat dès lors qu’ils respectent la rigueur scientifique apprise au cours de leur formation.
Cette présence publique des universitaires aide le grand public à se forger un jugement éclairé. Elle peut aussi réduire la réception et la propagation d’informations fallacieuses (fake news). Pour que cet apport soit effectif, il faut toutefois que l’exercice de la liberté s’accompagne d’exigences de méthode, de transparence et d’éthique professionnelle.
Les deux faces d’une même médaille
Défendre la liberté académique implique deux démarches complémentaires. La première consiste à expliquer ses finalités et son utilité pour la société. La seconde porte sur la diffusion d’une culture qui lui donne sens et légitimité hors du milieu universitaire.
Cette pédagogie vise à dissiper la perception d’un concept « corporatiste ». Elle permet aussi d’anticiper et de limiter les tentations de remise en cause portées par des gouvernements ou des acteurs aux visées illibérales. Sensibiliser les citoyens et les décideurs contribue à rendre la liberté académique moins fragile face aux pressions politiques ou économiques.
Avant même toute inscription constitutionnelle, une telle vulgarisation paraît donc nécessaire. L’idée d’une constitutionnalisation est jugée souhaitable par certains acteurs, mais elle soulève des enjeux de rédaction. Une formulation inadaptée pourrait réduire l’effet recherché. Elle ne constituerait pas non plus une panacée immédiate pour garantir la pratique quotidienne de la liberté académique.
En pratique, la protection de ce droit demande des dispositifs précis : règles institutionnelles claires, procédures de recours, garanties contre les sanctions abusives et formation à l’éthique de la prise de parole publique. Ces instruments conditionnent l’effectivité d’un principe qui, sans garde‑fous opérationnels, risque de rester formel.
Le rapport évoqué par Stéphanie Balme et les suites données par France universités traduisent une volonté de faire de la liberté académique un objet de politique publique et de culture civique. La mise en œuvre concrète de cette ambition dépendra cependant des choix de traduction juridique, des dispositifs de protection et de la capacité des acteurs à expliquer le sens de cet héritage républicain au plus grand nombre.