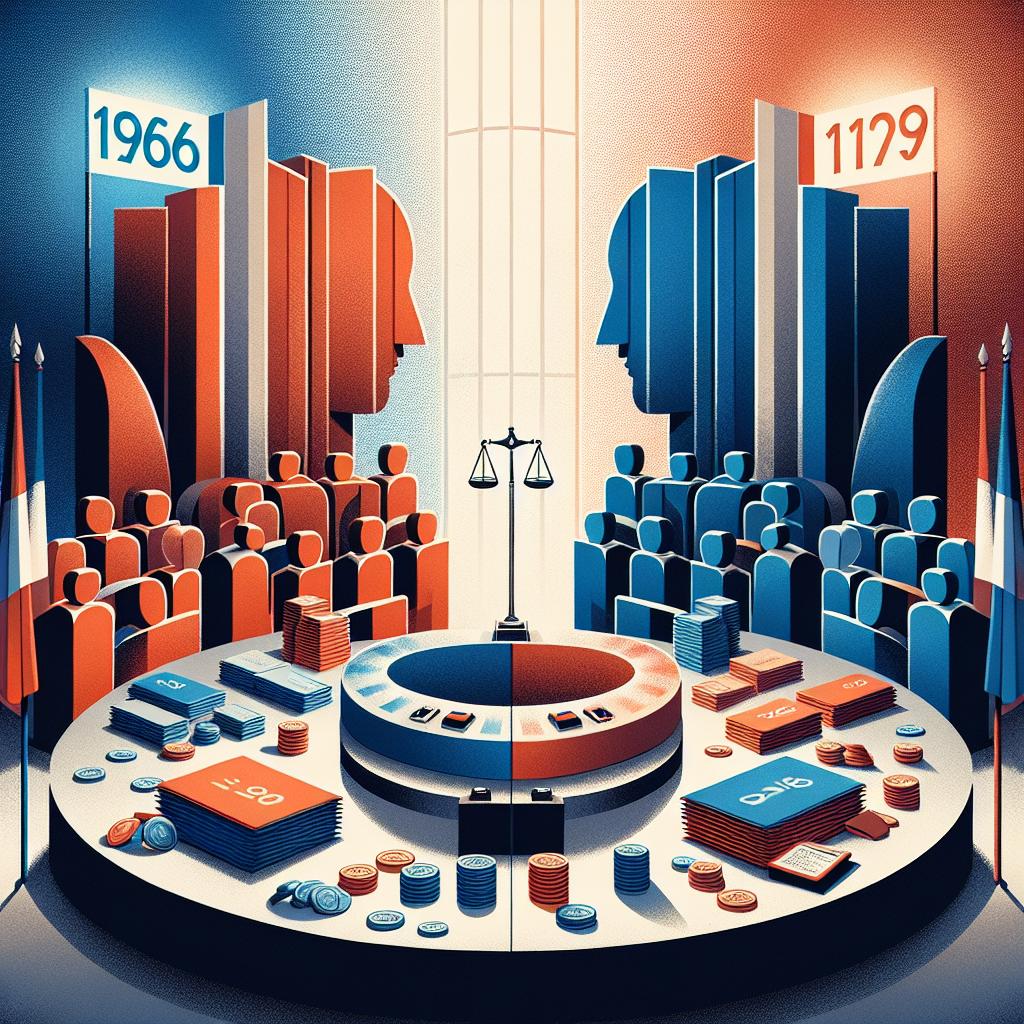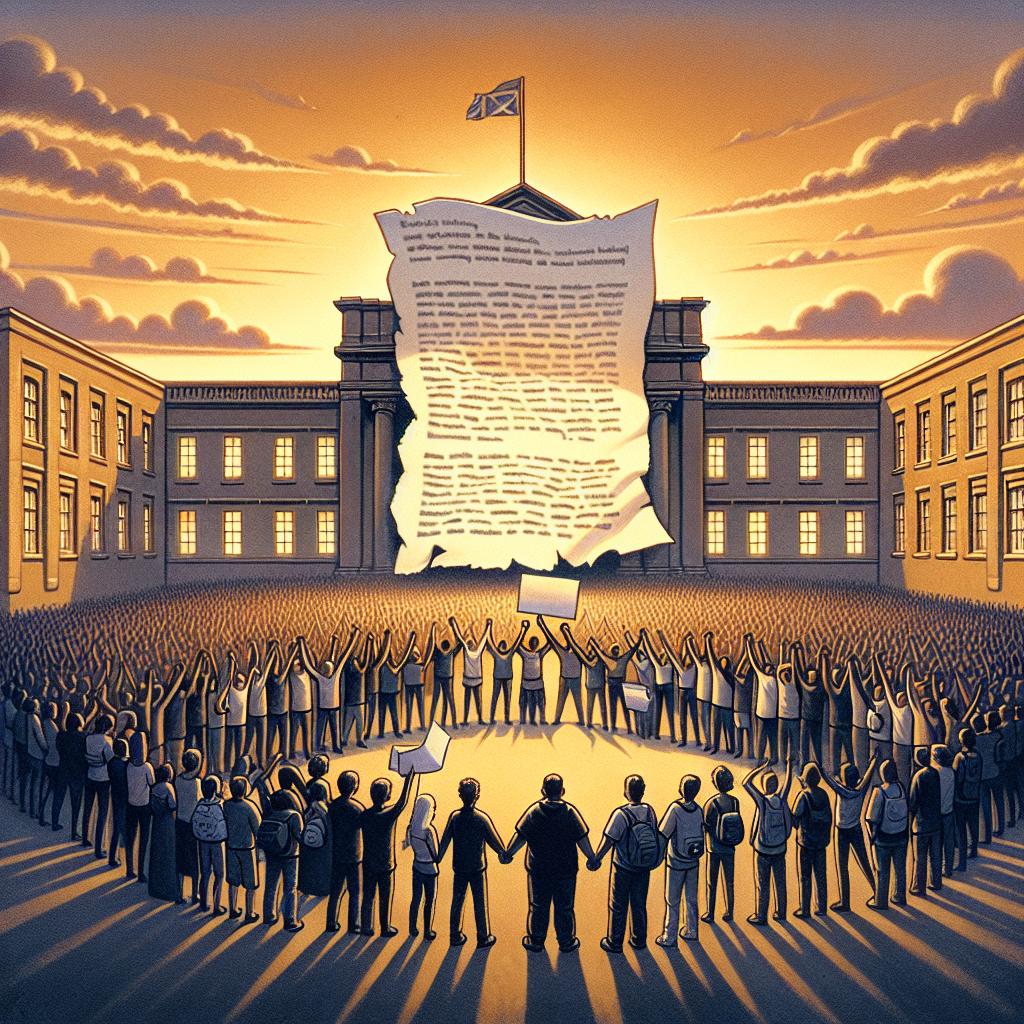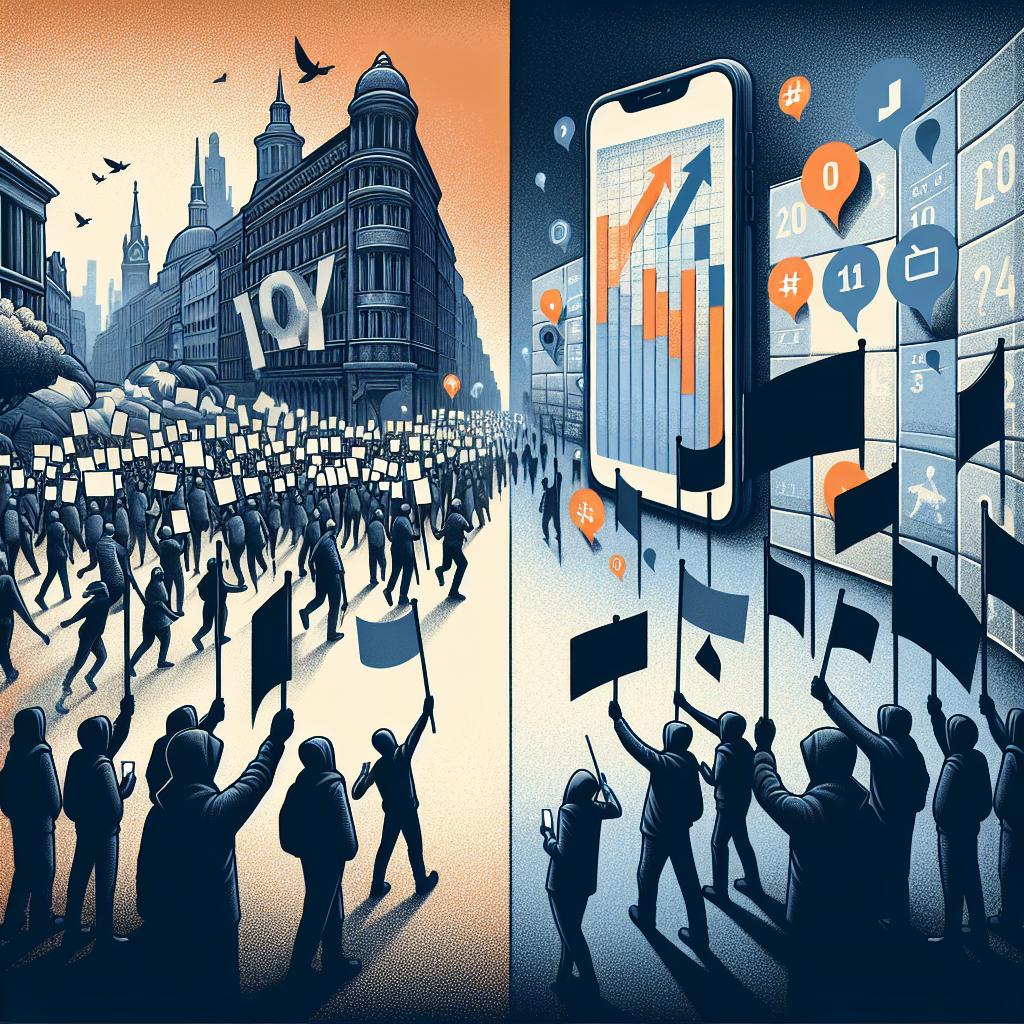La France a été la dernière grande puissance économique occidentale à recourir au Fonds monétaire international (FMI), en 1969. Cette référence historique revient souvent dans les débats quand des responsables économiques ou financiers évoquent la possibilité d’un nouvel appel au FMI. Pourquoi une telle éventualité est‑elle perçue comme une menace potentielle, au point que le chef économiste du FMI, lui‑même français, ait jugé que la question « pourrait se poser, (…) si rien n’était fait, (…) mais ni demain ni après‑demain » ?
Ce qu’implique réellement un programme du FMI
Recourir au FMI ne signifie pas automatiquement « passer sous tutelle ». Dans la pratique, un pays et l’institution entament une négociation sur un ensemble de mesures d’ajustement. Les techniciens du FMI cherchent à s’assurer que ces réformes ont une chance sérieuse d’être appliquées. Pour cela, ils dialoguent non seulement avec l’exécutif mais aussi avec le Parlement et les partenaires sociaux lorsque c’est pertinent.
Un « programme FMI » ne prend effet qu’après approbation par le conseil d’administration du Fonds, composé — selon le texte de départ — de 25 administrateurs représentant les Etats membres. Le pouvoir politique de décision appartient à ce Conseil, qui valide les conditions et l’octroi d’éventuelles ressources. Le recours à ces procédures traduit donc une relation contractuelle et technique, plus qu’une subordination automatique.
Les quatre crises qui peuvent conduire à solliciter le FMI
Un Etat peut souhaiter « passer sous programme » du FMI s’il affronte séparément ou simultanément l’une de ces quatre crises : une crise de liquidité, une crise de solvabilité, une crise de crédibilité, ou une crise de capacité politique. Ces catégories permettent de distinguer des situations très différentes et expliquent pourquoi l’évocation du FMI n’est pas systématique.
La crise de liquidité survient lorsqu’un pays ne peut plus honorer ses échéances à court terme, en raison d’un déficit courant important, d’un manque de réserves en devises ou d’une incapacité d’emprunter sur les marchés. Le FMI intervient fréquemment pour apporter un soutien de trésorerie et coordonner des mesures destinées à restaurer l’accès aux marchés.
La crise de solvabilité touche à la capacité à rembourser la dette à long terme. On compare classiquement le stock de dette au flux annuel de richesses — le PIB — mais, plus rigoureusement, la dette devrait être analysée en regard du patrimoine national et des actifs disponibles. Ces distinctions comptent pour apprécier la soutenabilité de la dette.
Pourquoi la France n’est pas dans ces scénarios, selon le raisonnement courant
Dans le cas évoqué par les autorités et les analystes, la France ne remplirait pas les conditions d’une crise de liquidité : elle ne ferait pas face à une incapacité immédiate à honorer ses engagements, à un manque de réserves en devises ou à un blocage complet de l’accès aux marchés. Le fait que le taux d’emprunt long se soit légèrement tendu n’implique pas, en soi, une urgence de trésorerie ; certains observateurs estiment que des « déclarations intempestives » ont pu contribuer à ce mouvement.
Quant à la solvabilité, l’argument principal avancé est que la France reste solvable. La simple comparaison dette/PIB donne un signal, mais il est rappelé que la soutenabilité doit également tenir compte du stock d’actifs et du patrimoine national. Cet angle permet d’écarter, selon ces analyses, une crise de long terme nécessitant un plan d’ajustement extérieur.
La crise de crédibilité ou la crise de capacité politique sont des notions plus subjectives : la crédibilité renvoie à la confiance des marchés et des partenaires dans la capacité d’un gouvernement à tenir ses engagements ; la capacité politique concerne l’aptitude des institutions à concevoir et mettre en œuvre des réformes. L’évocation d’un recours au FMI peut, à elle seule, affecter ces perceptions, d’où la prudence des autorités lorsqu’elles abordent publiquement cette question.
Dans ce contexte, parler d’un possible appui du FMI peut apparaître inutilement alarmant si aucune des conditions objectives n’est réunie. Pour des raisons géopolitiques, politiques et économiques, de nombreux décideurs préfèrent réserver ce recours à des scénarios clairement motivés par des besoins de trésorerie ou de restructuration.
Au‑delà des éléments techniques, la discussion montre aussi que l’argument du FMI sert parfois de levier rhétorique dans des débats nationaux plus larges sur la politique budgétaire, la dette et la gouvernance. La citation du chef économiste du FMI illustre cette prudence : l’hypothèse « pourrait se poser » reste conditionnée et temporairement écartée par la perspective d’actions préventives.
Au final, l’évocation du FMI pour la France renvoie à une combinaison d’éléments économiques réels et de considérations politiques. Sauf signes tangibles d’un basculement vers l’un des quatre types de crises décrits, les responsables continuent d’estimer que l’option reste théorique plutôt que nécessaire.