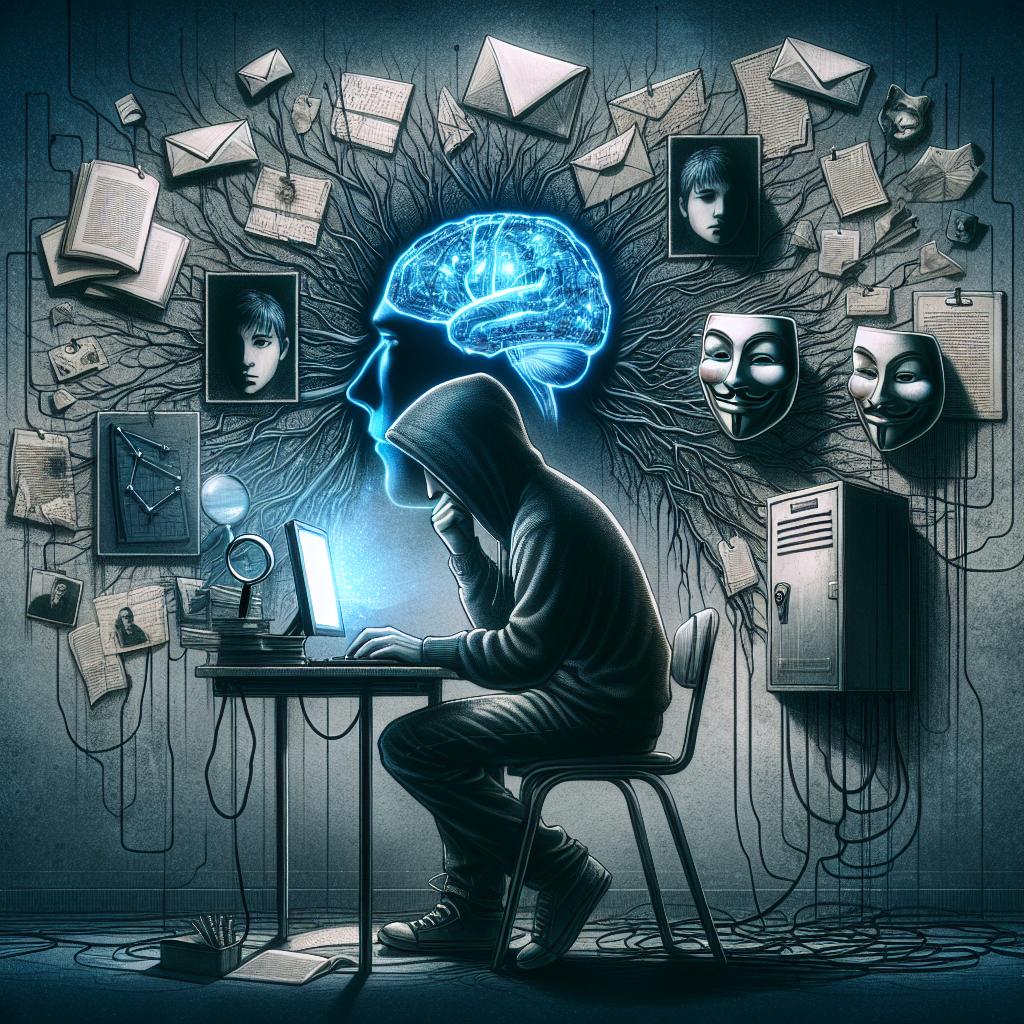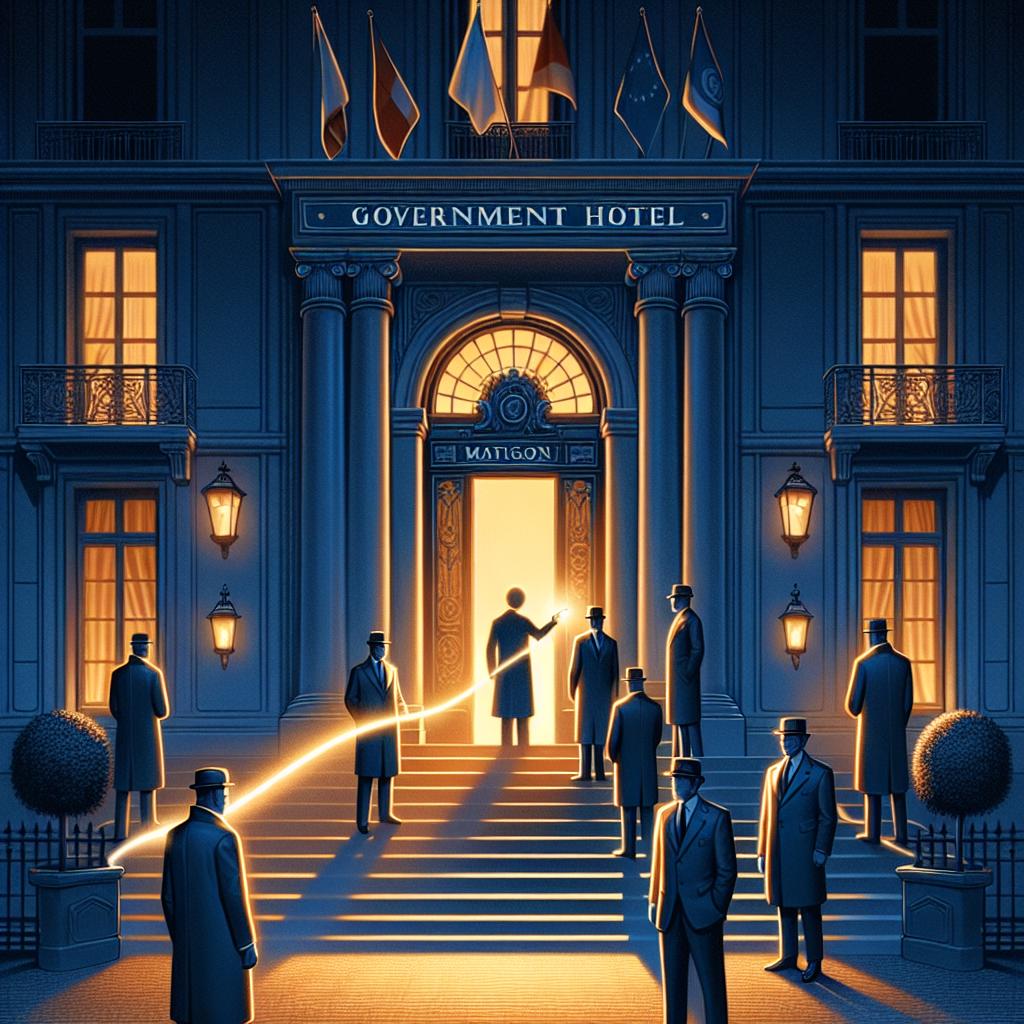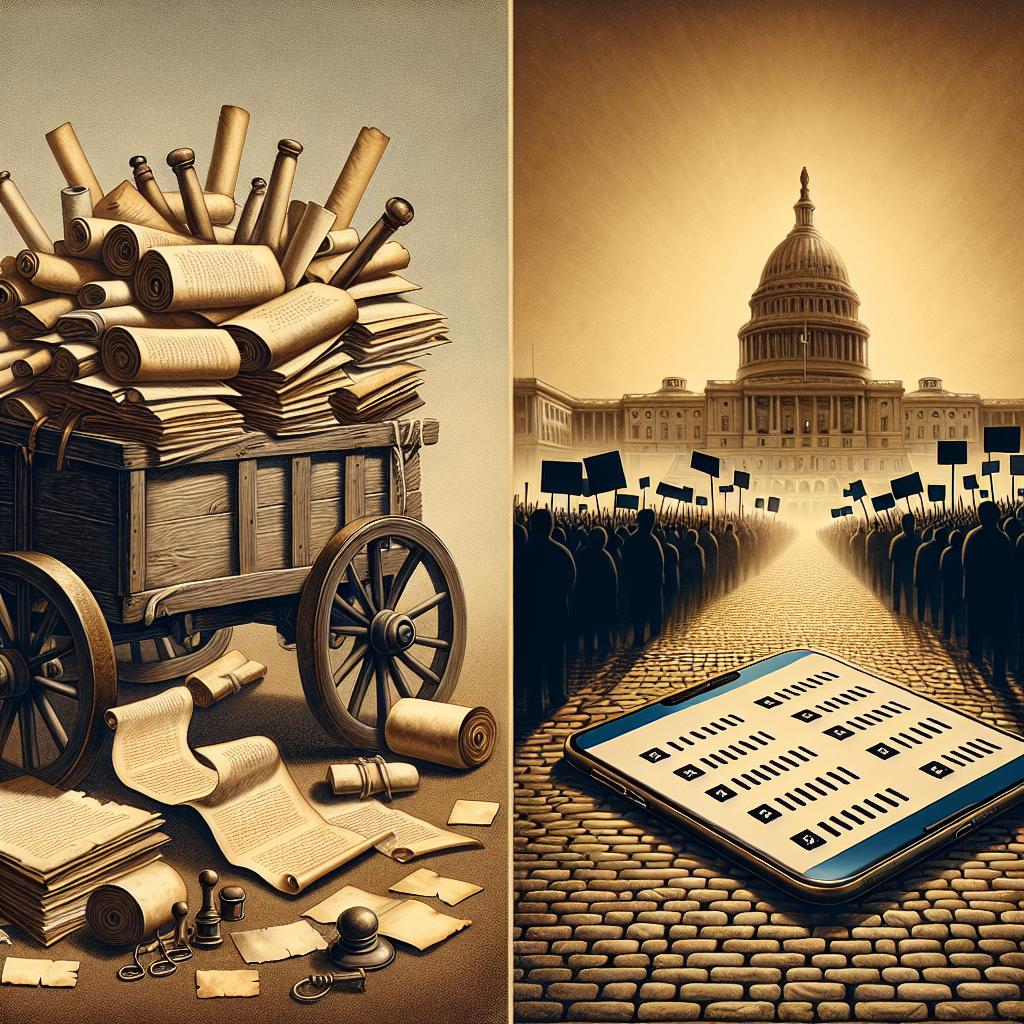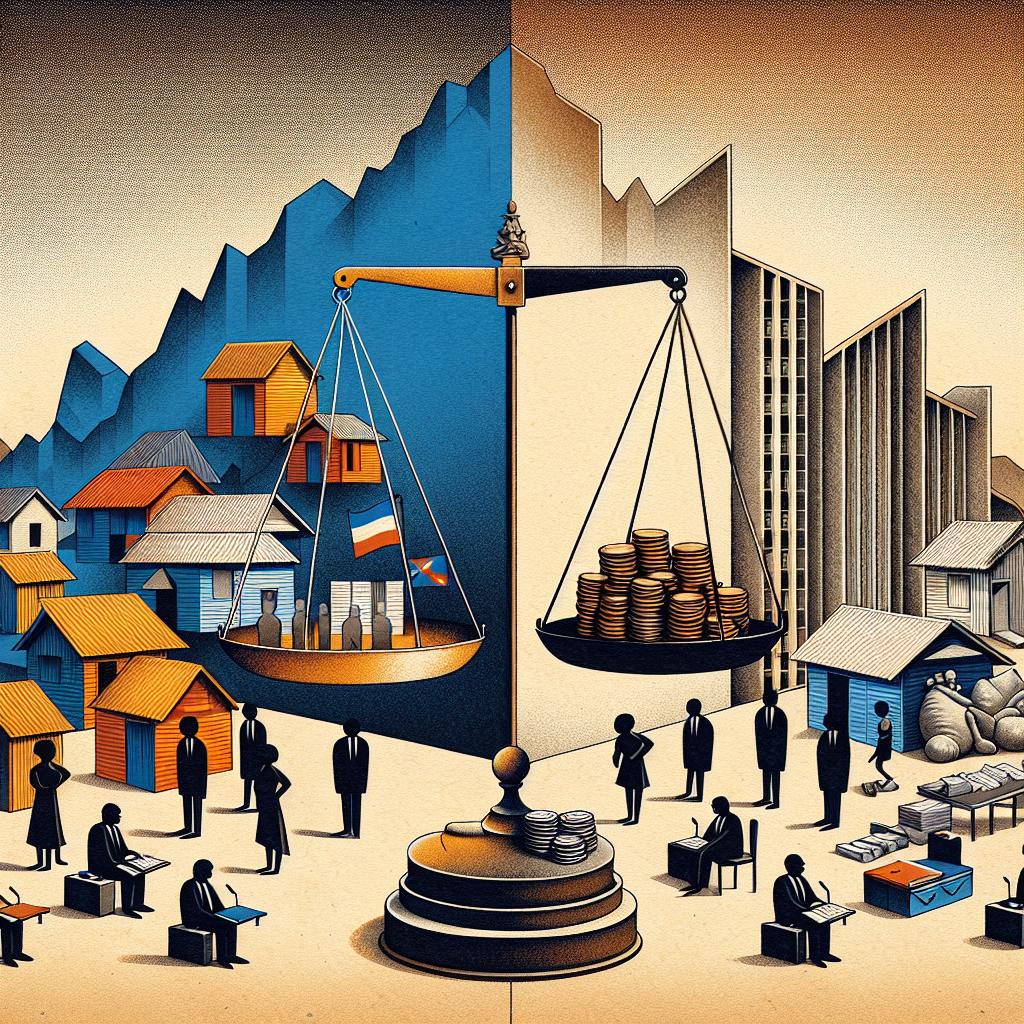Le livre et son objet
Dans Suprémaciste. Anatomie d’un parcours d’ultradroite (Université Paris Cité Éditions, 190 pages, 15 euros), le sociologue Elyamine Settoul examine le processus de radicalisation d’un jeune leader d’un groupe se réclamant de l’OAS — sigle ici interprété comme Organisation des armées sociales, en hommage à l’Organisation de l’armée secrète de la guerre d’Algérie.
Le chercheur a rencontré ce jeune homme en détention et l’a désigné sous le prénom de Kylian « par respect du droit à l’oubli ». Le récit combine enquête de terrain et analyse sociologique, et se présente comme une tentative de comprendre, sans simplification, les ressorts d’une trajectoire politique extrême.
Une trajectoire personnelle et scolaire
Kylian est né dans une famille décrite comme sympathisante du Front national (FN). Sa scolarité, au début des années 2000, se déroule à Vitrolles puis à Marignane, deux communes des Bouches-du-Rhône identifiées par l’auteur comme des « laboratoires de l’extrême droite ».
L’entourage familial est qualifié de compliqué. Mais c’est surtout la trajectoire scolaire qui apparaît, selon le sociologue, comme un facteur clé de radicalisation. Kylian souffre de tics nerveux et subit des moqueries. Cette stigmatisation sociale alimente une profonde mésestime de soi.
Settoul explique que l’adhésion idéologique opère ici comme une conversion : « l’adhésion idéologique convertit progressivement cette haine de soi en haine de l’autre », écrit-il. L’idéologie fournit des cadres interprétatifs et des identités compensatoires là où la reconnaissance sociale fait défaut.
Internet, fascination et modèles violents
Le livre souligne le rôle central d’Internet dans ce basculement. Kylian se réfugie en ligne et se montre fasciné par Anders Breivik, le suprémaciste norvégien qui, en 2011, a tué 77 personnes et en a blessé 320. Il voit en lui un « chevalier nordique » prêt à sacrifier sa vie pour la civilisation européenne.
Settoul met en évidence comment des figures violentes peuvent fonctionner comme modèles d’identification. La diffusion en ligne de récits, d’images et de vidéos offre à des individus isolés des matrices symboliques susceptibles de légitimer la violence.
Comparaisons entre djihadisme et ultradroite
Un des apports les plus remarqués de l’ouvrage est le rapprochement entre militants djihadistes et activistes d’ultradroite. Settoul observe qu’ils « partagent, au-delà de leurs profonds antagonismes idéologiques, des proximités cognitives, des perméabilités intellectuelles et un ethos rendant leurs trajectoires potentiellement comparables ».
Le sociologue ne revendique pas l’équivalence des projets politiques. Il souligne plutôt des similarités de fonction : modes de recrutement, usages communicationnels et modalités d’action violente peuvent se ressembler, malgré des objectifs opposés.
Selon l’auteur, le cycle d’attaques djihadistes a exercé une « fascination » sur certains suprémacistes blancs. Ce phénomène aurait engendré « un effet de mimétisme dans leur manière de concevoir et de mener des actions violentes ». La logique est présentée comme une contagion symbolique plutôt que comme une convergence idéologique.
Communication et mimétisme
Kylian lui-même reconnaît l’efficacité de la communication ennemie : « Il faut avouer qu’ils sont très forts au niveau communication », dit-il. Il ajoute que leurs vidéos sont attrayantes, « même si tu n’es pas musulman, c’est attirant ». La remarque illustre la puissance des images et de la mise en scène dans la propagation d’idéologies extrémistes.
Settoul relève que ces formats médiatiques — vidéos, manifestes, réseaux — facilitent l’apprentissage de la violence et la construction d’un ethos militant. Pour l’auteur, comprendre ces mécanismes est indispensable pour penser la prévention.
Ton, limites et lecture critique
Le livre mêle témoignage direct, notes analytiques et concepts sociologiques. L’ouvrage n’évite pas toujours un certain jargon académique, ce qui peut limiter l’accès du grand public à certains développements théoriques.
Pour autant, la force du texte tient à la confrontation d’une enquête de terrain avec des éléments de théorie sociale. Settoul propose une description nuancée des processus de radicalisation, sans chercher à réduire la trajectoire à une seule cause.
Suprémaciste. Anatomie d’un parcours d’ultradroite offre ainsi un matériau pour réfléchir aux circulations idéologiques et aux modalités contemporaines de l’extrémisme. Le livre s’adresse autant aux spécialistes qu’aux lecteurs soucieux de comprendre les ressorts individuels et collectifs de la violence politique.