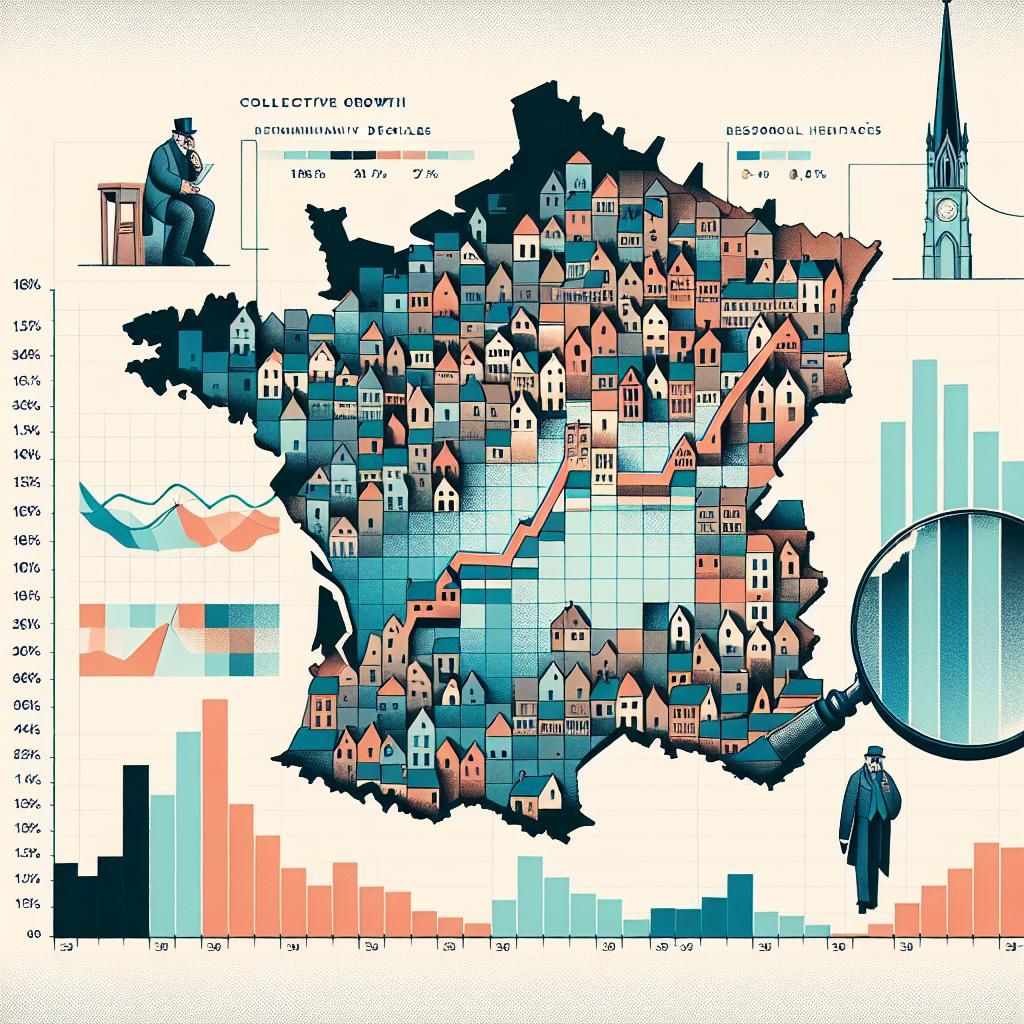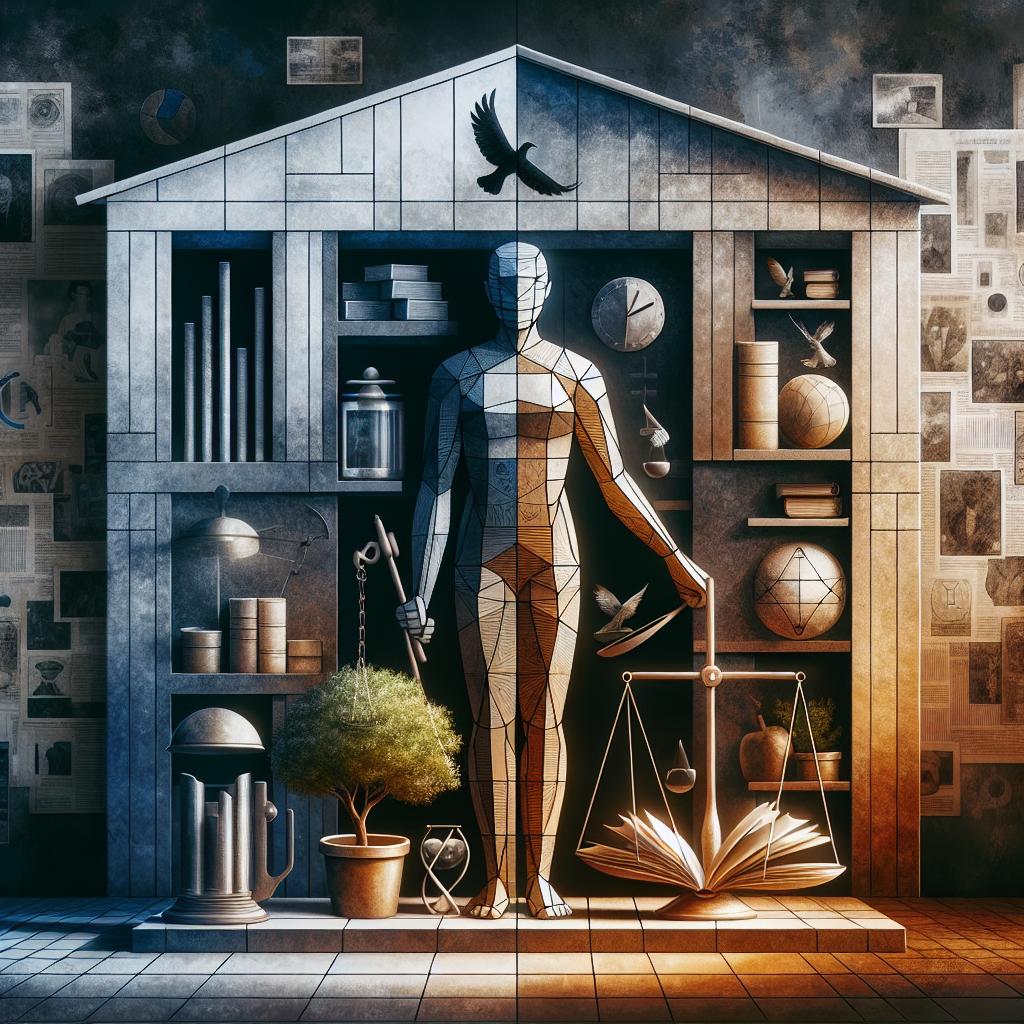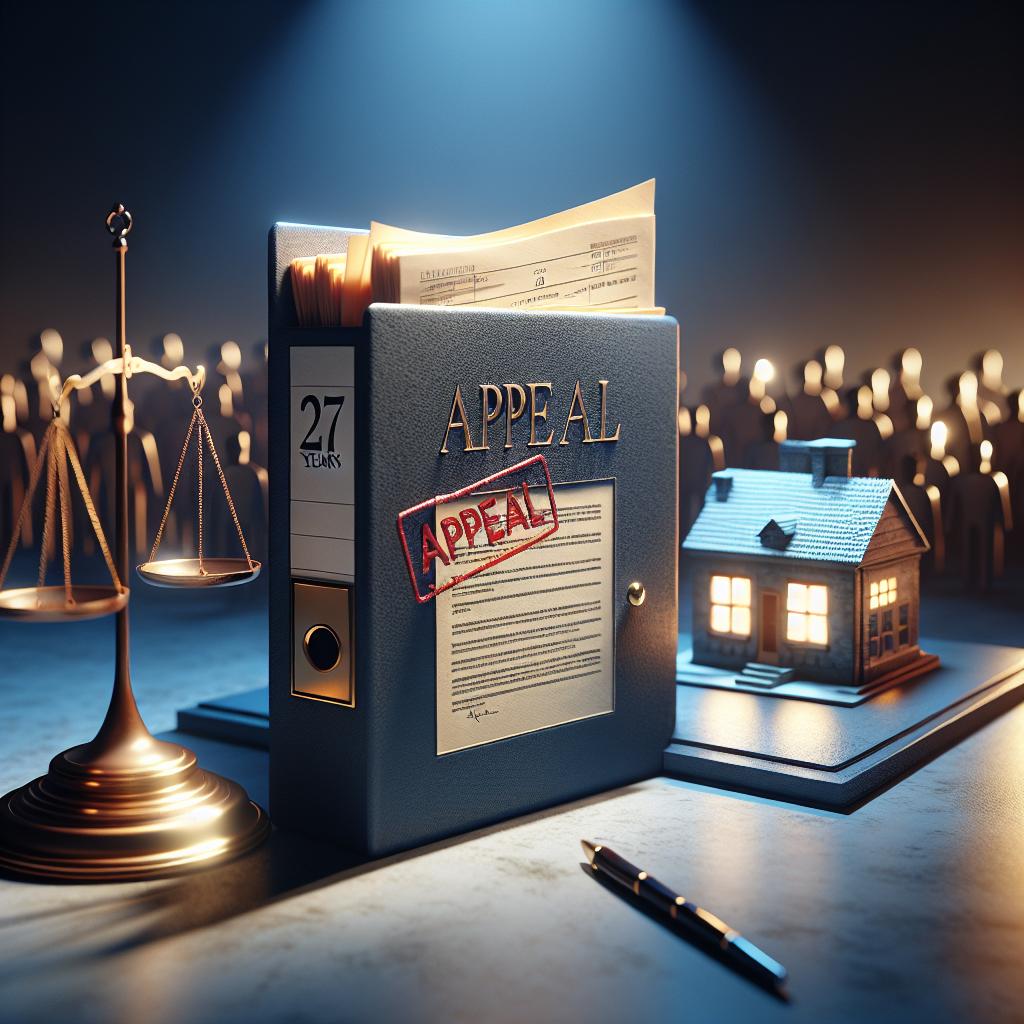Dans Une histoire du conflit politique (Seuil, 864 p., 27 €), les auteurs, dont Julia Cagé, proposent une méthode systématique pour mesurer le lien entre composition sociale des communes et comportements électoraux. Leur objectif : établir des faits et des évolutions sur le long terme, en s’appuyant sur des séries de données communales étendues et comparables.
Méthode et sources
Les auteurs ont rassemblé les résultats électoraux au niveau communal pour l’ensemble des scrutins législatifs et présidentiels de 1848 à 2022, ainsi que pour les référendums les plus significatifs entre 1793 et 2005.
Ils classent ensuite les quelque 36 000 communes françaises selon leur richesse moyenne, du 1 % des communes les plus pauvres au 1 % des plus riches. L’analyse porte sur l’évolution des scores des candidats et des courants politiques en proportion de leur score moyen national.
Plusieurs indicateurs de richesse sont utilisés, en particulier le revenu moyen par commune. Les auteurs indiquent obtenir des résultats cohérents avec d’autres mesures, comme la valeur moyenne des logements. Cette cohérence méthodologique renforce la stabilité des tendances observées.
Un vote « plus bourgeois » pour Macron et Ensemble
Concernant le vote en faveur d’Emmanuel Macron ou de la coalition Ensemble lors des scrutins récents, les auteurs observent une « pente exceptionnellement forte ». Autrement dit, le rapport entre richesse communale et pourcentage de vote montre une très nette corrélation : le score augmente de façon marquée avec le niveau moyen de revenu des communes.
À l’échelle d’électorats comparables — autour de 20 à 30 % des voix au premier tour ou davantage — le vote Macron/Ensemble apparaît globalement plus « bourgeois » que certains votes de droite du passé. Les auteurs comparent ce profil avec des votes historiques pour Giscard, Chirac, Balladur, de Gaulle ou les formations RPR-UDF : la différence tient surtout à la partie basse de la distribution.
Alors que la droite traditionnelle parvenait à capter une partie du vote dans les communes modestes, notamment en milieu rural, le vote Macron montre une moindre présence dans ces communes. Dans les communes les plus riches, la pente est proche de celle de la droite classique, mais elle s’accentue sensiblement dans les communes les plus pauvres.
Les auteurs signalent néanmoins des exceptions : certains votes de droite se révèlent encore plus « bourgeois » que Macron, par exemple celui de Alain Madelin en 2002 ou d’Éric Zemmour en 2022. Ces votes, précisent-ils, restent toutefois plus restreints en termes de taille d’électorat, ce qui les distingue des candidatures rassemblant 20–30 % des suffrages.
Antécédents : une évolution amorcée avant Macron
Les auteurs rappellent que cette tendance n’est pas née avec Emmanuel Macron. Ils identifient une évolution déjà perceptible avec les votes pour Nicolas Sarkozy en 2007 et 2012, qui présentent une pente plus marquée que les votes de Giscard ou de Chirac, notamment dans le bas de la distribution.
Selon eux, une partie de l’électorat populaire rural qui votait traditionnellement pour la droite a amorcé une transition vers le Front national / Rassemblement national. Cette dynamique s’est accélérée à la suite de plusieurs événements politiques, parmi lesquels le référendum de 2005 et ce que les auteurs désignent comme des décisions parlementaires sur des traités européens. Les auteurs interprètent ce glissement comme en grande partie socio-économique : un vote d’anxiété face à la désindustrialisation et à l’intégration commerciale internationale.
Ils insistent sur le fait que, dans les bourgs et les villages, le vote pour le FN-RN relève davantage de préoccupations socio-économiques que d’un vote strictement identitaire. À leurs yeux, ce n’est pas tant la rhétorique sécuritaire — évoquant, par exemple, les formules « Kärcher » ou « racaille » — qui explique ce basculement, que des transformations économiques et sociales ressenties comme menaçantes.
Conclusion provisoire
Les auteurs concluent que le vote Macron prolonge et amplifie une évolution engagée avant lui, que certains décrivent comme « bourgeoise-sarkozyste ». Leur approche statistique, fondée sur des séries longues et la classification des communes par richesse, permet de mesurer finement comment les recompositions électorales se distribuent selon le territoire et le niveau de vie.
Cette lecture met l’accent sur des causes structurelles — économiques et territoriales — pour expliquer des recompositions durables du paysage politique français, plutôt que sur des facteurs purement discursifs ou conjoncturels.