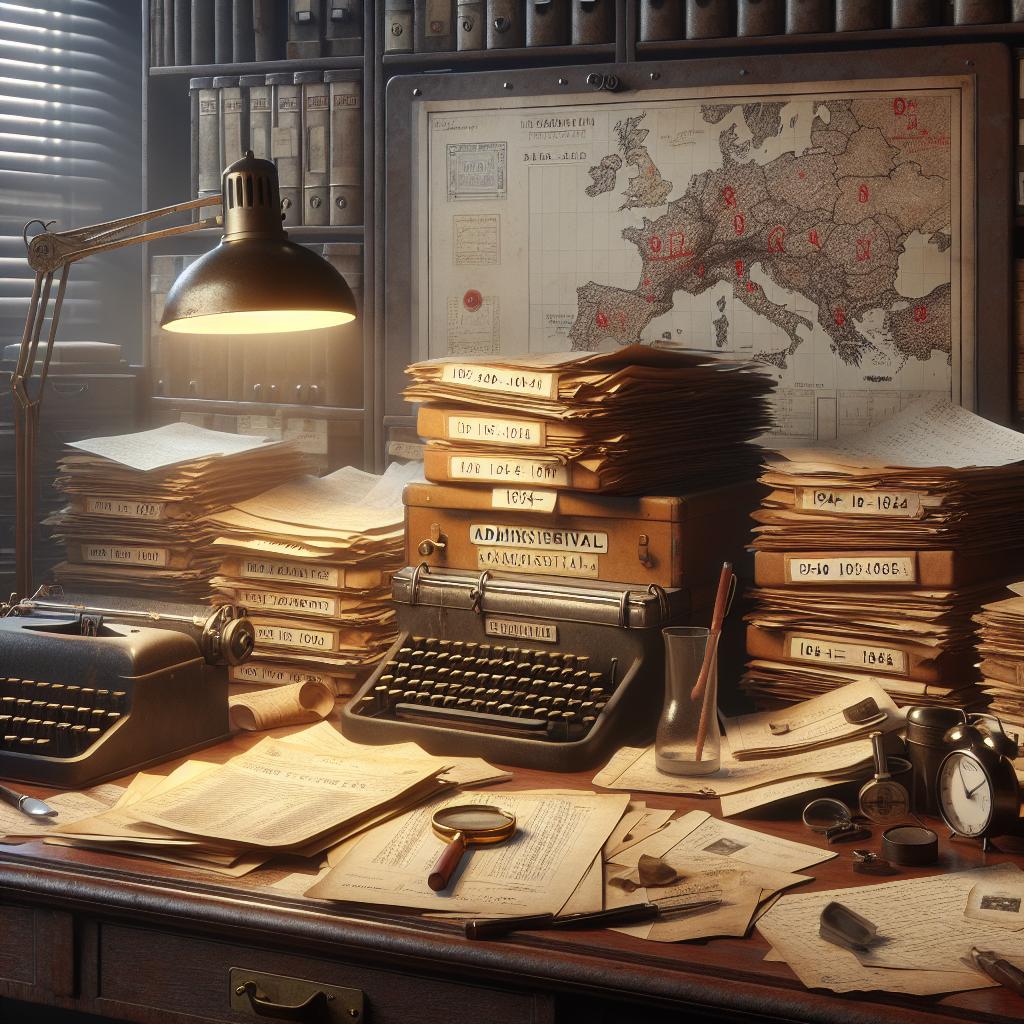Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, a dirigé l’ouvrage Vichy. Histoire d’une dictature 1940-1944. Il est également l’auteur de L’Etat contre les Juifs. Vichy, les nazis et la persécution antisémite et de La Rafle du Vel d’Hiv. Paris, juillet 1942 (Grasset, 2018 et 2022), œuvres qui portent un regard détaillé sur les politiques et les pratiques du régime de Vichy.
Une dictature étudiée
Le cadre chronologique retenu par l’ouvrage dirigé par Laurent Joly — 1940-1944 — situe clairement Vichy comme un régime de fait, avec une organisation et des choix politiques propres. L’expression « Histoire d’une dictature » renvoie à l’idée que Vichy n’a pas seulement été une administration passagère mais un pouvoir qui a pris des décisions structurelles pendant la période indiquée.
Les travaux de Joly, tels que rappelés par leurs titres, interrogent à la fois la responsabilité de l’État et les formes concrètes de persécution. Le propos des ouvrages, en se concentrant sur la législation et les opérations menées sous Vichy, vise à documenter les mécanismes qui ont conduit à l’exclusion et à la répression de populations ciblées.
Mémoire et silence après 1944-1945
À la sortie de la guerre, en 1944-1945, le régime de Vichy s’est imposé comme un symbole de la défaite et de la trahison. Dans le discours public et privé de l’époque, ces années ont souvent été associées à l’humiliation nationale. Pourtant, malgré cette forte charge symbolique, la période a parfois été évitée, voire minimisée dans la mémoire collective.
Ce phénomène d’évitement s’explique en partie par un sentiment de honte diffus, qui a conduit nombre d’acteurs et d’observateurs à ne pas approfondir certains aspects du passé récent. Conséquence: les crimes principaux attribués au régime ont été, selon l’analyse citée, en grande partie occultés, tandis que la figure de certains responsables a pu conserver une place atténuée dans l’imaginaire national.
Dans les années qui ont suivi, et plus particulièrement durant l’atmosphère de réconciliation nationale des années 1950, s’est diffusé ce que l’on nomme le mythe du « glaive » et du « bouclier ». Selon cette lecture, de Gaulle à Londres et Pétain à Vichy auraient constitué deux rôles complémentaires et « nécessaires » pour la France. Ce récit, souvent présenté comme une tentative de réconcilier des mémoires opposées, a contribué à estomper les lignes de responsabilité et à figer une image ambivalente du passé.
Enjeux historiographiques et portée des travaux
Les recherches réunies et dirigées par des spécialistes comme Laurent Joly cherchent à réinterroger ces récits simplifiés. En insistant sur l’analyse des textes, des décisions administratives et des actes commis, elles visent à replacer la période 1940-1944 dans sa dimension politique et juridique, plutôt que de la réduire à un symbole moral unique.
Cette démarche implique de rendre visibles des mécanismes souvent passés sous silence et d’évaluer la responsabilité institutionnelle. Les ouvrages mentionnés, par leurs titres et leur date de parution, signalent une volonté de confronter la mémoire collective à des archives et à des enquêtes qui documentent la persécution et les événements marquants comme la rafle de juillet 1942 à Paris.
En présentant ces travaux, le propos n’est pas de trancher toutes les controverses mémorielles, mais d’offrir des outils d’analyse permettant de comprendre comment s’est constituée, après 1944-1945, une mémoire partiellement réconciliée et parfois protective de certaines figures. L’historiographie contemporaine, telle qu’illustrée par ces publications, privilégie le recueil de preuves et l’explicitation des dispositifs politiques pour éclairer les choix et les responsabilités du régime de Vichy.