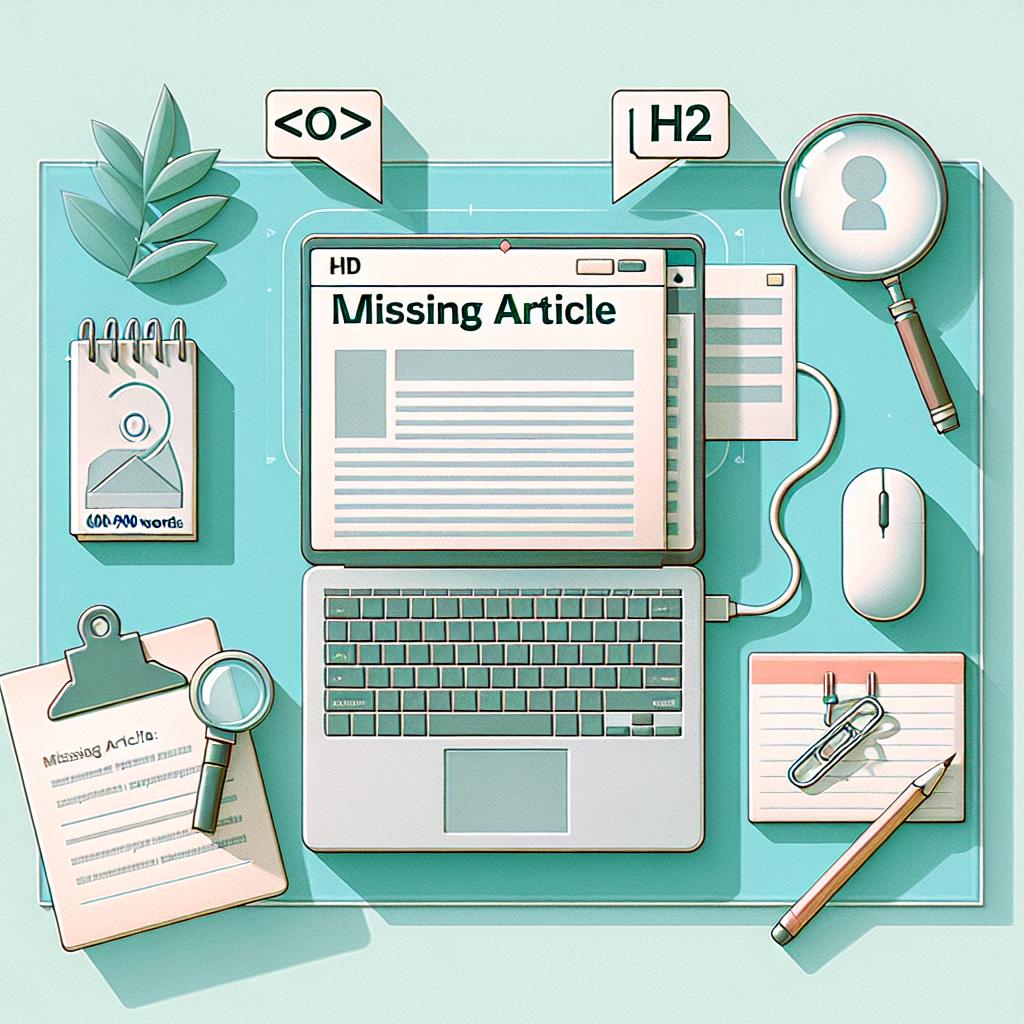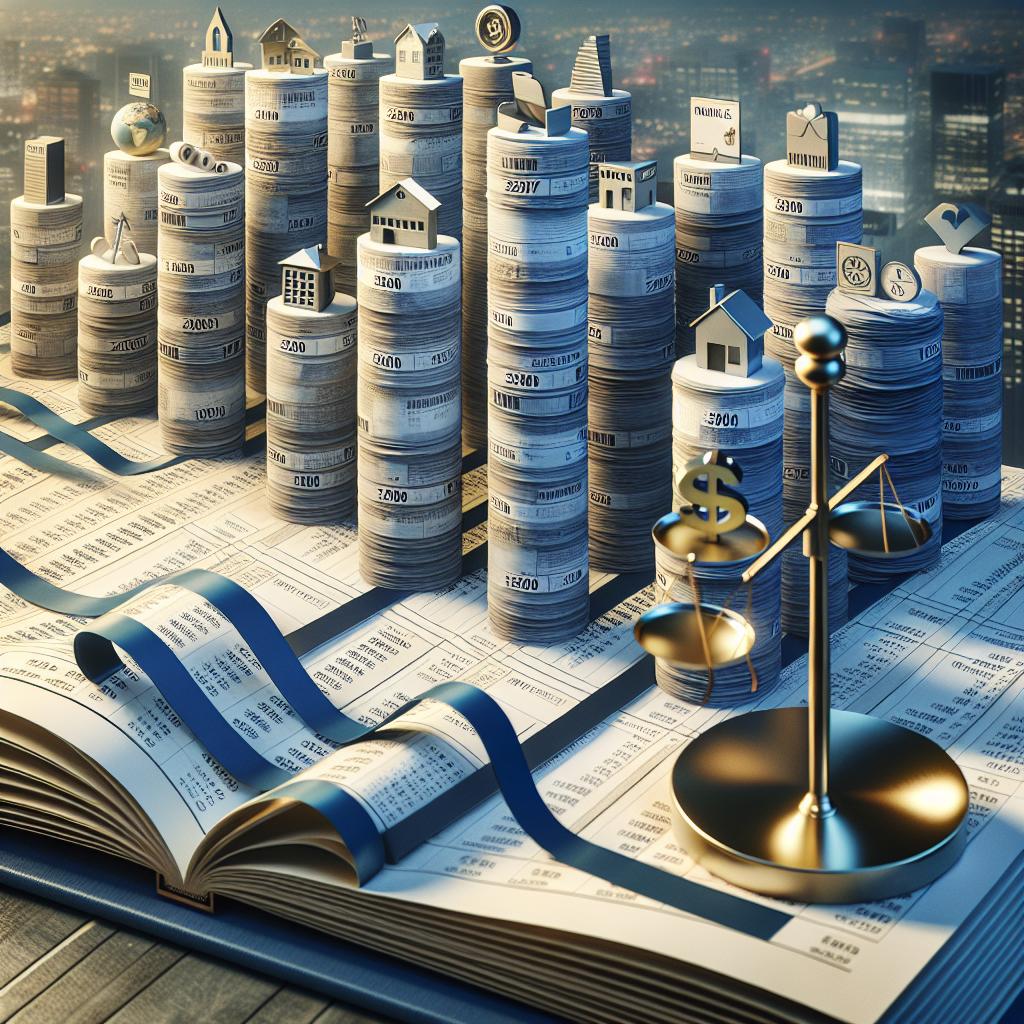Les anciens ministres de la Santé signataires d’un texte dans les colonnes du Monde sont pointés du doigt par l’auteur pour leur ton moraliste, tandis que l’on leur reproche de ne pas s’être suffisamment interrogés sur l’héritage de leur action. Le constat exposé est simple et inquiet : l’accès aux soins en France montre des signes d’affaiblissement perceptibles au quotidien, et les mécanismes de gouvernance mis en avant ces dernières années suscitent des questions quant à leur efficacité réelle.
Un constat social et sanitaire
Dans le texte original, plusieurs constats frappent par leur gravité. On y lit que « près de sept Français sur dix renoncent à des soins, ou les reportent, faute de médecins disponibles ». Cette statistique, citée sans source précise dans l’exposé, traduit une réalité perçue : difficultés d’accès, délais allongés et recours retardé aux soins.
Le propos souligne aussi la fermeture progressive de maternités, la tension croissante dans les hôpitaux, et une mortalité infantile qui « ne faiblit pas ». Ces éléments dessinent l’image d’un système hospitalier et territorial sous pression, où la juxtaposition de déserts médicaux et d’établissements fragilisés pèse sur l’offre de soins.
Ces constats, tels qu’exprimés, renvoient à des phénomènes observables par de nombreux acteurs locaux : fermetures de services, renoncements aux soins pour raisons d’accès, et difficultés de recrutement dans les zones rurales et périurbaines. Le texte invite à dépasser les postures politiques pour engager une réforme responsable, capable de répondre aux problèmes concrets des patients et des professionnels.
ARS, départements et le rôle des territoires
L’un des axes de critique porte sur les agences régionales de santé (ARS), présentées comme « le pivot de la gouvernance sanitaire » mais accusées d’avoir montré leurs limites. Selon l’argumentaire, ces agences sont souvent perçues comme trop bureaucratiques et déconnectées du terrain, notamment en situation de crise.
Durant la crise du Covid-19, affirme le texte, ce sont principalement les départements, avec les maires, qui ont pris en charge des actions concrètes : distribution de masques, ouverture de centres de vaccination, et mobilisation des professionnels de santé locaux. Cette lecture insiste sur la capacité d’intervention opérationnelle des collectivités locales quand l’urgence le demande, et sur leur proximité avec les populations.
L’argument ne nie pas le rôle institutionnel des ARS, mais met en avant la complémentarité souhaitée entre l’échelon régional et l’action quotidienne des collectivités. Il pose la question de savoir si la coordination sanitaire ne gagnerait pas à être rééquilibrée au profit d’une présence territoriale plus visible et directement impliquée dans l’organisation des soins.
Propositions de rééquilibrage et débat de gouvernance
Face à ces constats, le Premier ministre, lors des Assises des départements de France, a choisi de ne pas proposer de « démembler les ARS », expression rapportée dans l’article. Il a plutôt évoqué l’idée de « remettre du bon sens » dans un système qu’il juge, selon le texte, devenu inopérant pour certaines missions.
Concrètement, la proposition mentionnée consiste à clarifier le rôle des préfets et à renforcer la capacité des départements à coordonner localement les politiques sanitaires. L’objectif affiché est de rendre « opérationnelle la solidarité républicaine » en rapprochant les décisions des besoins effectifs des territoires.
Les partisans de ce rééquilibrage avancent un argument pragmatique : l’attractivité d’un médecin pour s’installer dans un bourg rural dépend souvent de facteurs gérés au niveau local — routes, maisons médicales, accès au numérique, politiques sociales et relations avec les pharmaciens de proximité. Pour eux, confier davantage de responsabilités de coordination aux départements permettrait d’articuler ces leviers concrets avec les besoins de santé.
En revanche, d’autres acteurs mettent en garde contre un transfert de responsabilités qui risquerait de fragmenter la pilotage national des politiques de santé. Le débat reste donc ouvert entre la recherche d’une gouvernance plus centrée sur le terrain et la nécessité de préserver une cohérence nationale des stratégies sanitaires.
En définitive, le texte réécrit ici appelle à dépasser les postures et à engager une réflexion pragmatique sur les outils de gouvernance. Il invite à reconnaître les initiatives locales tout en préservant les atouts d’une organisation régionale et nationale capable de garantir l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.