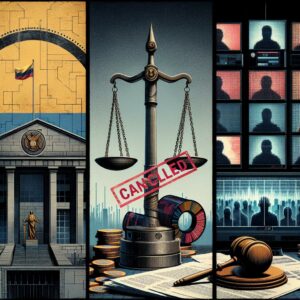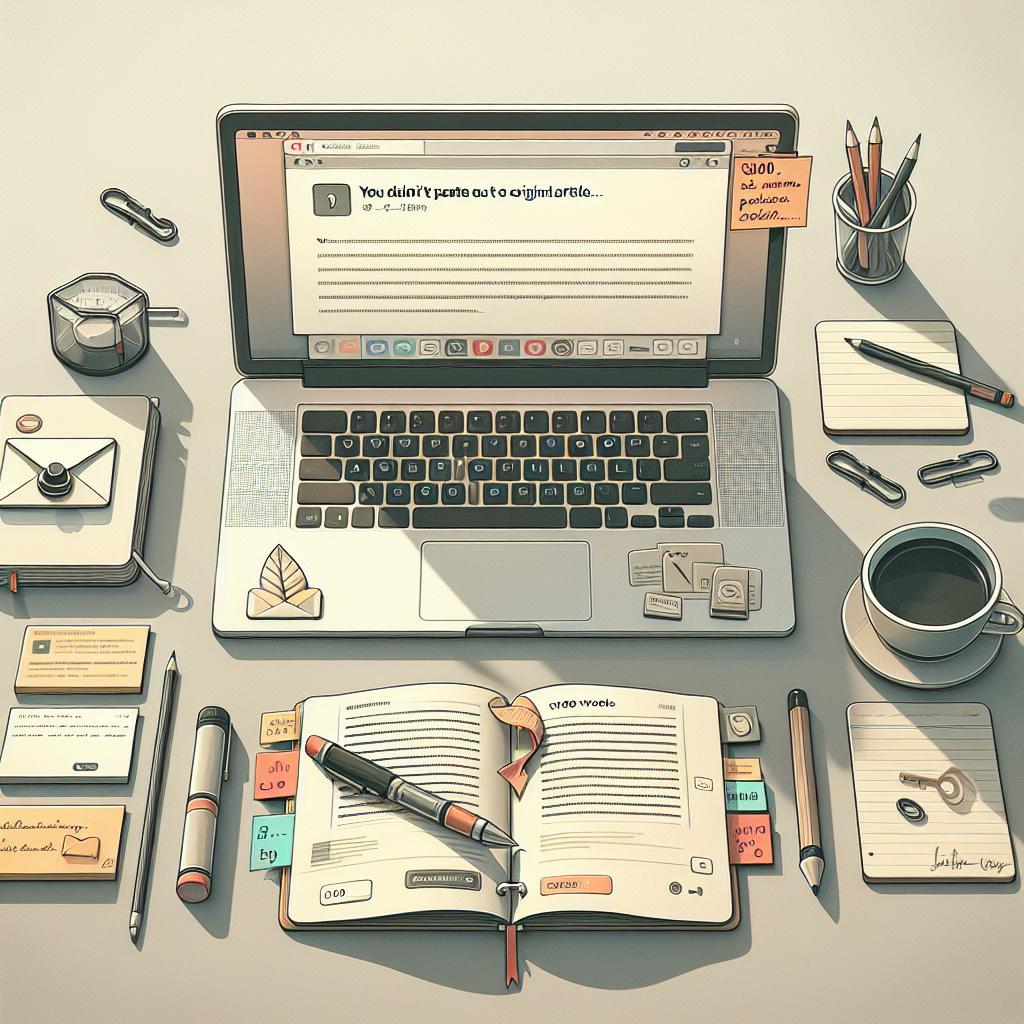Selon une étude de l’Office européen des brevets (OEB) publiée mercredi 22 octobre, la France se distingue en Europe par le nombre de brevets déposés par des organismes de recherche publique. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) figurent parmi les institutions les plus actives.
Un bilan chiffré sur deux décennies
L’OEB a analysé les demandes de brevets déposées par des organismes publics entre 2001 et 2020 dans ses trente-neuf États membres. Sur cette période, plus de 25 000 demandes ont été générées par des organismes publics de recherche français, ce qui représente près de 14 % de l’ensemble des demandes déposées par des acteurs français et environ 40 % des 63 000 brevets déposés par des instituts publics européens.
L’étude montre une concentration marquée de l’innovation. Dix institutions, majoritairement françaises et allemandes, concentrent près des deux tiers du total des demandes déposées par des instituts publics. Le CNRS et le CEA occupent respectivement les première et deuxième places, l’institut allemand Fraunhofer la troisième, et l’Inserm la quatrième.
Secteurs stratégiques et acteurs hospitaliers
Les secteurs les plus représentés dans ces dépôts comprennent la santé, les biotechnologies, les produits pharmaceutiques, les semi‑conducteurs et les technologies numériques. Ces domaines rassemblent une part importante des inventions issues des instituts publics et des hôpitaux universitaires européens.
Les hôpitaux universitaires figurent parmi les principaux déposants : les établissements français ont soumis 4 575 demandes, devant l’Allemagne (2 858) et le Royaume‑Uni (2 500). Ensemble, ces trois pays représentent plus de 56 % des demandes enregistrées par les hôpitaux universitaires en Europe. À eux seuls, l’Assistance publique‑Hôpitaux de Paris (AP‑HP) compte 1 968 demandes, soit plus de 11 % du total, devant l’Hôpital universitaire de Copenhague et l’Institut Karolinska de Stockholm.
Transfert technologique et financement des start‑up
Le président de l’OEB, Antonio Campinos, a souligné que « la recherche publique est l’une des plus grandes forces de l’Europe », appelant à « accélérer le transfert de la recherche vers des technologies concrètes. » Cette injonction reflète la préoccupation d’amplifier la conversion des résultats scientifiques en produits et services commercialisables.
Yann Ménière, chef économiste de l’OEB, a expliqué à l’Agence France‑Presse : « L’étude montre qu’en Europe nous avons un système de recherche ‘deeptech’, basé sur la science, très puissant et très performant. » Il ajoute que les start‑up les plus sérieuses et attractives proviennent souvent de la recherche publique, ce qui explique qu’elles captent une part disproportionnée des investissements.
Selon l’étude, environ un quart des start‑up européennes ayant généré des demandes de brevets impliquent des inventeurs issus d’instituts de recherche publique ou d’hôpitaux. Ces mêmes start‑up concentrent approximativement la moitié des financements levés, soulignant le rôle central des instituts publics dans l’écosystème d’innovation et d’investissement.
Concentration et perspectives
La carte des dépôts met en évidence deux caractéristiques : une forte concentration institutionnelle et une spécialisation sectorielle. Quelques grands instituts publics portent une large part de l’activité de brevets, tandis que certains domaines technologiques attirent la majorité des dépôts.
L’étude de l’OEB invite à renforcer les mécanismes de transfert et à améliorer les passerelles entre laboratoires publics et marchés. Les résultats présentés mettent en lumière la capacité de la recherche publique à produire des innovations protégées par brevet, mais aussi la nécessité, selon les auteurs cités, d’accélérer leur passage à l’échelle industrielle.
Le périmètre et la méthodologie retenus — demandes déposées entre 2001 et 2020, dans 39 États membres — fournissent une photographie statistique sur vingt ans. Ils permettent de mesurer l’importance des instituts publics dans le paysage européen des brevets sans présumer de l’évolution récente post‑2020, qui n’est pas couverte par cette tranche temporelle.