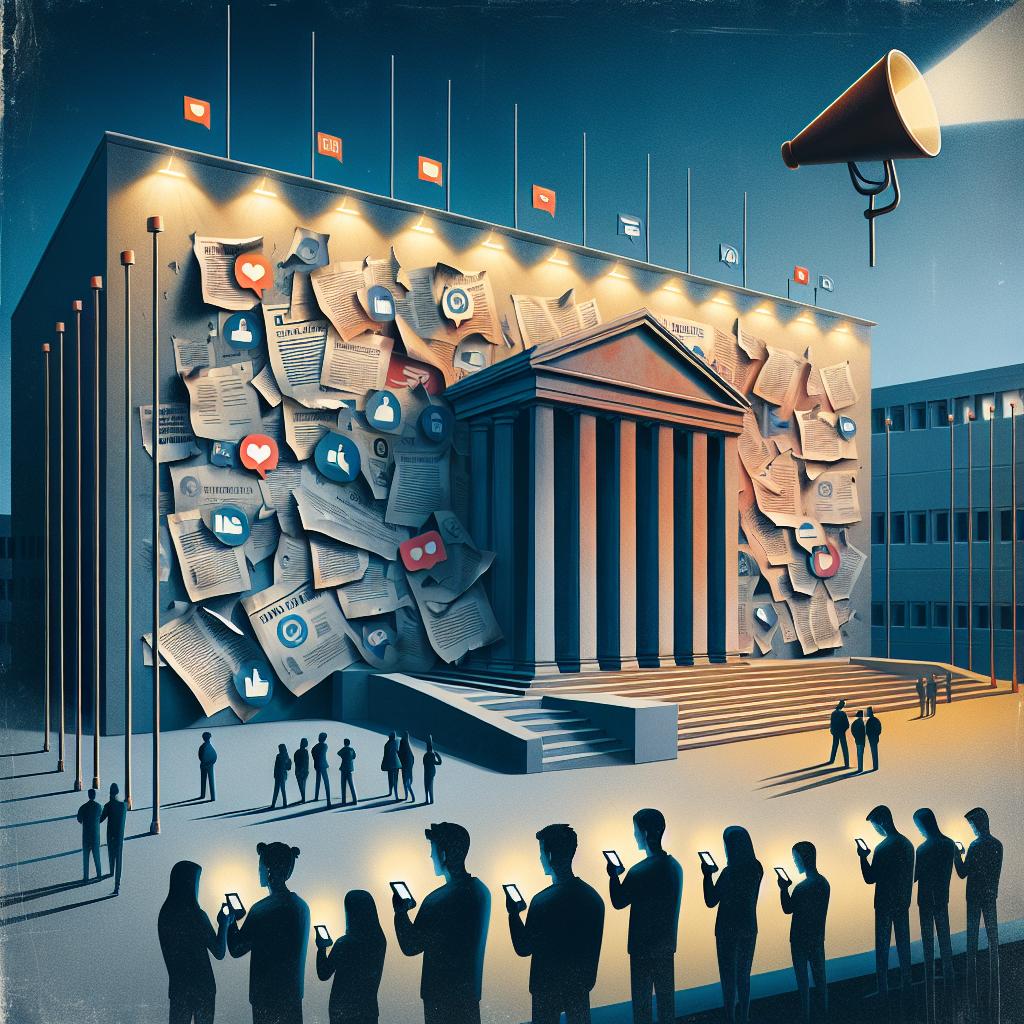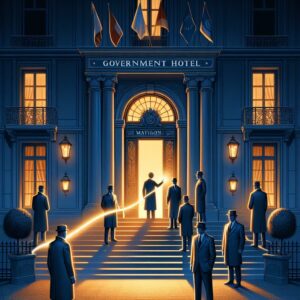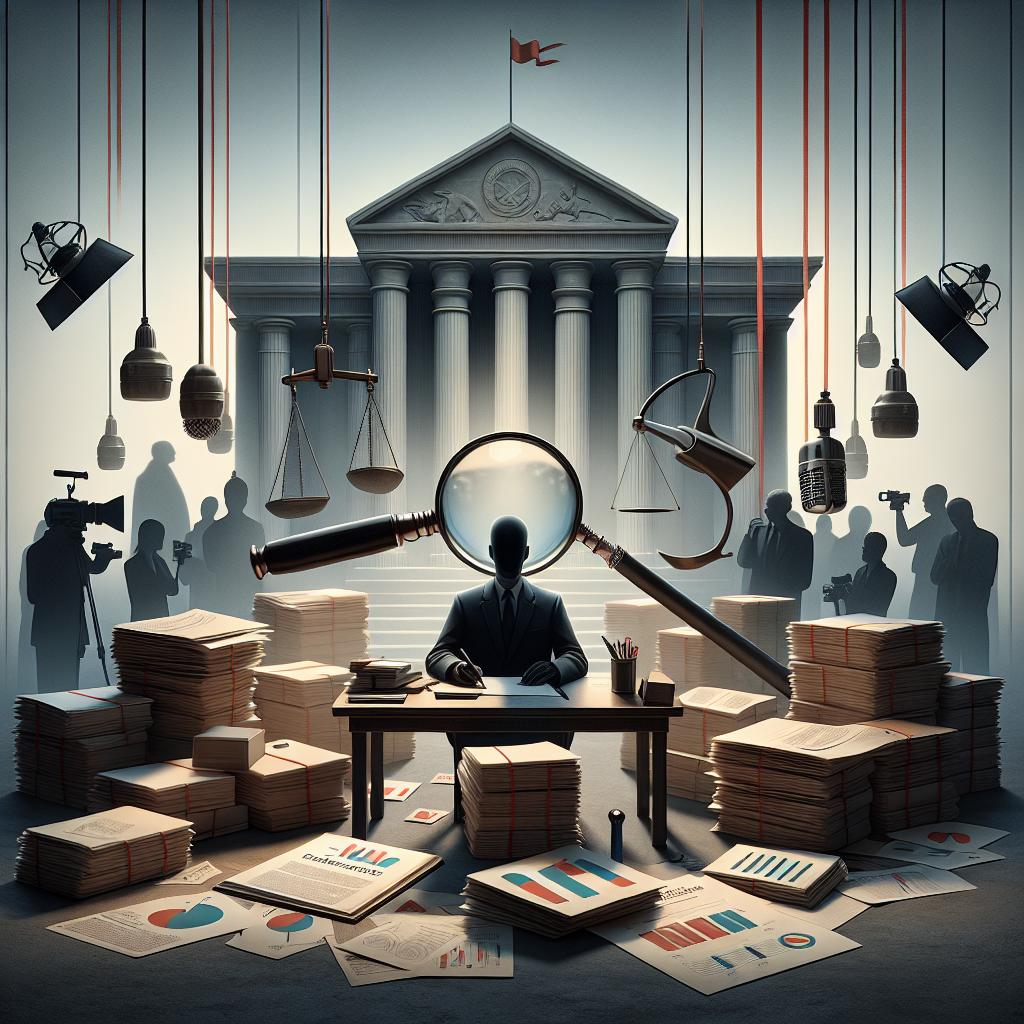« Un moment de folie. » C’est ainsi que Gilles Bastin, directeur adjoint de l’Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble, résume une affaire qui a marqué l’établissement le 4 mars 2021. Ce jour-là, des affiches accusant deux enseignants d’être islamophobes apparaissent sur le campus. L’IEP condamne immédiatement l’action, mais l’affaire ne s’arrête pas là et prend rapidement une dimension publique et polémique.
Chronologie et déroulé des faits
Le 4 mars 2021, des affiches incriminant deux professeurs sont placardées à l’IEP de Grenoble. L’établissement les dénonce et considère l’action comme inacceptable. L’un des enseignants visés, Klaus Kinzler, choisit de porter l’affaire dans l’espace médiatique en intervenant sur plusieurs plateaux, dont celui de CNews.
Lors de ces interventions, M. Kinzler critique l’IEP en des termes forts : il qualifie l’institut d’« institut de rééducation politique » et accuse certains enseignants d’endoctriner les étudiants avec des théories qualifiées de « woke ». Ces propos relancent le débat hors de l’établissement et attirent l’attention d’un public large.
Témoignages et climat sur le campus
Pour les responsables de l’IEP, la situation dérape. Gilles Bastin décrit l’ambiance comme un passage « au centre d’une arène » : l’université, habituée aux débats contradictoires, subit cette fois une virulence nouvelle. Le personnel et les enseignants reçoivent des messages menaçants en grand nombre, selon son témoignage.
La diffusion des interventions de M. Kinzler alimente les réseaux sociaux. Le terme « fachosphère » est employé pour décrire la manière dont certains groupes en ligne se saisissent du dossier. Dans ce contexte, la frontière entre un conflit interne à l’université et une polémique nationale s’est estompée.
Réactions politiques et financières
En décembre 2021, la controverse franchit une étape politique. Laurent Wauquiez, alors président Les Républicains (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dénonce ce qu’il présente comme une « longue dérive idéologique et communautariste » de l’IEP. Il annonce, dans la foulée, la suspension d’une aide régionale destinée à la mobilité internationale des étudiants, d’un montant de 400 000 euros.
Cette décision politique transforme l’affaire en un enjeu public plus large : elle porte atteinte à des financements étudiants et cristallise les critiques contre l’institut. Les motifs invoqués par la région s’inscrivent dans un débat plus vaste sur la neutralité des lieux d’enseignement supérieur et la place des questions identitaires dans les programmes.
Enjeux institutionnels et juridiques
Plusieurs voix estiment que le dossier aurait dû être traité par des procédures internes ou judiciaires, avec enquêtes et éventuelles sanctions adaptées. Plutôt que de suivre cette voie, l’affaire a gagné les médias et les réseaux, ce qui a modifié la trajectoire du conflit et compliqué les réponses institutionnelles.
Du côté de l’IEP, la priorité affichée a été de contenir la situation et de protéger la communauté universitaire. Les interventions médiatiques et les réactions politiques ont néanmoins contribué à déplacer le débat vers des enjeux symboliques et financiers, parfois au détriment d’un traitement factuel et procédural des accusations initiales.
Impact et observations
L’affaire de Grenoble illustre la manière dont un incident local peut devenir, en quelques semaines, un débat national lorsqu’il est relayé par les médias et amplifié sur les réseaux sociaux. Elle montre aussi l’interaction entre discours publics, décisions politiques et conséquences concrètes pour des établissements d’enseignement.
Les éléments rapportés ici se fondent sur les témoignages cités et sur la chronologie des faits tels qu’ils ont été rendus publics : l’apparition des affiches le 4 mars 2021, les prises de parole médiatiques de l’un des enseignants, puis la décision de décembre 2021 du président de région d’interrompre un financement de 400 000 euros. Certaines conséquences et interprétations restent contestées et ont fait l’objet de polémiques publiques.
Ce rappel factuel vise à clarifier la séquence des événements et les enjeux constatés sans présumer des décisions éventuelles prises par la justice ou par les instances disciplinaires, qui relèvent de procédures distinctes et n’entrent pas dans le détail ici.