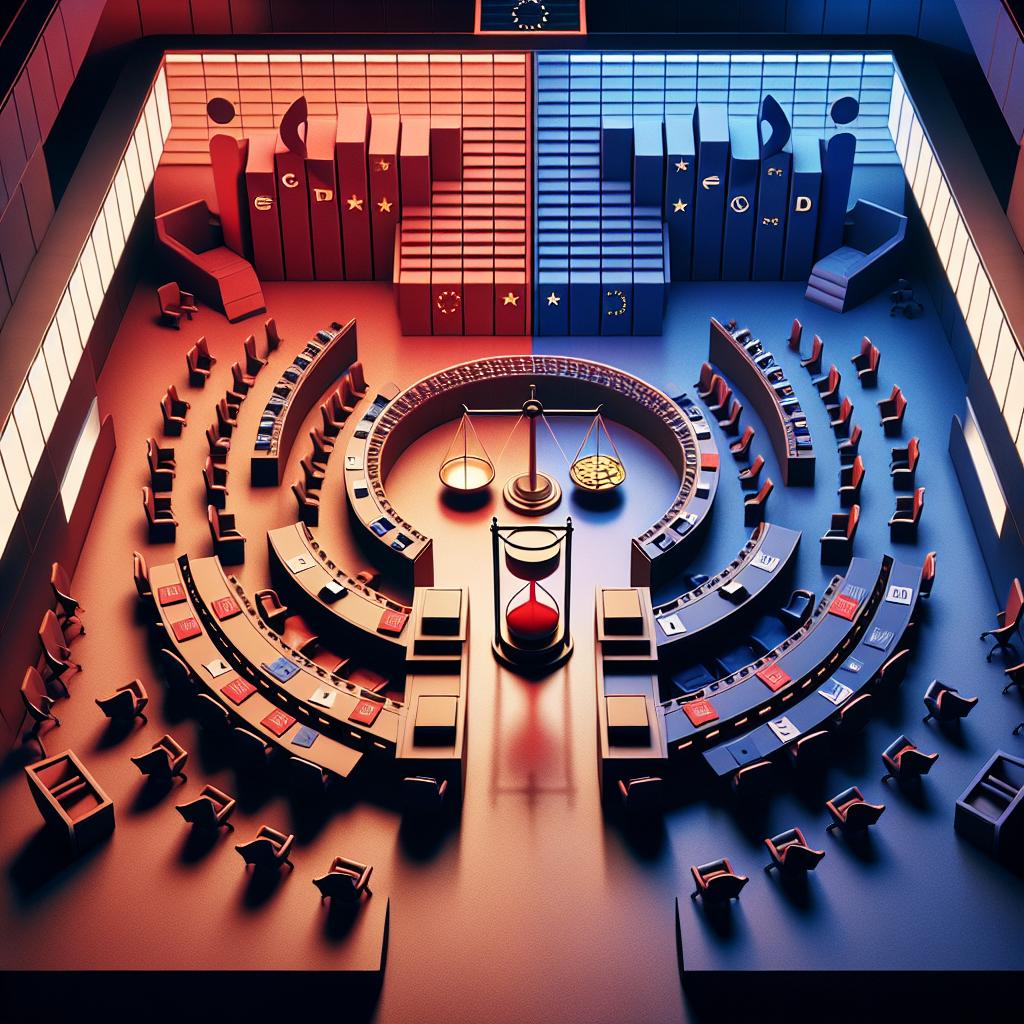Le passage à Paris de Joseph Stiglitz, économiste américain et lauréat du prix Nobel d’économie en 2001, répondait à une mission préparatoire : la rédaction d’un rapport sur les inégalités commandé par la présidence sud-africaine du G20. Sa venue intervient en même temps qu’un débat public et politique vif en France autour de la « taxe Zucman », qui vise les patrimoines à partir de 100 millions d’euros — une mesure que Stiglitz présente comme naturellement justifiée.
Une mission liée au G20 et un calendrier préparé
Selon les éléments communiqués, la visite de Stiglitz était planifiée de longue date dans le cadre du travail demandé par la présidence sud-africaine du G20 sur les inégalités. L’objet du rapport est de fournir des analyses et des recommandations sur la façon de mesurer et de réduire les écarts de richesse à l’échelle internationale. Le contexte français donne toutefois une résonance particulière à son passage : le projet de taxe sur les très grands patrimoines alimente une controverse médiatique et politique, et les propos de l’économiste ont été relayés par Le Monde.
Dans l’entretien cité, daté « mercredi 1er octobre » dans la publication, Stiglitz explicite son point de vue sur la nature et l’ambition de la mesure. Le texte original ne précise pas l’année de cette date ; il s’agit toutefois de la date figurant sur l’entretien publié dans Le Monde.
La taxe Zucman expliquée par Stiglitz
La « taxe Zucman » évoquée dans le débat vise à imposer un prélèvement sur les patrimoines à partir de 100 millions d’euros. Interrogé sur la nature de cet impôt, Joseph Stiglitz l’a décrit comme « une taxe très conservatrice, pas du tout radicale ». Il a illustré son raisonnement par un calcul simple : si un milliardaire ne réalise pas un rendement annuel de, disons, 10 % par an, alors un prélèvement de 2 % sur son patrimoine revient, en proportion du rendement, à taxer ce revenu annuel à hauteur de 20 %.
Concrètement, l’idée est la suivante : pour un capital placé générant un rendement annuel de 10 %, une taxe patrimoniale annuelle de 2 % représente 2 points sur le capital, soit l’équivalent de 20 % du revenu tiré de ce capital (2 / 10 = 0,2). Stiglitz précise que ce niveau d’imposition est courant dans plusieurs juridictions à travers le monde, laissant entendre que la mesure n’appellerait pas de rupture radicale avec les pratiques existantes.
Coopération internationale et risque de départ des fortunes
La question de la mise en œuvre unilatérale d’une telle taxe en France revient fréquemment dans le débat public : une taxation nationale forte ne conduirait-elle pas à l’exil fiscal des très fortunés ? Interrogé sur ce point, Stiglitz répond : « Non. Il n’y a pas besoin d’un accord mondial. La France peut la mettre en place seule, ça en ferait même un leader à suivre. »
Il ajoute que, selon lui, les études existantes sur les impôts sur la fortune indiquent une réalité nuancée : l’instauration de tels prélèvements peut entraîner des départs de capitaux ou de contribuables aisés, mais ces mouvements semblent, d’après ces analyses, limités en ampleur. Le texte original évoque un « départ réel, mais faible, des grandes fortunes », sans détailler ici les travaux cités ni leurs méthodologies.
Cette position place la France dans une posture possible de pionnier politique : appliquer un impôt sur les patrimoines très importants sans attendre un consensus international, tout en s’appuyant sur des études qui, selon Stiglitz, n’identifient pas de fuite massive des capitaux.
La visite de Joseph Stiglitz a donc croisé deux enjeux : la préparation d’un rapport destiné au G20 sur les inégalités et la contribution au débat national français sur la fiscalité des très grands patrimoines. Les propos cités proviennent de l’entretien publié par Le Monde, mentionné dans le compte rendu initial, et portent des éléments chiffrés et des arguments que l’économiste a proposés lors de sa prise de parole.