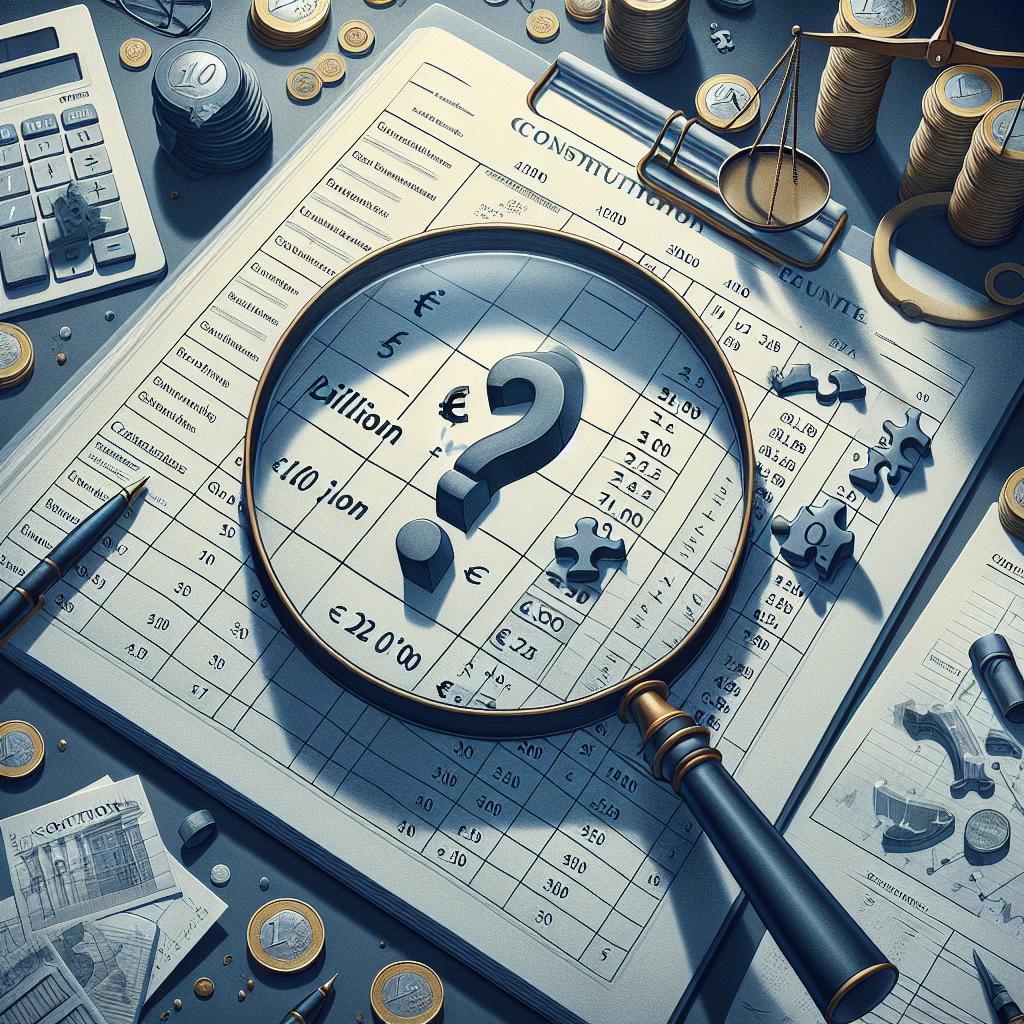En tête du cortège, une large banderole énumérait des mots jugés à défendre : « climat », « biodiversité », « justice sociale », « paix », « libertés ».
Autour du premier char, un grand drap noir portait des inscriptions telles que « écocide », « sexisme », « grossophobie », « racisme », « génocide ». Au-dessus des premières lignes flottaient des effigies de personnalités vivement contestées par les manifestants : Marine Le Pen, l’homme d’affaires Vincent Bolloré, le patron de Total Patrick Pouyanné et le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.
La manifestation, présentée sous le nom de « Marche des résistances », s’est tenue dimanche 28 septembre à Paris, le long d’un parcours allant de la Gare du Nord à la place de la République. Gabriel Mazzolini, activiste des Amis de la terre et visage connu des grandes marches pour le climat de 2018 à 2022, a pris la parole au micro. Il a rappelé la longue absence de mobilisation de rue : « Ça faisait trois ans qu’on n’avait pas repris la rue comme ça », puis a entraîné la foule sur un slogan anciennement adopté par le mouvement : « On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. »
Une remise à l’agenda politique
Organisée par quatre collectifs — 350.org, Les Amis de la terre, Action justice climat et Alternatiba — et rassemblant des centaines d’associations en majorité issues du mouvement environnemental, la journée visait à replacer la question écologique au cœur du débat politique. Les enjeux affichés mêlaient préoccupations environnementales et revendications sociales, comme le laissaient entendre les mots d’ordre en tête de cortège.
Les organisateurs ont revendiqué « près de 70 marches » ayant mobilisé 40 000 personnes sur l’ensemble du territoire français, dont 25 000 à Paris. Ces chiffres, avancés par les collectifs, visent à mesurer une dynamique collective après des années d’attention médiatique et militante fluctuante.
Des chiffres contrastés selon les sources
Sur le terrain, l’affluence a toutefois varié fortement d’une ville à l’autre. L’AFP a comptabilisé, pour sa part, 700 personnes à Lyon et 300 à Strasbourg. Ces décomptes illustrent l’écart fréquent entre chiffres communiqués par les organisateurs et observations policières ou médiatiques, sans permettre d’établir un bilan définitif à l’échelle nationale.
La différence entre les chiffres revendiqués et ceux relevés par les agences traduit aussi la difficulté de mesurer précisément des mobilisations réparties sur de nombreux départements et espaces urbains. Les organisateurs estiment souvent le nombre de participants sur la base de déclarations locales agrégées, tandis que les comptes d’agences reposent sur des observations ponctuelles.
Un contexte transformé depuis les grandes mobilisations précédentes
En six ans, le contexte politique et social a évolué. Le retour de la guerre en Europe, l’inflation persistante et la progression des courants populistes dans plusieurs pays occidentaux ont relégué, pour certains publics et décideurs, l’action climatique au second plan. Ces éléments structurants expliquent en partie la difficulté à retrouver, partout, le niveau de mobilisation observé lors des grandes marches pour le climat entre 2018 et 2022.
Pour les organisateurs, cette journée devait cependant marquer une reprise. Elle cherchait à rappeler que la crise écologique demeure un enjeu transversal, lié aux questions de justice sociale et de libertés. Les messages affichés lors de la marche témoignent de cette volonté de lier la défense de l’environnement à d’autres combats sociétaux.
Sur le parcours parisien, la tonalité de la manifestation mêlait moments de rassemblement festif et slogans revendicatifs. Les effigies et les drapeaux, tout comme les revendications inscrites sur les banderoles, visaient à interpeller aussi bien l’opinion publique que les responsables politiques et économiques.
Si la mobilisation a pris des formes différentes selon les territoires, la Marche des résistances témoigne d’une tentative coordonnée du mouvement climat pour se réaffirmer dans l’espace public. Les chiffres divergent selon les sources, mais le message des organisateurs est resté centré sur l’urgence écologique et la nécessité d’en faire une priorité politique.