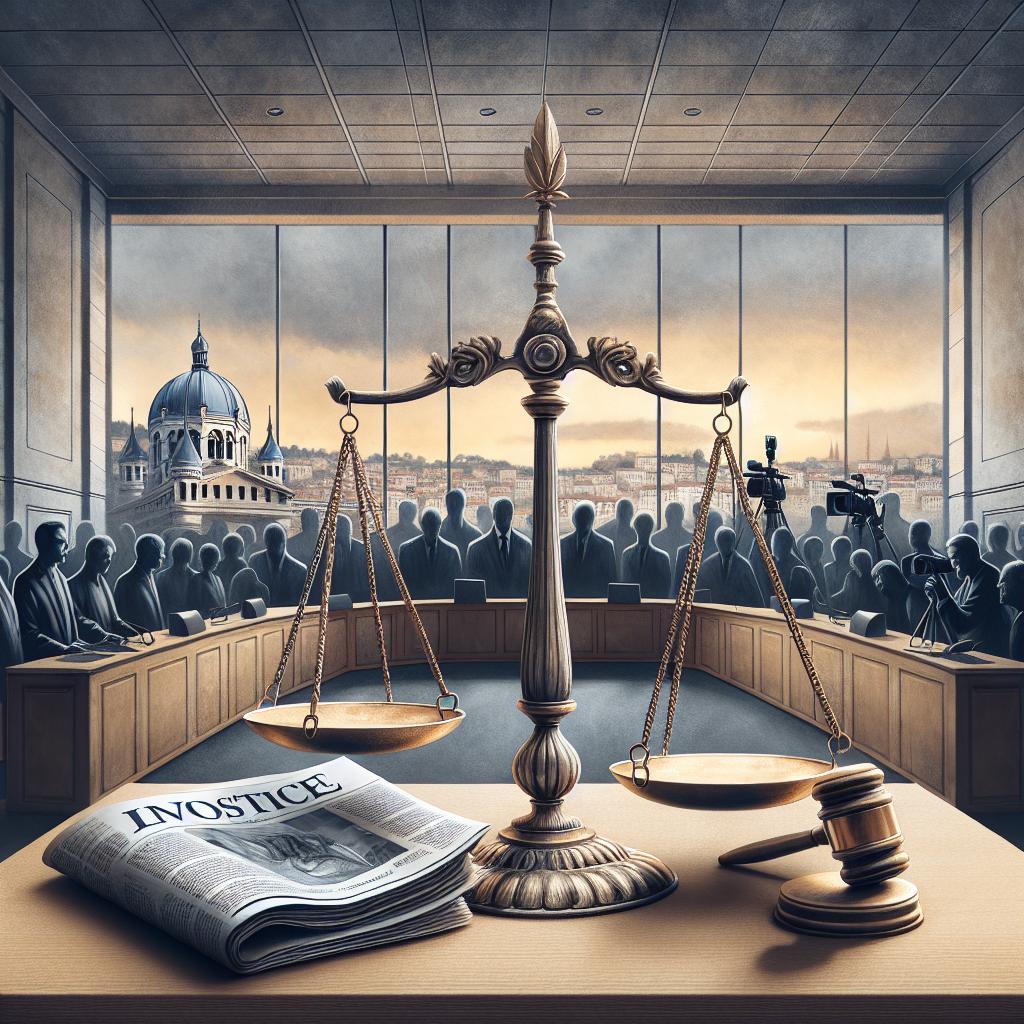Entre 175 000 (selon le gouvernement) et 250 000 participants (selon la CGT), 812 actions recensées dont 550 rassemblements et 262 blocages, 540 interpellations et 415 gardes à vue : au‑delà des chiffres, que retenir des mobilisations du 10 septembre ? Nos journalistes, présents sur le terrain, ont répondu aux questions lors d’un tchat le jeudi 11 septembre.
Un décompte difficile et des rassemblements éclatés
Le comptage des manifestants reste délicat. Il est aisé de chiffrer un cortège qui va d’un point A à un point B, mais bien plus compliqué lorsque le mouvement est dispersé et souvent spontané, comme lors de la première grande vague des « gilets jaunes ». À Paris, au petit matin, des rassemblements ont été observés simultanément porte de Montreuil (environ 500 personnes selon une estimation non scientifique), porte de la Chapelle, porte d’Ivry, porte d’Italie, devant le lycée Hélène‑Boucher (20e arrondissement), ainsi que dans plusieurs dépôts de la RATP. Il était impossible pour les équipes de couvrir et de compter chaque point de mobilisation.
Si l’on ne peut parler d’une mobilisation historique en nombre, la multiplication de points de rassemblement, dans des petites villes comme dans les métropoles, n’est pas anecdotique pour un mouvement peu structuré et lancé au début de septembre, en semaine.
Occupations, blocages et réponse policière
À la connaissance des journalistes sur place, aucun lieu symbolique n’est resté durablement bloqué ou occupé à l’échelle nationale. En revanche, des appels à assemblées générales et à réunions « pour préparer la suite » circulent, avec en point de mire l’appel intersyndical à la mobilisation nationale du 18 septembre.
Les forces de l’ordre sont intervenues rapidement sur plusieurs sites pour débloquer dépôts de bus et portes du périphérique. À la gare du Nord, où une assemblée générale était prévue à 11 heures, les autorités ont restreint l’accès au bâtiment et à ses abords afin d’éviter qu’« une situation s’enkyste », expression reprise par le ministre des Transports. À Nice, la gare a été barricadée pendant plus de deux heures pour empêcher toute occupation, entraînant des retards de trains allant parfois jusqu’à trois heures et des voyageurs restés sur le parvis.
L’usage de drones par les forces de l’ordre s’est généralisé, y compris sur des barrages filtrants en zone rurale. Les forces sur le terrain ont décrit cet emploi comme relevant désormais du « protocole ». Le nombre exact de drones déployés n’a pas pu être exhaustivement compté, mais leur utilisation a été qualifiée de massive, souvent autorisée par des arrêtés préfectoraux.
Motivations des manifestants et héritage des « gilets jaunes »
Les manifestants invoquent plusieurs raisons pour sortir des formes traditionnelles d’action. Beaucoup pointent l’inefficacité des 14 journées de mobilisation dispersées sur six mois, en 2023, contre la réforme des retraites, qui a abouti à l’usage du 49.3. Ils estiment que ces actions « ne font pas peur au pouvoir » et recherchent des formes d’action moins prévisibles.
Le souvenir et la méthode des « gilets jaunes » restent présents. Dans le Var, par exemple, on a noté le retour de ronds‑points occupés et aménagés pour durer (tables en palettes, coins pour se restaurer). La reconstitution de canaux de communication, notamment via Telegram, participe à l’effort d’organisation et à la volonté de maintenir une présence sur certains axes routiers.
Le ressenti d’injustice sociale est central. La colère porte sur la montée des inégalités, la dégradation des services publics et la perception d’une déconnexion de la classe politique. Le projet de budget porté par François Bayrou durant l’été a été perçu par certains comme une provocation, la suppression de deux jours fériés étant citée comme un élément particulièrement symbolique susceptible de déclencher des actions.
Différences locales, incidents et récits de terrain
Les mobilisations varient fortement selon les territoires. À Rennes, la manifestation a rassemblé entre 10 000 et 15 000 personnes dans une ville d’environ 220 000 habitants. Le cortège principal s’est déroulé sans heurt, mais des débordements ont eu lieu à l’aube : des groupes se réclamant de la mouvance black bloc ont bloqué la rocade, un bus a été incendié et des barricades ont été dressées dans le centre‑ville, provoquant des affrontements avec les forces de l’ordre et un épais brouillard de lacrymogènes durant plusieurs heures.
Sur les barrages en zone rurale, la diversité des affiliations politiques a été notable : souverainistes, militants de La France Insoumise et autres se côtoyaient. La sympathie des passants et des automobilistes pour les manifestants a été plus perceptible qu’en 2018, certains conducteurs coupant leur moteur ou remerciant les personnes présentes.
Les équipes de reporters ont cherché à relater ces mouvements avec prudence, en évitant l’effet‑spectacle et en vérifiant les informations transmises depuis les assemblées générales ou les points de blocage. Les images de violence, quand elles existent, sont replacées dans leur contexte afin de conserver l’équilibre entre description des incidents et restitution des revendications.
Enfin, syndicats et responsables locaux réfléchissent à la manière de transformer ces mobilisations éparses en actions durables, tout en sachant combien il est difficile d’engager des salariés à perdre une journée de salaire. La dynamique observée laisse augurer une semaine de tensions et d’interpellations, avec un rendez‑vous national prévu le 18 septembre par l’ensemble des syndicats.