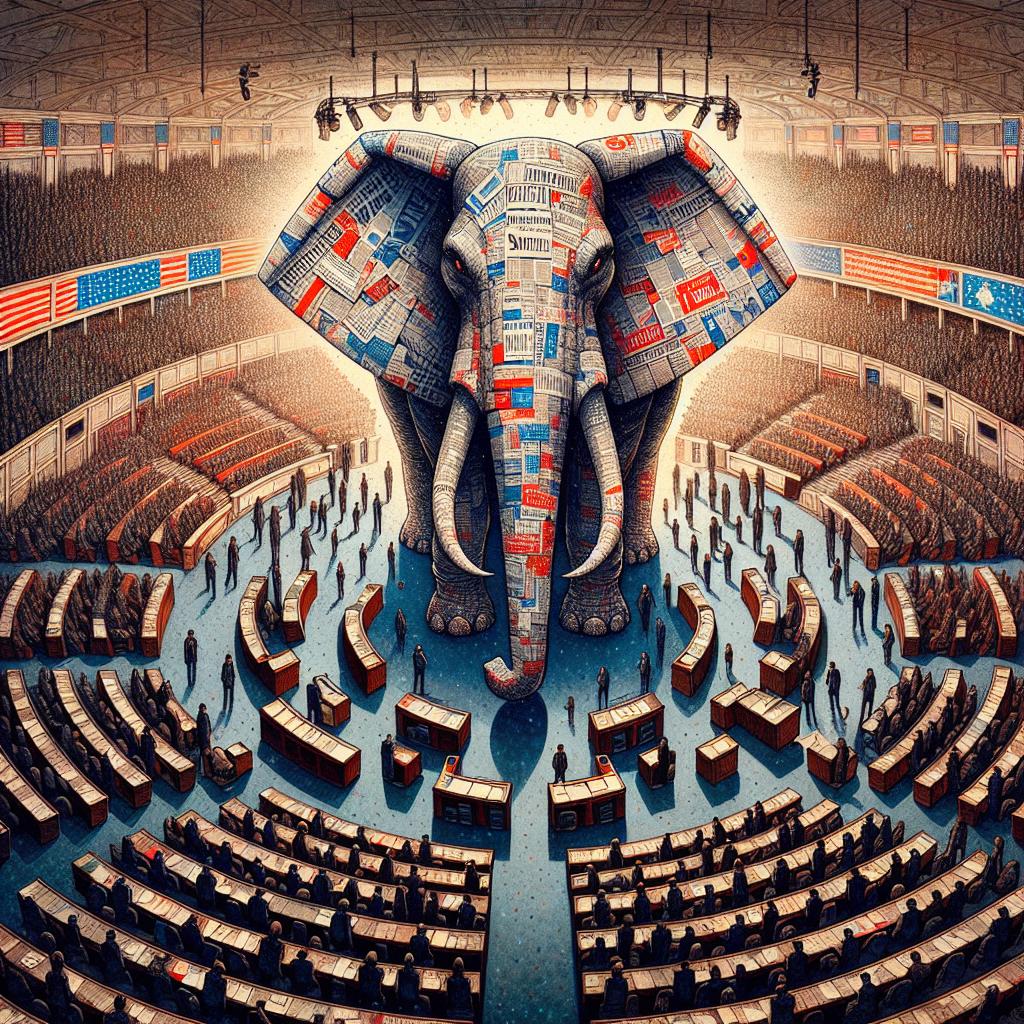Une note de l’Institut des politiques publiques (IPP), publiée mardi 4 novembre et consultée par Le Monde, relance le débat sur l’usage massif des ruptures conventionnelles dans les entreprises françaises. Le document examine, entre autres, la part des licenciements qui ont été remplacés par ce mécanisme, l’un des objectifs initiaux de la procédure.
Cette parution intervient alors que le dispositif est au centre des discussions entre l’exécutif et les partenaires sociaux. Les ruptures conventionnelles font l’objet de vifs débats depuis plusieurs mois et pourraient devenir le point central des prochaines négociations sur l’assurance‑chômage.
Les chiffres essentiels
Selon la note de l’IPP, en 2024 environ 515 000 contrats à durée indéterminée (CDI) ont pris fin par rupture conventionnelle. Ce chiffre se situe à près de 200 000 de plus qu’il y a une décennie, ce qui témoigne d’une progression soutenue du recours à ce dispositif.
La note précise également que, depuis 2021, entre 15 % et 18 % des CDI se terminent par une rupture conventionnelle. Ces proportions montrent que la procédure n’est plus marginale mais s’est installée comme une modalité fréquente de séparation entre employeurs et salariés.
Enjeux politiques et calendrier des négociations
Le recours aux ruptures conventionnelles se retrouve au cœur des discussions engagées autour des règles d’indemnisation de l’assurance‑chômage, une négociation lancée en août par François Bayrou, mentionné dans le texte consulté comme « alors premier ministre ». Les contours et la prégnance de ces pourparlers ont évolué depuis, mais la note de l’IPP arrive à un moment où le gouvernement, représenté selon le texte par le nouveau chef du gouvernement Sébastien Lecornu, pourrait demander aux organisations syndicales et patronales de concentrer les échanges sur ce seul sujet.
La focalisation attendue sur les ruptures conventionnelles traduit la volonté d’examiner non seulement leur utilisation quantitative mais aussi leurs conséquences économiques et sociales, notamment en matière d’accès aux allocations chômage et de prévention des contentieux.
Objectifs initiaux et effets observés
Créée en 2008, la rupture conventionnelle répondait à plusieurs objectifs explicites. D’un côté, elle visait à réduire le nombre de litiges portés devant les conseils de prud’hommes en proposant une procédure amiable pour mettre fin au CDI. De l’autre, elle devait faciliter les transitions professionnelles en rendant les salariés concernés immédiatement éligibles à l’allocation‑chômage.
Les chiffres cités par l’IPP suggèrent que ces objectifs ont conduit à un usage croissant du dispositif. En pratique, le développement des ruptures conventionnelles peut limiter les ruptures conflictuelles et accélérer l’accès aux droits pour certains salariés. Reste à mesurer précisément si, dans tous les cas, ces effets coexistent avec une protection suffisante pour les personnes concernées.
La note interroge aussi implicitement la manière dont ce mécanisme se substitue à des licenciements formels : l’analyse porte sur la part des fins de contrat « remplacées » par une rupture conventionnelle, c’est‑à‑dire sur l’utilisation du dispositif dans des situations qui auraient pu relever d’autres motifs de rupture.
Cette interrogation est au cœur des tensions actuelles, qui opposent d’un côté la volonté de fluidifier le marché du travail et, de l’autre, la nécessité de préserver les droits individuels et collectifs des salariés.
En l’état, la note de l’IPP fournit des repères chiffrés destinés à éclairer les débats. Elle ne tranche pas à elle seule les questions normatives et politiques qu’entraînent l’extension du recours à la rupture conventionnelle, mais elle alimente les discussions sur les réformes possibles et sur les priorités que les autorités et les partenaires sociaux décideront d’adopter.
Les prochains mois devraient permettre de savoir si les conclusions et les chiffres mis en avant par l’IPP influeront sur la stratégie du gouvernement et sur le contenu des négociations avec les organisations syndicales et patronales.