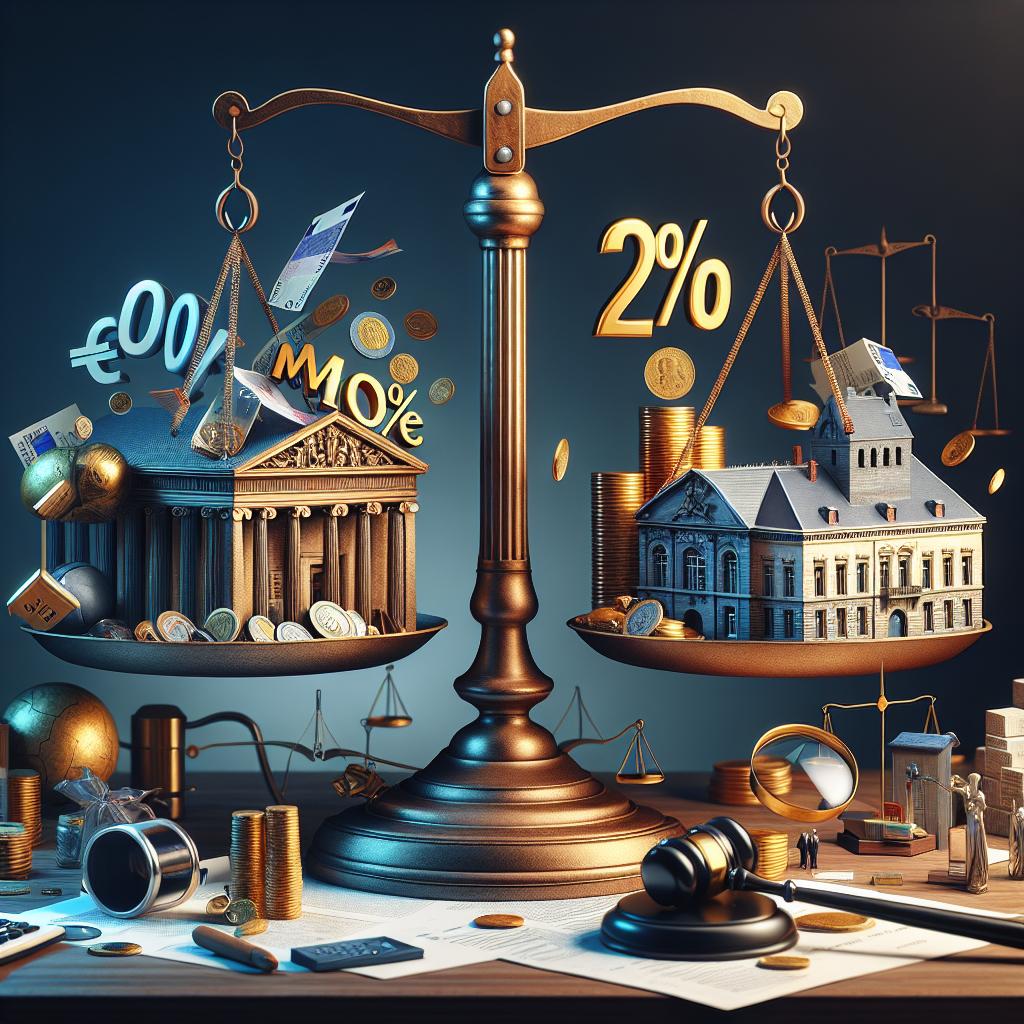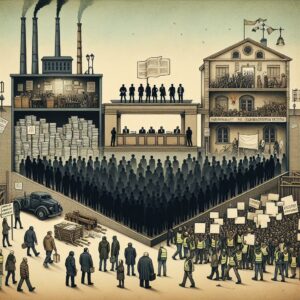Gabriel Zucman, économiste français et professeur à l’université de Californie, Berkeley, ainsi qu’à l’École d’économie de Paris, est à l’origine d’un projet de taxation ciblant les très hauts patrimoines, communément appelé « taxe Zucman ». Le principe central est simple : appliquer un prélèvement annuel de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros.
Le mécanisme proposé
La proposition vise exclusivement les fortunes dépassant le seuil de 100 millions d’euros, qui seraient assujetties à un impôt forfaitaire de 2 % par an. Dans les présentations publiques de l’économiste, cette formule est pensée comme un outil redistributif visant à limiter la concentration extrême du patrimoine et à augmenter les recettes publiques destinées aux dépenses collectives.
Techniquement, la taxe se calculerait sur la valeur nette du patrimoine détenu par chaque foyer ou contribuable au-delà du seuil fixé. Le texte initial et les débats qui l’entourent insistent sur la simplicité apparente du taux unique, mais la mise en œuvre pratique suppose des évaluations précises des actifs, en particulier pour les participations non cotées et les biens immobiliers.
Estimations de recettes et incertitudes
Les soutiens de la taxe, parmi lesquels figurent plusieurs partis et mouvements de gauche, avancent une fourchette d’entrées budgétaires comprise entre 10 et 25 milliards d’euros par an si la mesure était appliquée en France. Cette estimation reflète l’importance concentrée des patrimoines au sommet de la distribution, mais elle dépend fortement des modalités d’assiette, des exemptions éventuelles et du comportement des redevables.
Ces chiffres restent des projections. Ils varient selon les hypothèses retenues pour l’évaluation des actifs et pour l’anticipation des réactions des contribuables concernés. Des fuites de capitaux, des ventes d’actifs ou des stratégies d’optimisation fiscale peuvent réduire le rendement effectif de la taxe par rapport aux prévisions initiales.
Arguments des opposants
Les opposants mettent en avant plusieurs risques potentiels. Ils estiment que l’introduction d’une telle taxe pourrait fragiliser l’attractivité du territoire pour les personnes très fortunées et, par ricochet, pour l’investissement privé. Certains craignent que des propriétaires de grandes participations vendent des parts d’entreprises françaises à l’étranger ou procèdent à des délocalisations de capitaux et d’activités pour échapper à l’impôt.
Par ailleurs, la constitutionnalité de la mesure est contestée par une partie du monde académique et économique. Des économistes et juristes soulignent que l’encadrement légal, les principes d’égalité devant l’impôt et les règles européennes pourraient poser des obstacles à l’instauration d’un impôt aussi ciblé. Ces objections juridiques devront être précisées si la proposition devait être formalisée dans un texte de loi.
Un débat public et médiatique
La « taxe Zucman » est devenue un sujet clivant du débat public, opposant logiques redistributives et préoccupations liées à la compétitivité. Les échanges portent autant sur l’efficacité redistributive attendue que sur les conséquences économiques et juridiques potentielles.
Pour approfondir le propos, Le Monde a publié une interview de Gabriel Zucman menée par Denis Cosnard et Pascal Riché. Par ailleurs, la proposition et ses enjeux ont été expliqués dans une vidéo de la série « Comprendre en trois minutes », produite par le service Vidéos verticales du Monde. Ces vidéos, diffusées notamment sur TikTok, Snapchat, Instagram et Facebook, visent à remettre en contexte des événements majeurs dans un format court et accessible.
Au-delà des chiffres et des arguments, le débat souligne la difficulté de concilier justice fiscale, stabilité juridique et attractivité économique. Toute décision publique sur ce sujet impliquerait un arbitrage politique marqué et des choix techniques précis pour éviter des effets d’aubaine ou des contournements juridiques.
Le projet de taxe porté par Gabriel Zucman illustre la montée des propositions fiscales visant les très hauts revenus et patrimoines en réaction à l’accroissement des inégalités. Sa mise en œuvre resterait, en pratique, sujette à de nombreuses négociations techniques, juridiques et politiques avant de pouvoir produire des effets mesurables.