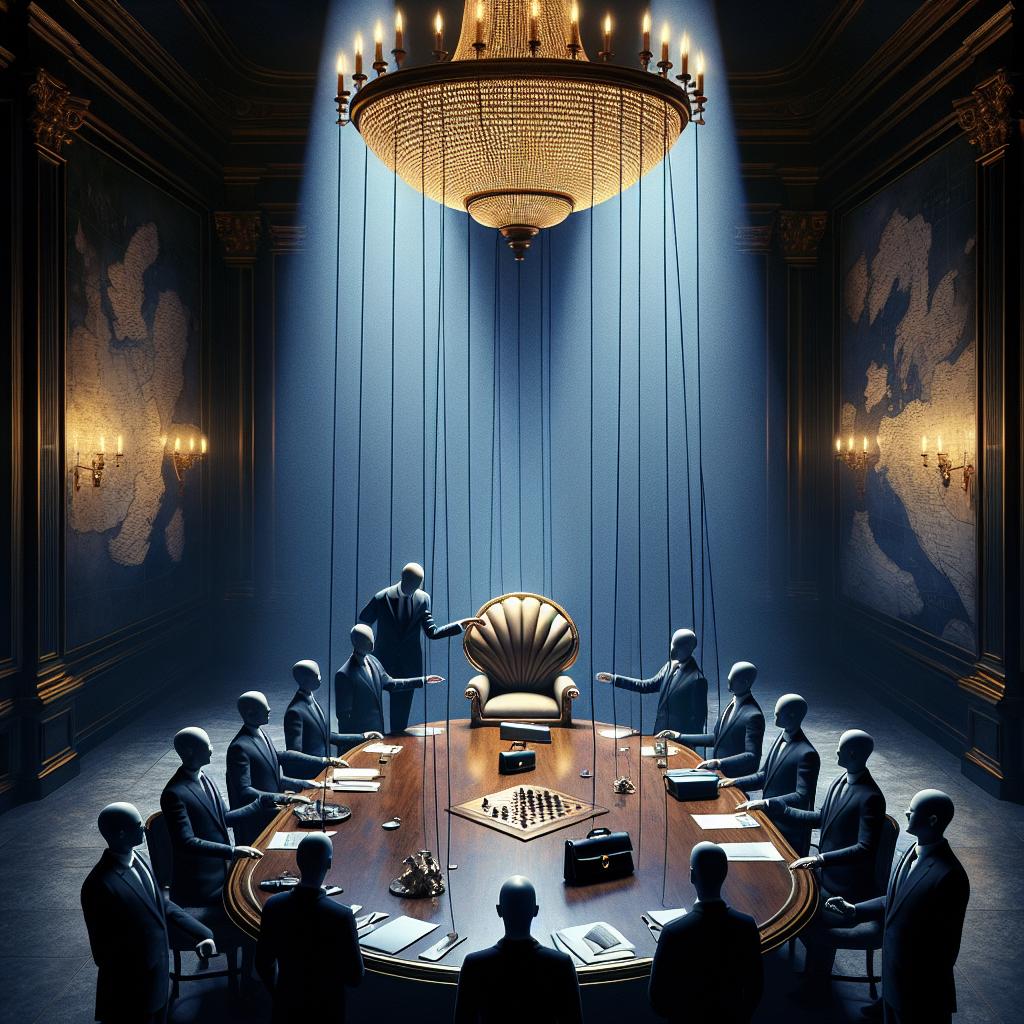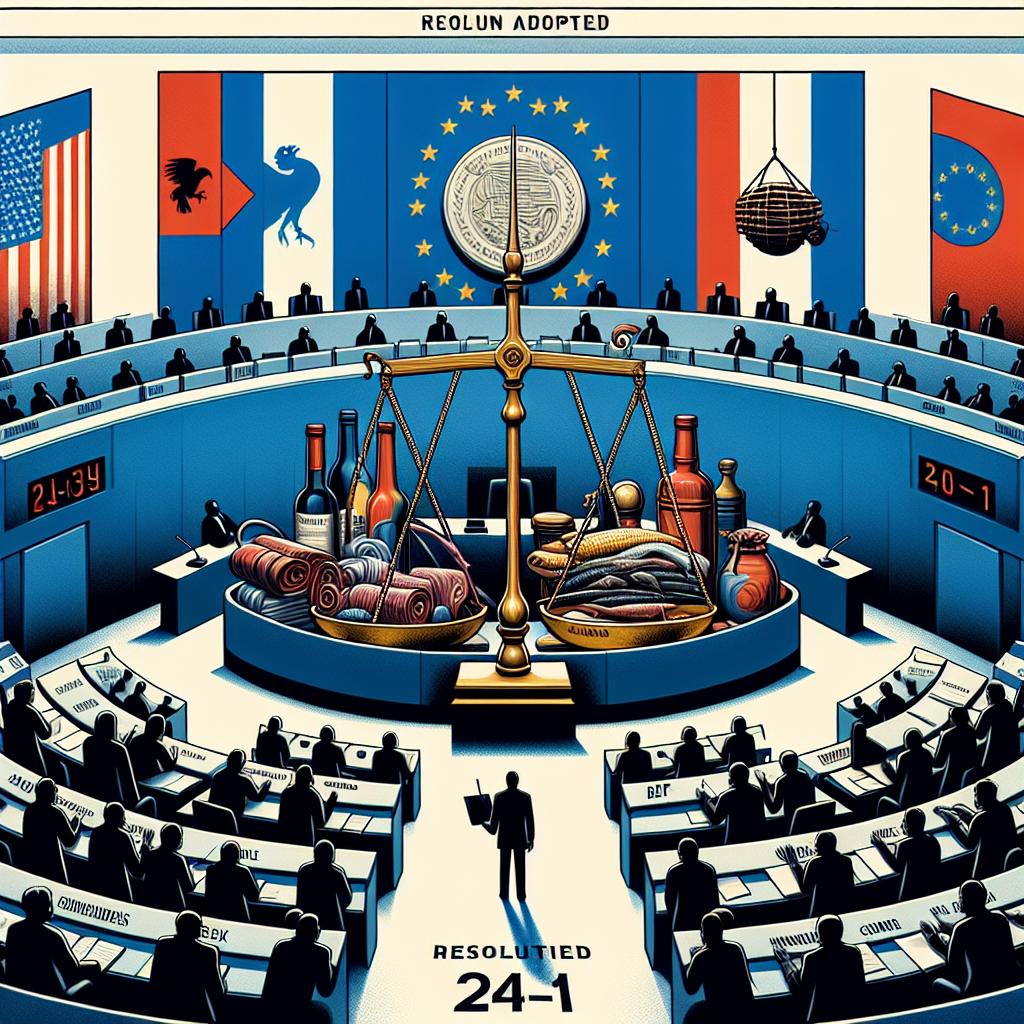Le constat se confirme. Trois mois après un rapport de la Cour des comptes, le comité scientifique chargé d’évaluer l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée a présenté, mardi 23 septembre, son bilan provisoire. Les conclusions dressent un double constat : le dispositif facilite le retour à l’emploi de personnes durablement éloignées du marché du travail, mais il mobilise des moyens publics importants.
Un mécanisme ciblé et encadré
Territoires zéro chômeur de longue durée s’adresse à de petits territoires volontaires, limités à 10 000 habitants. L’idée est de coordonner des actions locales pour proposer des contrats à durée indéterminée au sein d’une « entreprise à but d’emploi » (EBE). Cette entreprise embauche sans procéder à une sélection traditionnelle des candidats et doit veiller à ne pas concurrencer les entreprises déjà implantées sur le territoire.
Instaurée en 2016 puis prolongée en 2020, l’expérimentation concerne, fin 2024, 83 territoires. Sur ces territoires, 86 entreprises à but d’emploi employaient 3 290 personnes. Le dispositif est programmé pour s’achever en 2026 : à cette date, le Parlement devra se prononcer sur une éventuelle généralisation du dispositif.
Des effets positifs reconnus
Le rapport du comité scientifique, présidé par l’économiste Yannick L’Horty, rappelle d’abord la logique qui a présidé à la création du programme : la conviction que « personne n’est inemployable ». Les auteurs notent que l’expérimentation « est parvenue à produire des effets positifs, globalement remarquables ». Ces effets concernent surtout l’amélioration de l’accès à l’emploi pour des personnes très éloignées du travail, pour lesquelles les solutions classiques de retour à l’emploi peinent parfois à être efficaces.
Concrètement, plusieurs territoires montrent une insertion durable des salariés recrutés en CDI au sein des EBE, avec des activités adaptées aux besoins locaux. Le modèle mise sur une trajectoire d’emploi renforcée plutôt que sur des mesures ponctuelles, ce qui explique en partie les résultats positifs relevés par le comité.
Un coût public significatif
Le second volet du bilan souligne un coût important pour les finances publiques. Le groupe de chercheurs note des « effets parfois moins désirables, au prix d’un effort public significatif ». Le rapport compare le coût du dispositif aux dépenses publiques associées au chômage de longue durée, partant du principe que l’emploi financé par l’Etat peut être moins coûteux que l’absence d’emploi pour la collectivité. Malgré cela, l’expérimentation exige des moyens substantiels pour fonctionner et se développer.
Plusieurs éléments expliquent cette dépense : subventions de démarrage, financement des salaires lorsque l’activité économique est faible, et accompagnement renforcé des personnes recrutées. Le comité scientifique met en garde contre l’idée que la réussite locale se traduise automatiquement par une solution peu coûteuse à l’échelle nationale.
Enfin, les auteurs relèvent que certaines adaptations du dispositif ont été nécessaires, et que la diversité des situations locales rend difficile une généralisation uniforme sans ajustements. Le rapport ne préconise pas de solution unique et appelle à examiner les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être étendue sans générer des coûts disproportionnés.
À l’approche de la fin de l’expérimentation, la décision reviendra au Parlement. Les conclusions du comité scientifique alimenteront les débats politiques sur l’opportunité d’une extension du dispositif, sur ses modalités de financement et sur les garde-fous à instaurer pour limiter les effets indésirables.
Le bilan présenté le 23 septembre apporte un éclairage important pour ces discussions : il confirme l’efficacité sociale du programme dans certains contexts, tout en signalant la nécessité d’une réflexion approfondie sur sa soutenabilité financière et sur les conditions d’une éventuelle généralisation.