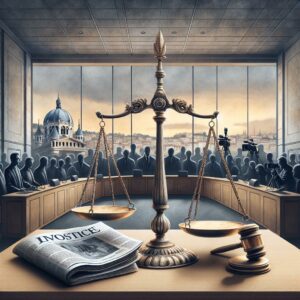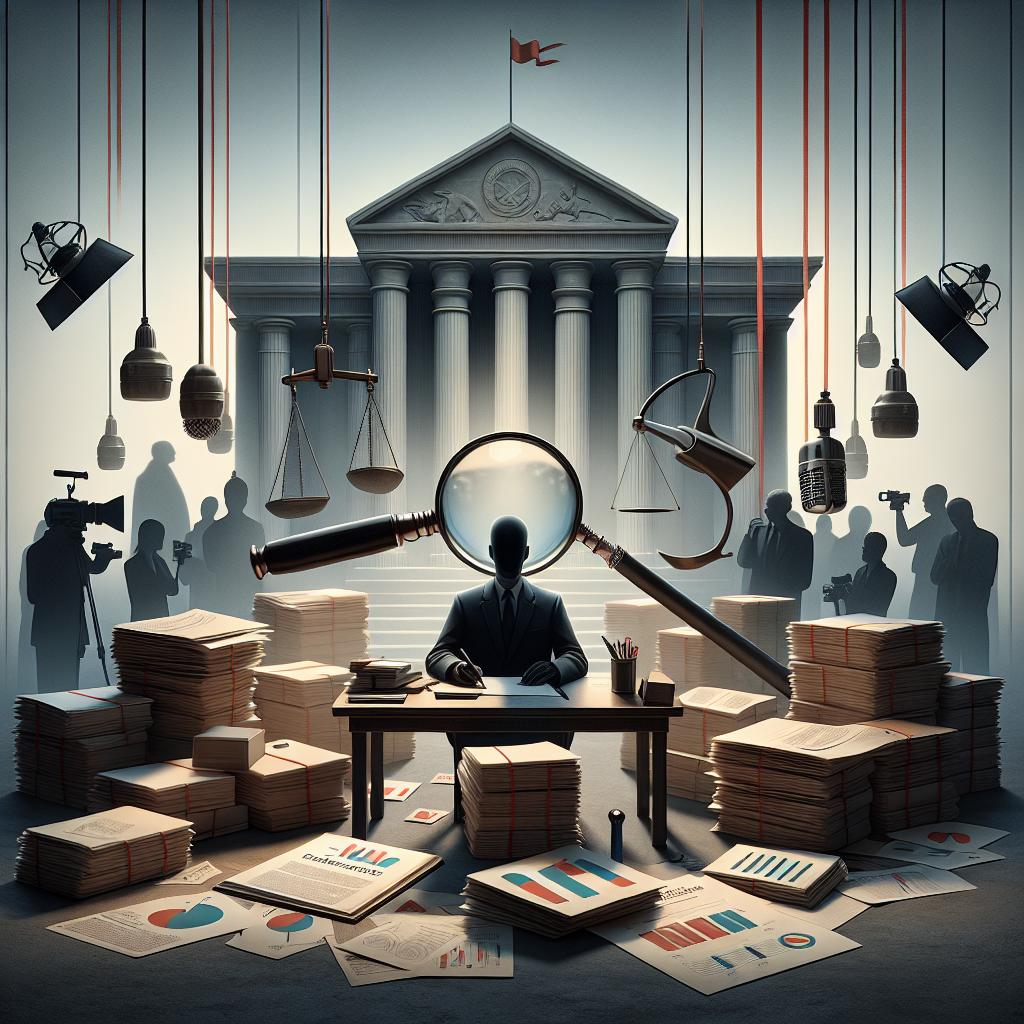À tous les échelons de la vie politique locale et nationale, les sondages se multiplient et s’imposent comme un instrument de décision. À quatre mois des élections municipales, les acteurs interrogent l’« opinion » locale pour choisir les têtes de liste, valider des alliances ou orienter des stratégies de campagne.
Depuis 2024, les enquêtes sur les intentions de vote pour la présidentielle de 2027 circulent abondamment, même si les contours exacts des candidatures restent flous. En octobre, la commission des sondages a recensé douze enquêtes électorales publiées sur les municipales, dont huit avaient été commandées par des parties prenantes — mairie sortante, candidats ou partis. Elle a par ailleurs relevé six sondages consacrés aux législatives et deux autres à l’élection présidentielle.
Les usages politiques des sondages
Les partis et candidats utilisent les sondages pour des fins variées : départager des prétendants, calibrer des alliances ou tester des messages auprès de segments précis de l’électorat. À l’approche d’un scrutin local, ces mesures d’opinion servent aussi à bâtir des stratégies tactiques et à convaincre des soutiens internes ou externes.
Pour les campagnes municipales, la donnée locale devient une référence pratique. Les commanditaires — équipes municipales sortantes, bureaux de campagne ou formations politiques — recourent aux études pour affiner les listes et répartir les priorités. Le recours massif aux sondages traduit une évolution des pratiques internes aux partis, où l’appoint d’une « mesure » peut compléter ou concurrencer les procédures statutaires d’investiture.
Une banalisation pointée par les chercheurs
La dépendance aux sondages n’est pas nouvelle. Déjà en 2006, l’universitaire Alain Garrigou soulignait dans L’Ivresse des sondages (La Découverte) que l’outil sondagier était « devenu d’une grande banalité », servant à la fois de complément et de concurrent aux règles partisanes. Sa formule reste pertinente pour décrire la situation actuelle : dans de nombreuses campagnes, les acteurs politiques paraissent désormais incapables de se passer de l’« onction » fournie par ces études.
Ce constat académique éclaire la normalisation progressive d’un instrument initialement présenté comme informatif. Les sondages, conçus pour mesurer l’opinion, acquièrent une dimension performative quand leurs résultats modifient directement les comportements des décideurs.
La pression pour produire des chiffres fréquents s’accompagne d’une diversification des objectifs : au-delà des intentions de vote, les études sondent désormais « les climats, les bilans et les projets municipaux », domaines au cœur des enjeux locaux et sensibles à l’opinion publique.
Encadrement légal et signaux d’alerte
Face à cette multiplication, la commission des sondages a relevé en mars une « augmentation du nombre des sondages sur les climats, les bilans et les projets municipaux ». Elle en a déduit que la réalisation de tels sondages prenait une connotation électorale plus marquée à l’approche des élections municipales de 2026, et que ces enquêtes entraient par conséquent dans le champ de la loi de 2016 encadrant la publication des sondages.
Le rappel du cadre juridique souligne deux réalités : d’une part, la transparence des méthodes et des commandes devient une question publique; d’autre part, la régulation vise à limiter les effets potentiellement distorsifs d’une diffusion massive d’indicateurs d’opinion non contextualisés.
La loi de 2016 impose des exigences de transparence sur la publication des sondages — mention des commanditaires, des instituts, de la marge d’erreur et de la méthode — afin que les résultats puissent être interprétés avec prudence. La montée en puissance des études locales invite donc à une vigilance accrue sur leur qualité et leur restitution.
En somme, le recours intensif aux sondages à l’approche des échéances électorales illustre un basculement des pratiques politiques : l’opinion mesurée devient un outil de construction des candidatures et des stratégies, tout en appelant un encadrement réglementaire et une attention critique à la manière dont ces chiffres sont produits et communiqués.
(Alain Garrigou, L’Ivresse des sondages, La Découverte, 2006.)