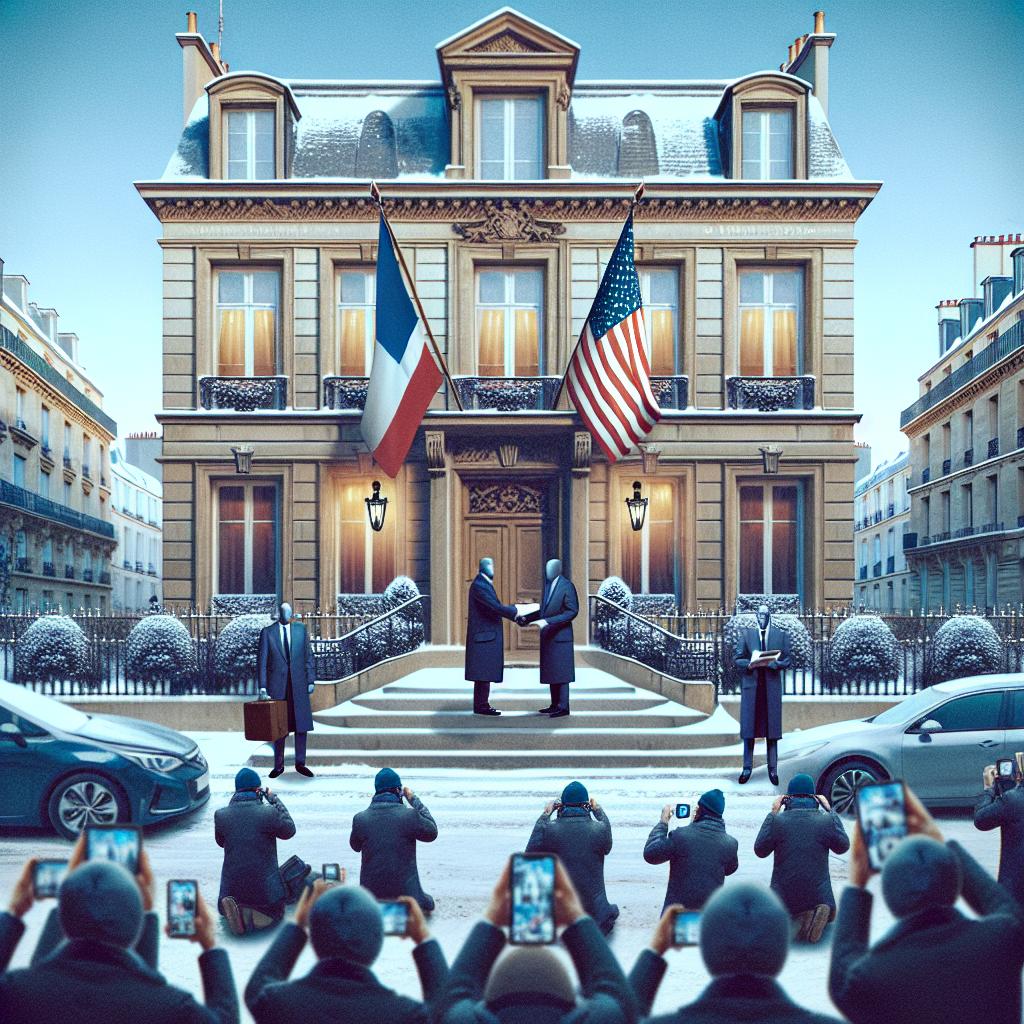Décret présidentiel et lancement d’une procédure
Le président américain Donald Trump a signé, lundi 24 novembre, un décret lançant une procédure destinée à faire classer certaines branches des Frères musulmans comme « organisations terroristes étrangères ». Le texte publié par la Maison Blanche mentionne explicitement des sections du mouvement « au Liban, en Jordanie et en Egypte », pays où la confrérie est active.
La Maison Blanche affirme que ces branches « commettent ou encouragent et soutiennent des campagnes de violence et de déstabilisation qui nuisent à leurs propres régions, à des citoyens américains ou à des intérêts américains ». La formulation figure dans le décret remis au public par l’administration.
Responsables chargés de la démarche et effets juridiques
Le décret confie la conduite de la procédure à deux responsables cités nommément : le chef de la diplomatie, Marco Rubio, et le ministre des finances, Scott Bessent. À eux revient d’examiner les éléments et, le cas échéant, de formaliser la désignation.
La classification en « organisation terroriste étrangère » ouvre un régime de mesures juridiques et administratives. Elle permet notamment de geler des avoirs, d’interdire certaines transactions financières et de refuser l’entrée sur le territoire américain à des membres ou représentants visés.
Au-delà d’un effet symbolique, cette désignation autorise des sanctions économiques et des restrictions opérationnelles. Elle renforce aussi la marge de manœuvre des autorités américaines pour limiter les interactions diplomatiques et financières avec les entités concernées.
Portée géopolitique et limites du pouvoir exécutif
Sur le plan international, une telle décision peut peser sur les relations entre Washington et les pays où la confrérie est présente. Classer des branches locales comme terroristes engage des mesures qui touchent d’abord des acteurs et des comptes liés à ces sections.
Cependant, la mise en œuvre dépend de preuves et d’analyses opérationnelles menées par les services concernés. La procédure comporte des étapes administratives et juridiques avant toute entrée en vigueur complète des restrictions annoncées.
Contexte national des pays cités
La confrérie des Frères musulmans est un mouvement transnational qui promeut un projet d’islam politique conservateur. Fondée en Égypte, la confrérie a longtemps été le principal mouvement d’opposition dans ce pays, malgré des décennies de répression.
En Égypte, la confrérie est aujourd’hui considérée comme une organisation « terroriste » et a été exclue de la vie politique après le renversement de Mohamed Morsi, qui avait exercé un bref mandat présidentiel d’un an. Cette rupture politique date de 2013.
Le mouvement a également été interdit dans d’autres pays de la région, notamment l’Arabie saoudite. Plus récemment, la Jordanie a pris des mesures contre la confrérie, invoquant des « activités de nature à déstabiliser le pays », y compris des accusations liées à la fabrication et au stockage d’armes.
Réactions et observations récentes
En France, le sujet des Frères musulmans a fait l’objet d’une attention particulière au plus haut niveau de l’État. Le président Emmanuel Macron a consacré, cette année, deux conseils de défense et de sécurité nationale à la question de « l’entrisme » du mouvement, selon les comptes rendus officiels.
Ces développements montrent que le débat autour de la confrérie mêle enjeux sécuritaires, politiques et diplomatiques. Les décisions prises par un État peuvent encourager des actions coordonnées ou susciter des réserves chez des alliés, selon l’analyse des conséquences pratiques.
Ce qui reste à suivre
La signature du décret ne signifie pas qu’une désignation est automatique et immédiate. La procédure administrative doit être menée à son terme par les autorités compétentes, qui évalueront la documentation et les éléments opérationnels avant toute décision définitive.
Les mesures annoncées — gel des avoirs, interdiction de transactions, interdiction d’entrée sur le territoire — illustrent le type d’outils que peuvent utiliser les États pour limiter l’influence d’organisations considérées comme dangereuses. Leur application effective dépendra des conclusions des responsables chargés du dossier.