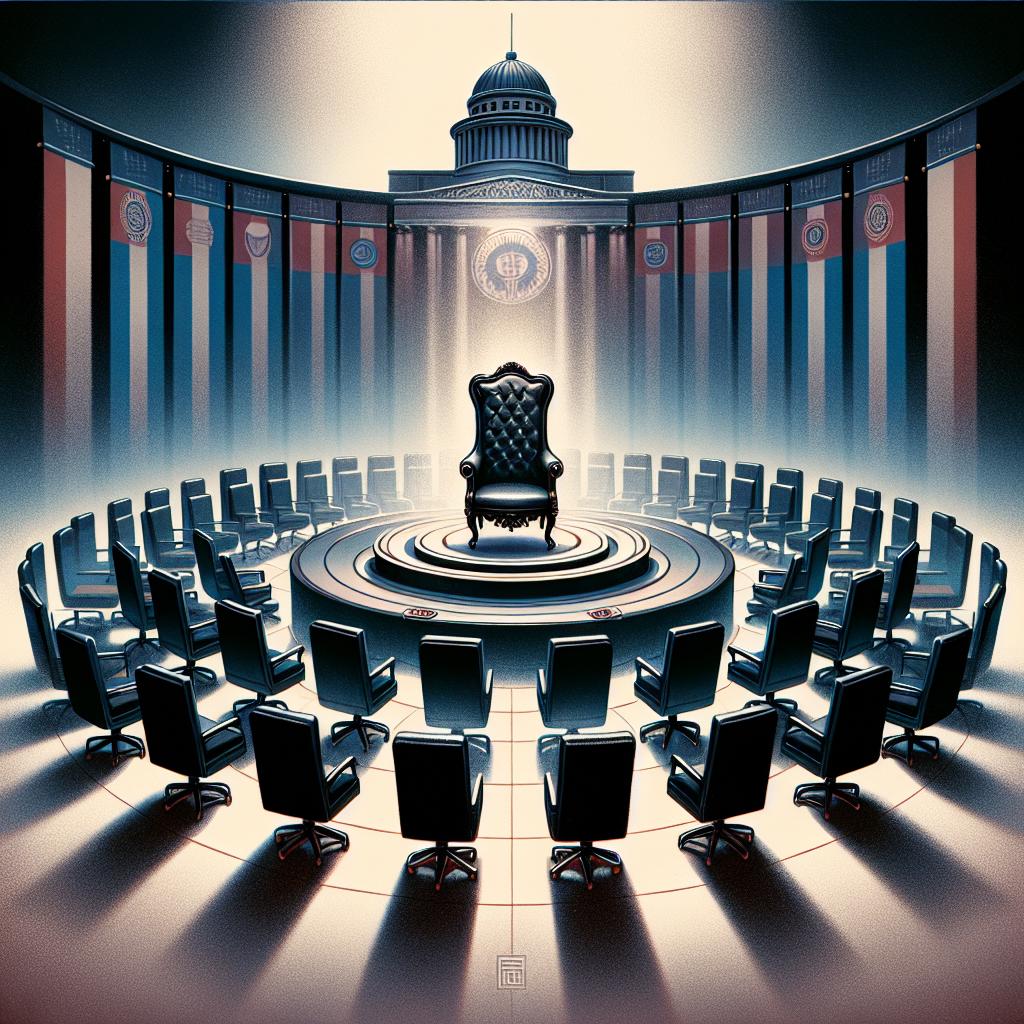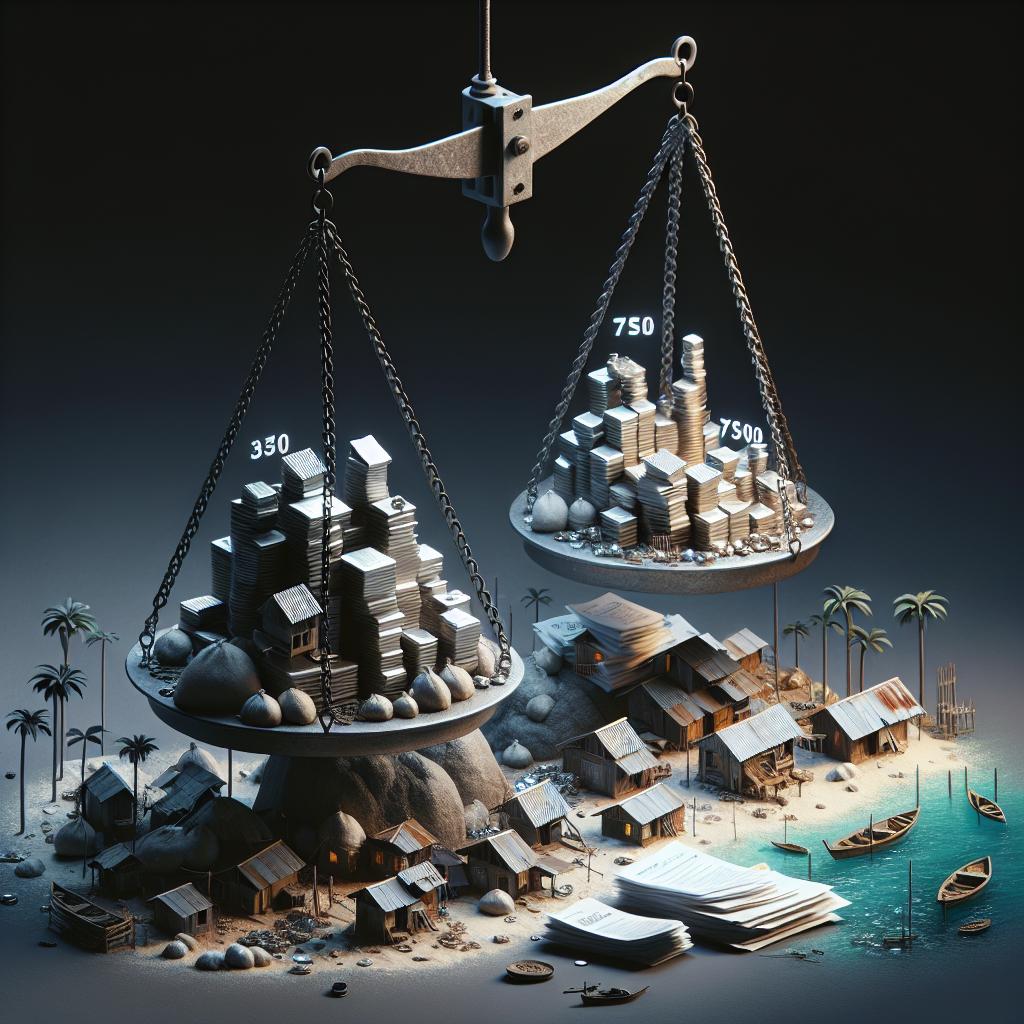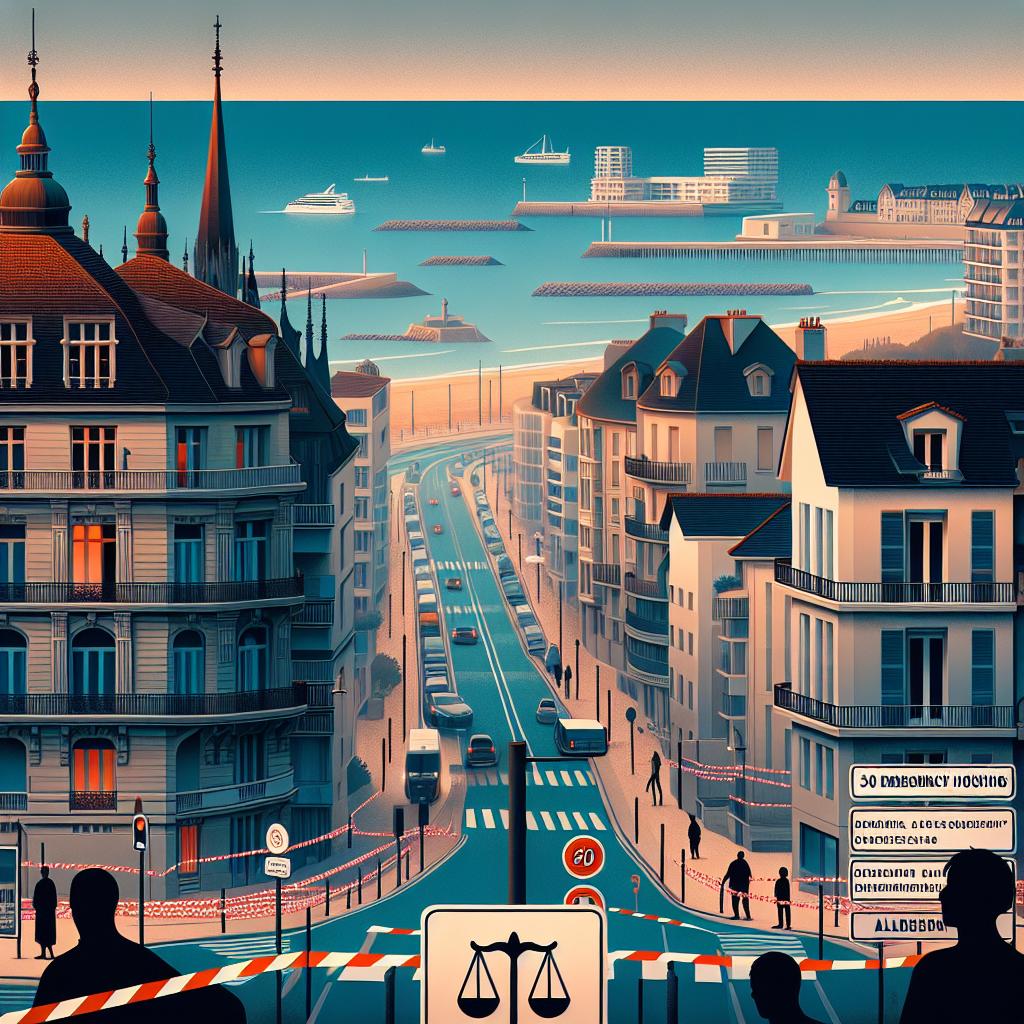Emmanuel Macron a estimé mercredi 13 août qu’un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine devait permettre d’« obtenir un cessez‑le‑feu », a‑t‑il déclaré après un échange téléphonique avec le président américain.
Le rendez‑vous entre les chefs d’État américain et russe, prévu le 15 août en Alaska, pourrait, selon lui, « faire figure de tournant » dans un conflit lancé le 24 février 2022. M. Macron a rappelé que « les questions territoriales ne seront négociées que par l’Ukraine », selon ses propos rapportés.
Dates et enjeux du sommet annoncé
Le sommet Alaska, initialement fixé au 15 août, intervient dans un contexte d’intenses consultations internationales. D’après le texte, M. Trump a indiqué vouloir une rencontre « rapidement » entre le président russe et son homologue ukrainien, et s’est dit prêt à participer aux discussions. Un responsable républicain, lors d’une conférence de presse, a estimé que « certaines grandes choses peuvent être acquises lors de la première rencontre [avec Vladimir Poutine] », précisant qu’une première entrevue pourrait préparer un second sommet.
Dans ses déclarations citées, la nécessité d’un cessez‑le‑feu s’accompagnerait, selon les participants, « de bonnes et fortes garanties de sécurité ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s’est rendu à Berlin à l’invitation du chancelier allemand Friedrich Merz « pour s’entretenir avec Donald Trump et son vice‑président, J.D. Vance », a réagi mercredi après‑midi, insistant sur la condition d’un cadre sécuritaire permettant de protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine.
Réactions européennes et positions publiques
Plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, ont participé aux discussions préparatoires. Le 12 août, les Vingt‑Sept, à l’exception de la Hongrie, ont publié une déclaration commune affichant un soutien « indéfectible » à l’Ukraine. Dans ce document, ils saluent « les efforts du président Trump pour mettre fin à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et parvenir à une paix et une sécurité justes et durables pour l’Ukraine », selon le texte cité.
Ces positions s’inscrivent dans un équilibre délicat entre volonté de négociation et exigence de garanties. Dans les échanges rapportés, il est également indiqué que « les négociations de paix doivent être complétées avec une forme de pression sur la Russie si elle n’accepte pas le cessez‑le‑feu en Alaska », principe défendu par certains interlocuteurs lors des consultations.
Parallèlement, la Russie a jugé mercredi « insignifiantes » les consultations menées entre Européens et Américains, selon les éléments rapportés. Cette appréciation souligne la difficulté, d’après les comptes rendus, d’aligner toutes les parties sur une même feuille de route avant la rencontre en Alaska.
Le texte rapporte aussi une mise en garde : en cas d’absence d’accord face à face en Alaska, « un milliardaire a par ailleurs menacé Moscou de ‘conséquences très graves’ », sans que des précisions supplémentaires aient été fournies sur la nature de ces mesures, toujours selon les informations disponibles.
Situation militaire et calendrier des négociations
Sur le plan militaire, l’AFP indique, d’après des données fournies par l’Institute for the Study of War (ISW), que mardi les forces russes ont réalisé « leur plus grande progression en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d’un an ». Ce constat intervient alors que les Européens évaluent depuis plusieurs jours l’opportunité et les modalités des négociations attendues en Alaska.
Au regard des éléments rapportés, le rendez‑vous de mi‑août est présenté par certains acteurs comme une opportunité pour obtenir un cessez‑le‑feu, mais aussi comme une première étape susceptible d’exiger des garanties supplémentaires et une pression internationale si les engagements ne sont pas respectés.
Les propos cités et les démarches décrites dans le texte montrent l’existence d’une dynamique diplomatique intense, aux prises avec des réalités militaires contrastées et des divergences d’interprétation quant aux conditions d’une trêve durable. Plusieurs acteurs européens et américains semblent s’accorder sur la nécessité d’allier négociation et garanties, tandis que d’autres voix, y compris côté russe selon les comptes rendus, restent sceptiques sur l’effet immédiat des consultations.