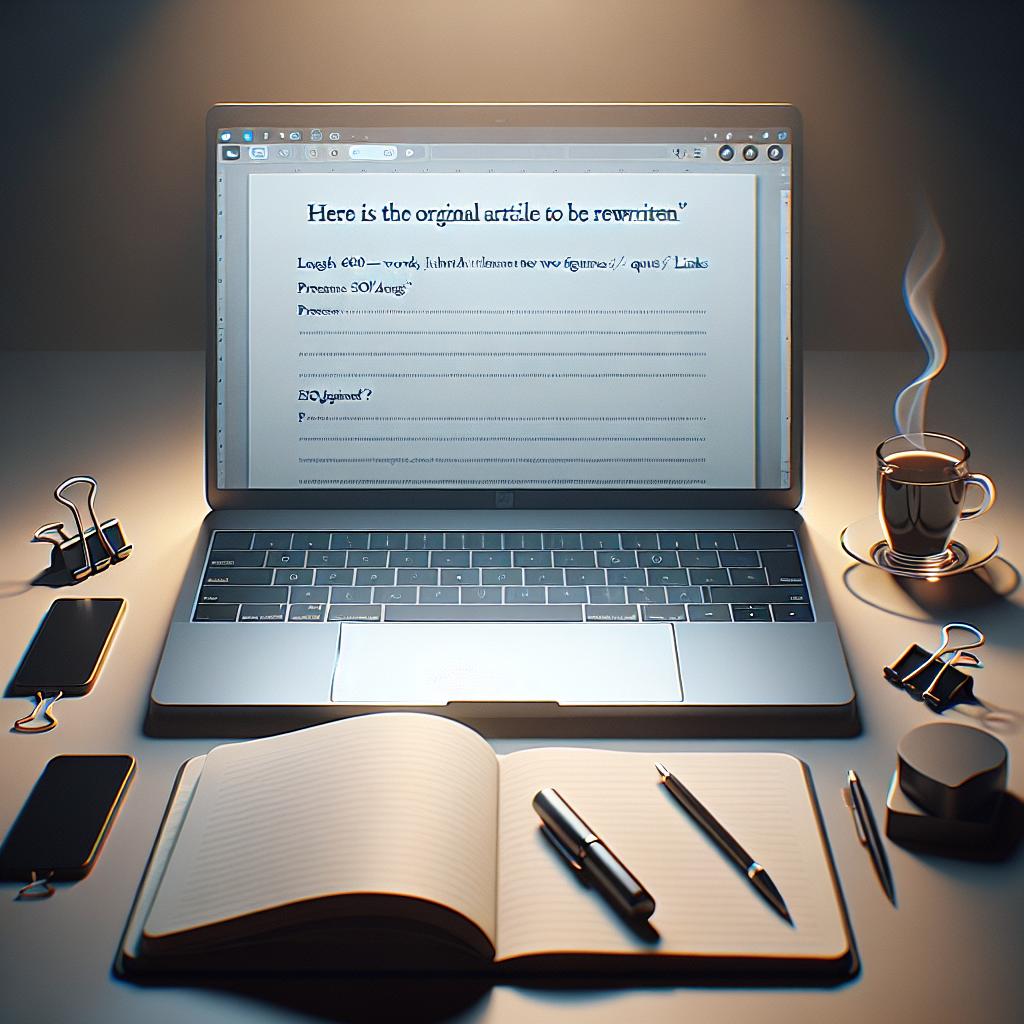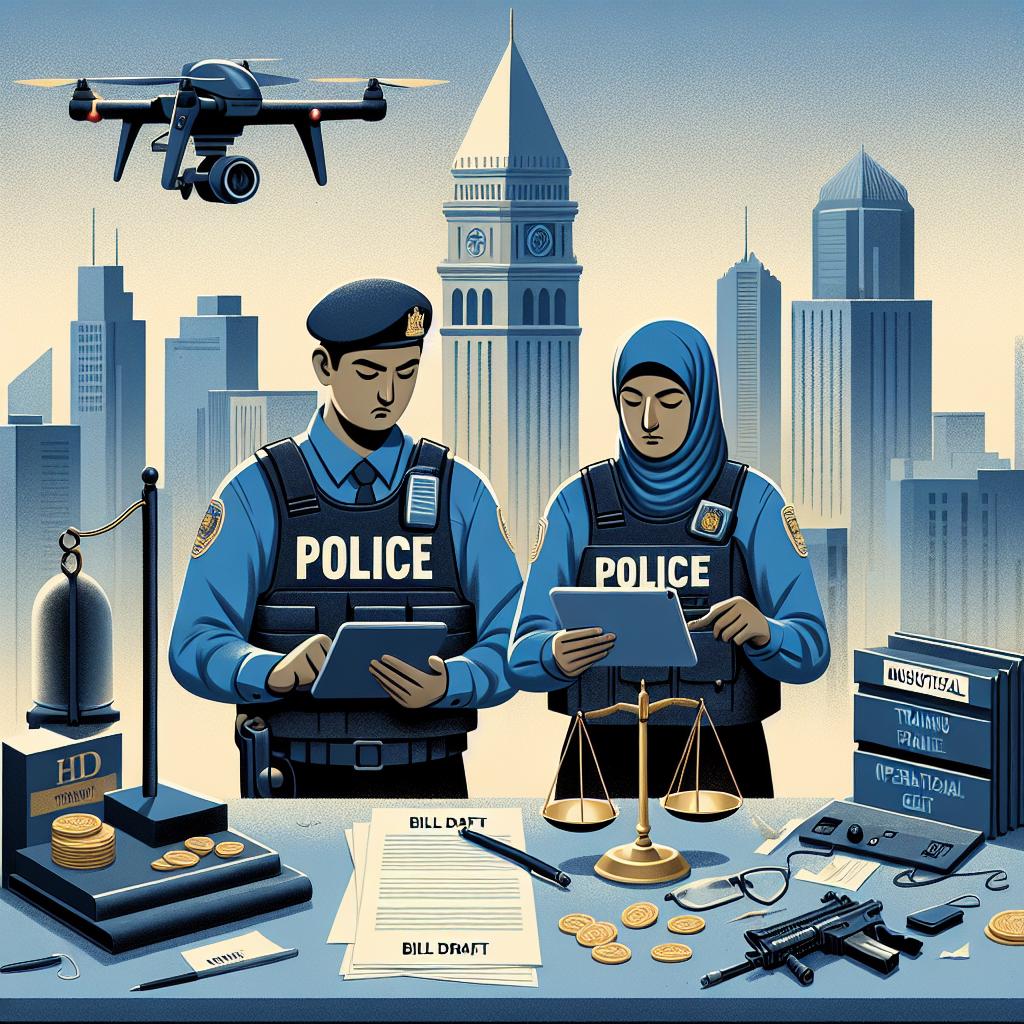Le président de la République française, Emmanuel Macron, a reconnu officiellement que la France avait mené « une guerre » au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l’indépendance de 1960. Cette reconnaissance figure dans un courrier adressé à son homologue camerounais Paul Biya, rendu public mardi 12 août.
Dans cette lettre datée du 30 juillet, M. Macron se réfère aux conclusions d’un rapport d’historiens remis en janvier et écrit que celui-ci « a clairement fait ressortir qu’une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l’armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple ». Le président ajoute que « la guerre s’est poursuivie au-delà de 1960 avec l’appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes » et affirme : « Il me revient d’assumer aujourd’hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements. »
Le rapport et son contexte
Le document auquel renvoie M. Macron comporte plus de 1 000 pages. Il a été remis le 28 janvier à Yaoundé à Paul Biya, une semaine après avoir été présenté au président français à Paris. Ce rapport émane d’une commission franco-camerounaise mise en place en 2022 et dont les travaux ont été coordonnés par l’historienne Karine Ramondy, selon les éléments publics cités par la presse.
Le recours explicite au terme « guerre » par la France marque une inflexion du langage officiel, jusque-là prudent sur la nature et l’ampleur des opérations menées pendant la période coloniale et dans les premières années suivant l’indépendance.
Chiffres, violences et modalités de la répression
Les travaux de la commission et les entretiens publiés avec Karine Ramondy dressent un tableau détaillé des méthodes de répression employées. Selon l’historienne, dès l’après‑Seconde Guerre mondiale, la France a réprimé le mouvement indépendantiste — notamment les militants de l’Union des populations du Cameroun (UPC) — sur les plans politique, militaire, diplomatique et judiciaire. Sous le prétexte de « pacification », des populations auraient été déracinées et déplacées dans des camps de regroupement.
Sur le plan judiciaire, Karine Ramondy indique que, entre 1955 et 1958, quelque 2 000 personnes ont été condamnées, d’autres emprisonnées arbitrairement et torturées. Les archives consultées montrent aussi des violences ciblées à l’encontre des femmes, y compris des femmes enceintes, selon les mêmes sources.
En additionnant les chiffres fournis par l’autorité militaire française pour les années de répression les plus intenses, entre 1956 et 1962, il ressort une estimation officielle d’au minimum 7 500 « combattants » tués par l’armée française. Karine Ramondy souligne toutefois que ce chiffre ne tient pas compte des civils ni des personnes décédées des suites de leurs blessures et qu’il est « très en deçà des réalités ». Elle juge « le bilan le plus plausible » à « des dizaines de milliers de morts », formulation rapportée dans un entretien publié en février.
Ces éléments mettent en lumière la difficulté d’établir un bilan précis à partir d’archives partielles et de décomptes militaires qui ne distinguent pas toujours combattants et civils.
Enjeux mémoriels et relations franco‑camerounaises
La prise de responsabilité formulée par Emmanuel Macron s’inscrit dans une série d’initiatives mémorielles entreprises par la France ces dernières années, notamment concernant le rôle du pays pendant le génocide des Tutsi au Rwanda et la guerre d’Algérie. Ces démarches visent, selon le chef de l’État, à apaiser et à renouveler les relations entre la France et ses anciens territoires coloniaux en Afrique.
Cette démarche intervient alors que l’influence de Paris en Afrique est soumise à des tensions et à des critiques accrues, en particulier dans les zones sahéliennes. L’usage répétitif du terme « guerre » dans la lettre du 30 juillet marque une volonté d’énoncer plus nettement la nature des événements passés, mais la portée politique et diplomatique de cette reconnaissance reste liée aux suites que les autorités françaises et camerounaises décideront d’entreprendre.
Le rapport de la commission franco‑camerounaise et la lettre présidentielle relancent les questions sur la mise en lumière des archives, l’établissement de bilans plus détaillés et la manière dont la mémoire de ces événements sera traitée entre les deux pays. Les éléments publiés jusqu’ici proviennent des travaux de la commission et des archives consultées par ses historiens ; la recherche et le débat public autour de ces conclusions devraient se poursuivre.