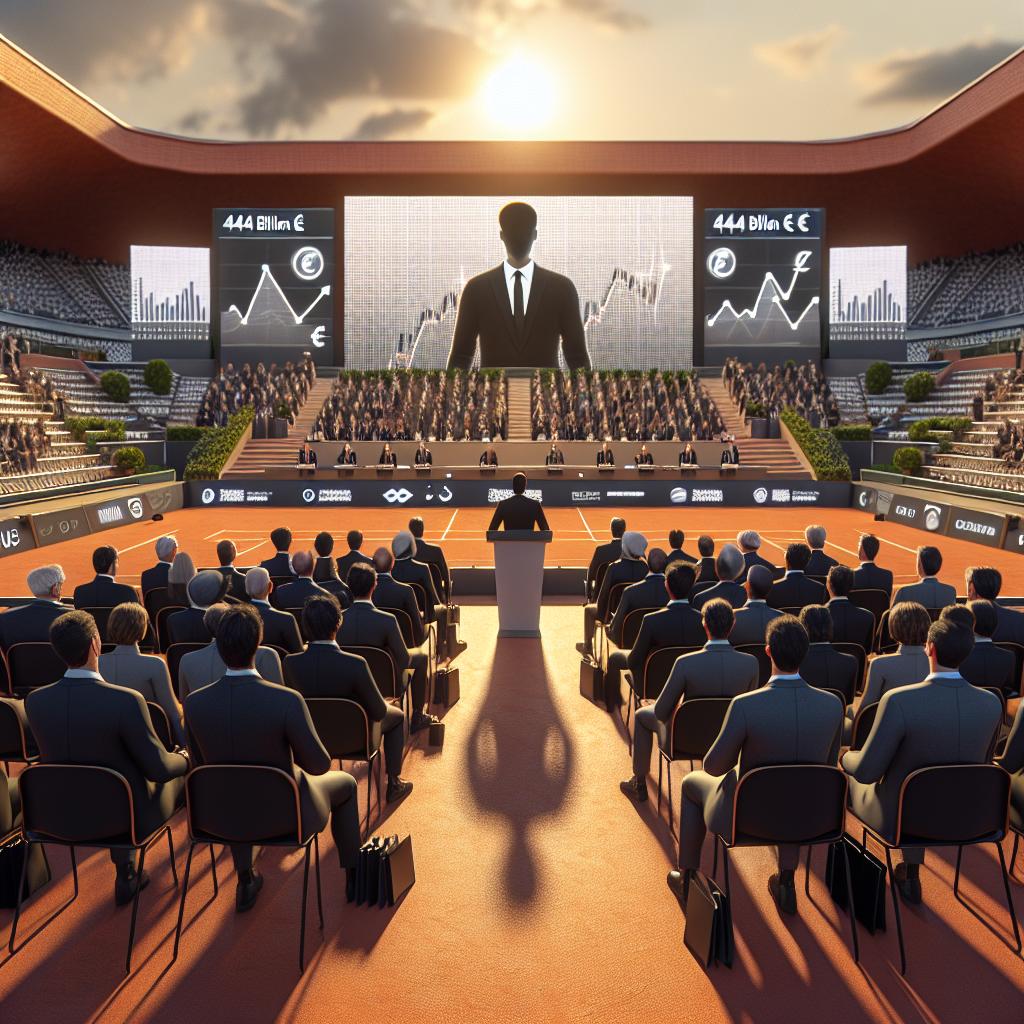Le Premier ministre népalais Khadga Prasad Sharma Oli, âgé de 73 ans, a présenté sa démission mardi 9 septembre, après plusieurs jours de manifestations massives qui ont fait au moins 19 morts et plus de 400 blessés.
Une journée d’affrontements à Katmandou
Les protestations ont culminé le 9 septembre lorsque des manifestants, présents dans les rues malgré un couvre-feu, ont pris d’assaut le Parlement à Katmandou. Des vidéos et des témoignages rapportés dans les rangs de la contestation ont décrit des scènes de foule et d’affrontement près du centre politique de la capitale.
Dans le même temps, des groupes de manifestants se sont dirigés vers les résidences des principaux responsables politiques du pays. Ces attaques contre des domiciles officiels ont exacerbé la crise et accentué la pression sur l’exécutif, selon les informations disponibles.
Un mouvement né en ligne et amplifié par la censure des réseaux sociaux
Selon les récits liés au mouvement, la colère s’est organisée en grande partie en ligne. Des jeunes, mobilisés sur plusieurs semaines, ont utilisé des plateformes numériques pour coordonner des rassemblements et diffuser des appels à la mobilisation.
La décision gouvernementale du 4 septembre de bloquer 26 plateformes de réseaux sociaux a marqué un tournant. Parmi les services mentionnés figuraient Facebook, YouTube, LinkedIn, X (anciennement Twitter), Instagram, WhatsApp, Signal et WeChat. Cette mesure a été présentée comme motif d’intensification des protestations, les opposants dénonçant une atteinte à la liberté d’expression et un frein à la communication entre manifestants.
Le blocage de ces services a rendu plus difficile la vérification en temps réel des événements pour les observateurs externes. Il a aussi servi de catalyseur pour un mouvement de rue qui, d’après les sources de départ, s’était déjà structuré sur le web.
Bilan humain et conséquences politiques
Le nombre de victimes annoncé — au moins 19 morts et plus de 400 blessés — témoigne de la violence des affrontements. Ces chiffres, rapportés dans le contexte des journées de protestation, ont alimenté l’indignation publique et intensifié les appels à un changement au sommet de l’exécutif.
La démission de Khadga Prasad Sharma Oli intervient directement après ces journées de contestation. Le geste met fin, au moins temporairement, à la permanence de son mandat et suscite des interrogations sur la suite du processus politique dans le pays.
Les informations disponibles indiquent que la pression de la rue et la contestation née des restrictions sur les réseaux sociaux ont été des facteurs déterminants de sa décision. Les implications institutionnelles et la manière dont les forces politiques nationales géreront la transition restent, à ce stade, sujettes à évolution.
Contexte et questionnements
Ce mouvement illustre la capacité de mobilisation des jeunes via des espaces numériques, puis leur passage à l’action dans l’espace public quand la communication en ligne est restreinte. Il met également en lumière la rapidité avec laquelle une décision de censure peut modifier la dynamique politique et sociale.
Plusieurs éléments restent à préciser, notamment la chronologie fine des événements sur le terrain, l’identification complète des responsables des violences et la nature exacte des décisions qui ont conduit au blocage des plateformes le 4 septembre.
En l’absence d’une documentation publique exhaustive fournie ici, les faits rapportés se limitent aux éléments vérifiables présents dans les comptes rendus des événements : la date de la démission, la décision de blocage des réseaux sociaux, l’assaut contre le Parlement et les résidences officielles, ainsi que le bilan humain communiqué.
Le pays, qualifié ici de « petit pays himalayen », traverse une séquence politique marquée par une contestation forte et des tensions accrues entre autorités et manifestants. La démission du Premier ministre laisse le champ ouvert à la formation d’un nouvel équilibre politique, dont l’évolution dépendra des décisions prises par les acteurs nationaux dans les jours suivants.