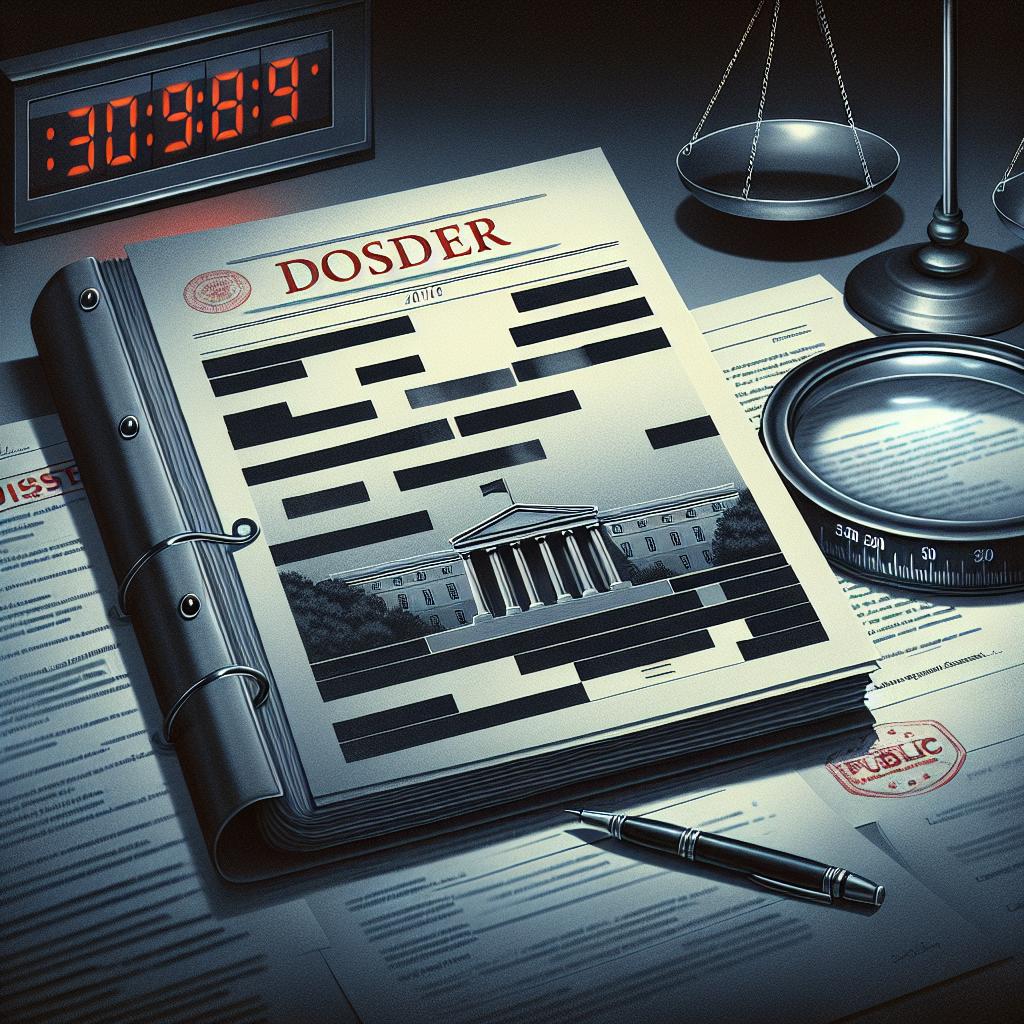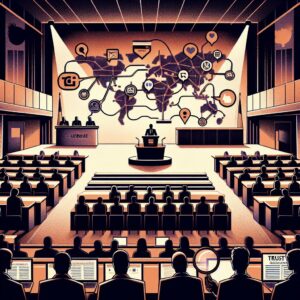« Je viens juste de signer la loi pour rendre public le dossier Epstein ! », a écrit Donald Trump, mercredi 19 novembre, dans un long message publié sur son réseau Truth Social. Ce message marque un revirement public du président, qui s’était jusque-là opposé à cette initiative. La loi promulguée contraint désormais l’exécutif à rendre public l’ensemble des documents non classifiés relatifs à l’affaire Jeffrey Epstein, mais le champ exact des révélations reste entouré d’incertitudes.
Le texte adopté et son calendrier
Le texte voté mardi au Congrès donne un mois au ministère de la Justice pour rendre disponibles « l’intégralité des documents non classifiés » en sa possession sur Jeffrey Epstein, sur sa complice Ghislaine Maxwell, et sur toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires liées à l’affaire. Jeffrey Epstein, financier new-yorkais au réseau étendu dans les milieux politique, économique et du divertissement, est mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.
La loi prévoit un délai de trente jours à compter de la promulgation du texte par le président. À la Chambre des représentants, la proposition a été adoptée à 427 voix pour et 1 contre. Au Sénat, une procédure particulière a permis d’approuver le texte sans débat et à l’unanimité. En promulguant la loi, Donald Trump déclenche donc le compte à rebours prévu par le texte.
Ce que la loi permet — et ce qu’elle autorise à retenir
Le cadre adopté impose la publication des documents non classifiés, mais il laisse aussi des marges de manœuvre aux autorités. Le ministère de la Justice est autorisé à retenir ou à caviarder des pièces sous certaines conditions, notamment pour préserver l’intimité des victimes ou en cas « d’enquête ou de poursuites fédérales en cours ». Cette possibilité soulève des questions sur l’étendue réelle des informations qui seront rendues publiques.
Les responsables insistent toutefois sur des garanties procédurales. L’élu républicain Thomas Massie, l’un des auteurs de la proposition de loi, a souligné que, selon les termes de sa législation, l’argument d’un dossier « en cours » ne pourrait servir d’excuse que de manière « temporaire » et limitée. Pam Bondi, nommée par le président pour diriger le ministère de la Justice, a affirmé que ses services respecteraient la loi « avec un maximum de transparence, tout en protégeant les victimes ».
Réactions politiques et enjeux
Le revirement de Donald Trump intervient après des mois d’opposition publique à la « transparence dans le dossier Epstein ». Pendant la campagne de 2024, il avait promis des révélations « fracassantes »; depuis son retour au pouvoir, il a exhorté ses partisans à « tourner la page » et qualifie l’affaire de « canular » monté en épingle par ses opposants démocrates. Il a répété n’avoir « rien à voir avec Jeffrey Epstein », qualifiant ce dernier de « pervers malade ».
Sur le plan politique, la question a cristallisé les tensions. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, avait mis en garde contre toute « magouille de la part de Donald Trump », en appelant à « appliquer » le texte une fois signé. De leur côté, des responsables républicains ont demandé que soient examinées les relations d’Epstein avec certaines personnalités, dont l’ex-président Bill Clinton; Pam Bondi a annoncé l’ouverture d’une enquête sur ces liens, affirmant qu’elle se fondait sur « de nouvelles informations ».
Cette démarche a cependant suscité des réserves. Le ministère de la Justice et le FBI avaient déclaré en juillet ne pas avoir « découvert de preuves sur lesquelles fonder une enquête contre des personnes jusqu’ici non poursuivies » dans l’affaire, ce qui alimente les interrogations sur la portée et la nature des recherches annoncées aujourd’hui.
Limites et incertitudes sur les révélations
Malgré la célébration de la décision par certains responsables, plusieurs voix s’inquiètent que le mécanisme d’enquête ou les redactions prévues ne servent d’écran de fumée pour limiter la diffusion d’éléments compromettants. Thomas Massie a lui-même averti que ces enquêtes pourraient constituer « une tentative de la dernière chance pour empêcher la publication du dossier Epstein ».
Le flou demeure donc sur l’étendue réelle des documents qui seront accessibles au public et sur la nature des informations qu’ils contiendront. Les protections prévues pour les victimes et les éventuelles poursuites en cours sont des motifs légitimes de non-publication partielle, mais ils contribuent aussi à alimenter les suspicions politiques autour de la mise à disposition du dossier.
Au-delà de la procédure et des postures partisanes, la promesse de transparence ouvre une période d’attente. Le ministère de la Justice dispose désormais du délai légal prévu pour publier — ou expliquer les motifs de rétention — des documents demandés. Dans les semaines à venir, ce calendrier devrait clarifier l’ampleur effective des révélations et permettre d’évaluer si la loi aboutira à un accès substantiel aux dossiers liés à Jeffrey Epstein.