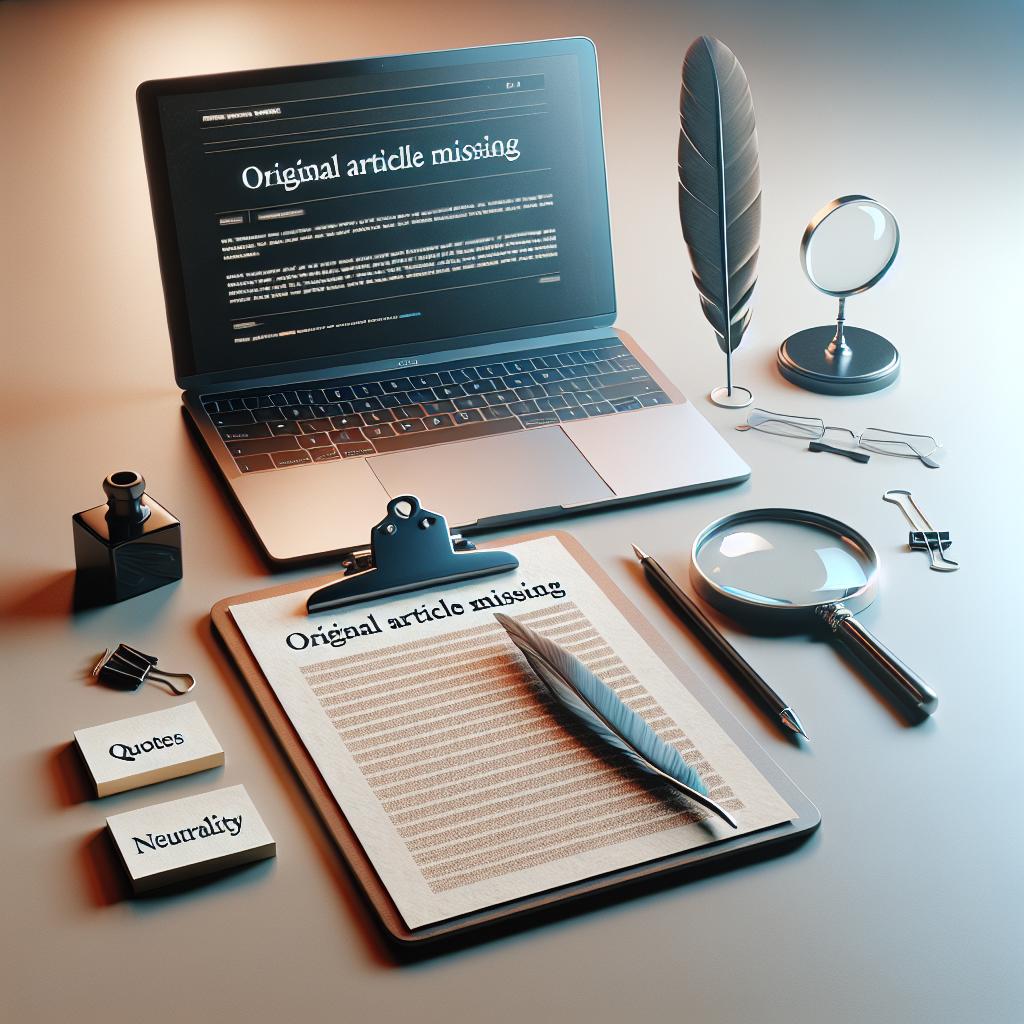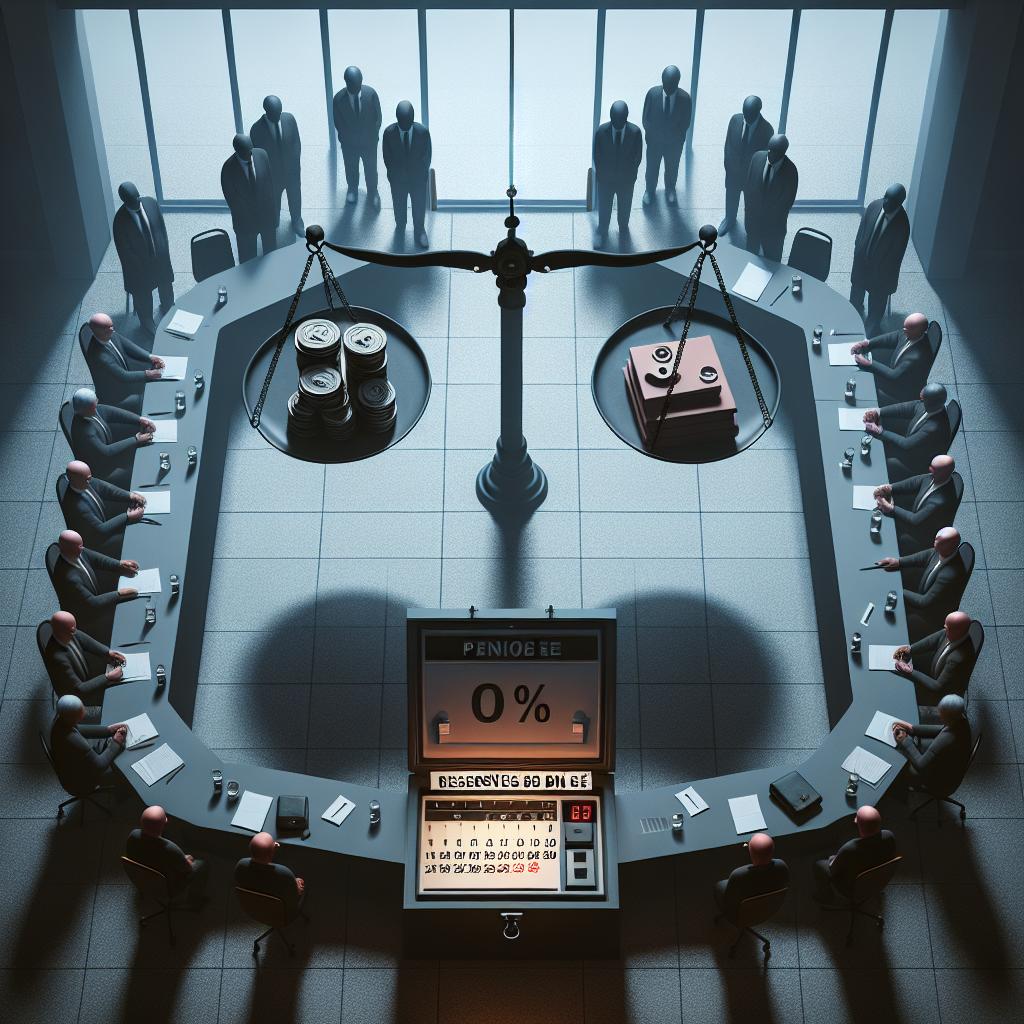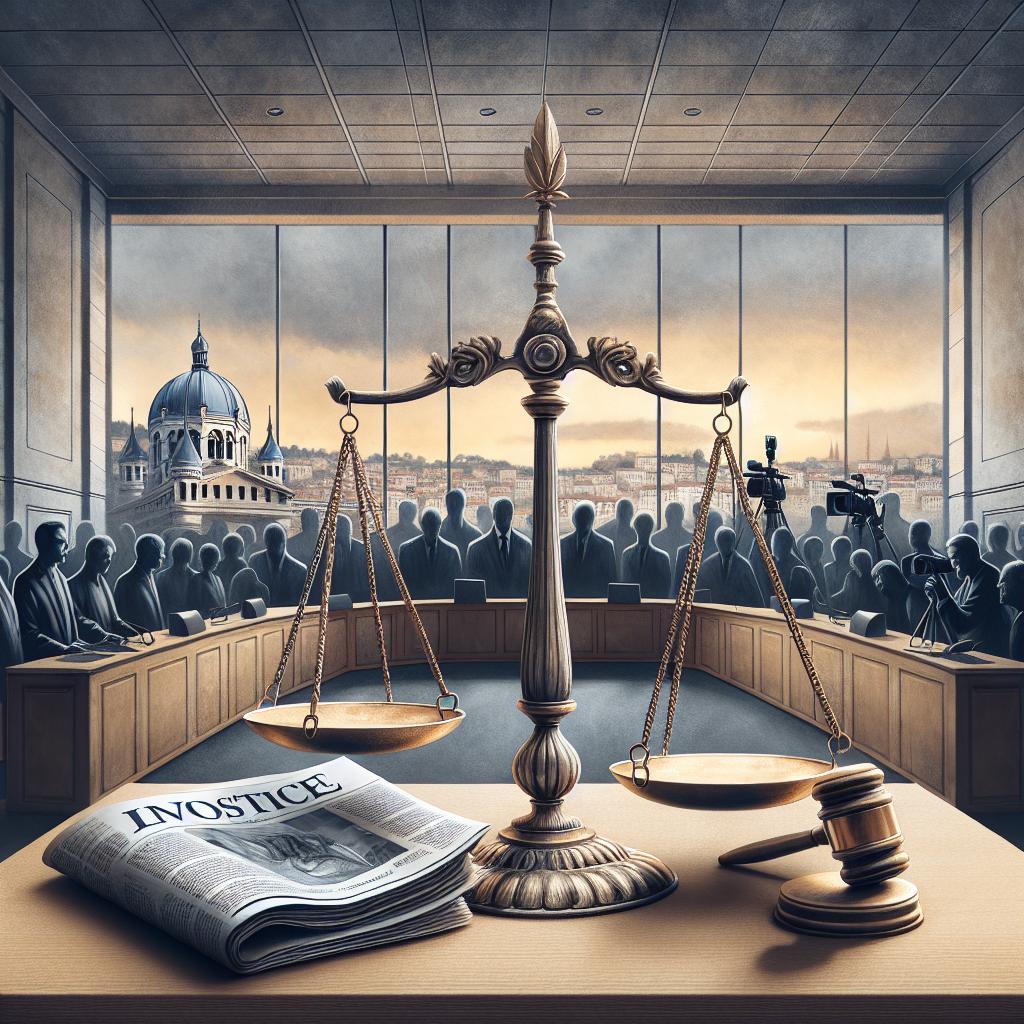Cinq ans d’enquête puis trois jours d’audience : l’affaire des déboulonnages de quatre statues, qui avait fait grand bruit en Martinique en 2020, laisse encore de lourdes questions sans réponse au terme du procès tenu début novembre devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France.
Les faits et le contexte
Les événements qui ont déclenché l’affaire sont désormais bien connus : le 22 mai 2020 — jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage en Martinique —, dans l’après-midi, un groupe de personnes a déboulonné en plein jour une statue en marbre représentant Victor Schœlcher. L’action, menée dans le centre-ville de Fort-de-France et dans la commune voisine de Schœlcher, a été largement relayée sur les réseaux sociaux.
La statue visée trônait depuis plus d’un siècle devant l’ancien palais de justice de Fort-de-France, bâtiment qui a depuis été transformé en centre culturel. Victor Schœlcher est présenté dans le dossier comme l’homme politique associé à la rédaction du décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, en avril 1848.
Le procès et les questions soulevées
Onze personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel et ont comparu du 5 au 7 novembre. Les débats, qui ont duré trois journées, n’ont pas permis de trancher toutes les difficultés soulevées par l’affaire. Parmi les interrogations majeures : s’agissait‑il d’un acte de simple vandalisme ou d’une action à portée politique, liée au débat sur l’héritage colonial en outre‑mer ; les onze prévenus sont‑ils effectivement les auteurs des déboulonnages qui leur sont reprochés ; et, enfin, à qui appartenaient précisément les statues endommagées ?
La procureure de la République, Pascale Ganozzi, a rappelé la portée du dossier lors de son réquisitoire. « Ces trois journées d’audience ont été consacrées à un dossier dont on vous dira qu’il est historique », a‑t‑elle déclaré au cours d’un réquisitoire d’une cinquantaine de minutes.
Ce qui reste à établir
Au-delà des aspects symboliques et médiatiques de l’affaire, le tribunal doit encore évaluer la portée pénale des faits reprochés, la qualification juridique des actes et la responsabilité de chacun des prévenus. Les débats ont combiné éléments factuels et enjeux de sensibilité publique, mais les pièces et les témoignages présentés pendant ces trois jours n’ont pas permis d’éliminer toutes les zones d’ombre.
Le jugement est attendu au 17 novembre, date à laquelle le tribunal devrait rendre sa décision et, le cas échéant, préciser les motivations juridiques qui fondent sa décision. D’ici là, plusieurs questions procédurales et matérielles demeurent ouvertes, notamment sur la propriété des œuvres et sur l’intention des auteurs au moment des déboulonnages.
Enjeux locaux et portée nationale
L’affaire a pris une ampleur particulière parce qu’elle croise des sujets de société sensibles : la mémoire coloniale, la place des symboles publics et la manière dont les sociétés contemporaines traitent leur passé. En Martinique, comme ailleurs, les déboulonnages ont relancé le débat sur l’identité et l’histoire, tandis que la procédure pénale tente d’en apprécier les contours juridiques.
Si le caractère politique de l’action est au cœur des débats, la dimension pénale reste centrale pour la justice : il s’agit d’établir des faits, des responsabilités et d’appliquer les textes en vigueur. Le déroulé du procès — enquêtes longues, audience concentrée sur trois jours et réquisitoire appuyé — illustre la complexité de concilier mémoire collective et exigences du droit pénal.
Perspectives après le jugement
Quel que soit le sens de la décision qui sera prononcée le 17 novembre, le dossier devrait rester surveillé pour la manière dont il articule mémoire, responsabilité individuelle et sanctions pénales. Les conclusions du tribunal apporteront des réponses juridiques à certaines questions, mais la dimension politique et symbolique de l’affaire continuera probablement d’alimenter le débat public.
Dans l’immédiat, c’est la décision judiciaire attendue à la mi‑novembre qui doit éclairer, au moins partiellement, les zones d’incertitude laissées par les trois jours d’audience et par cinq années d’enquête.