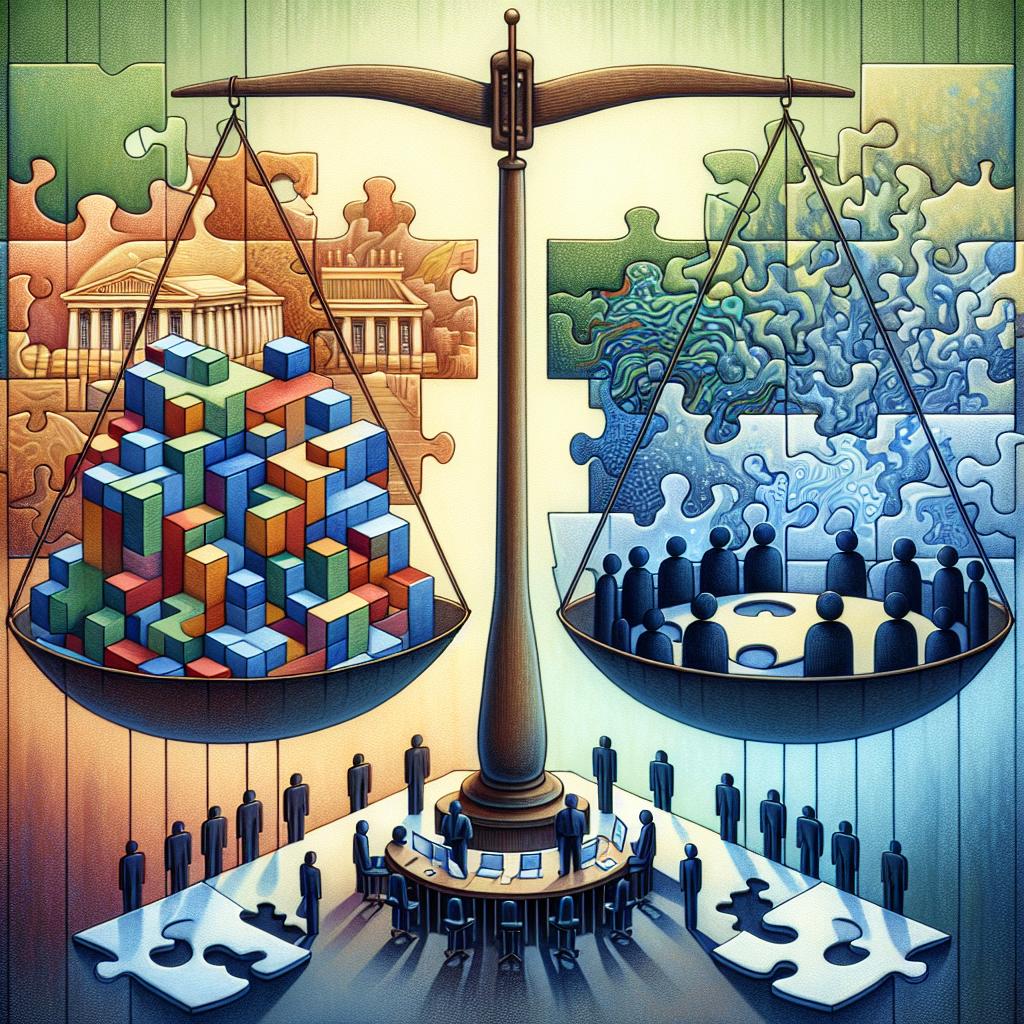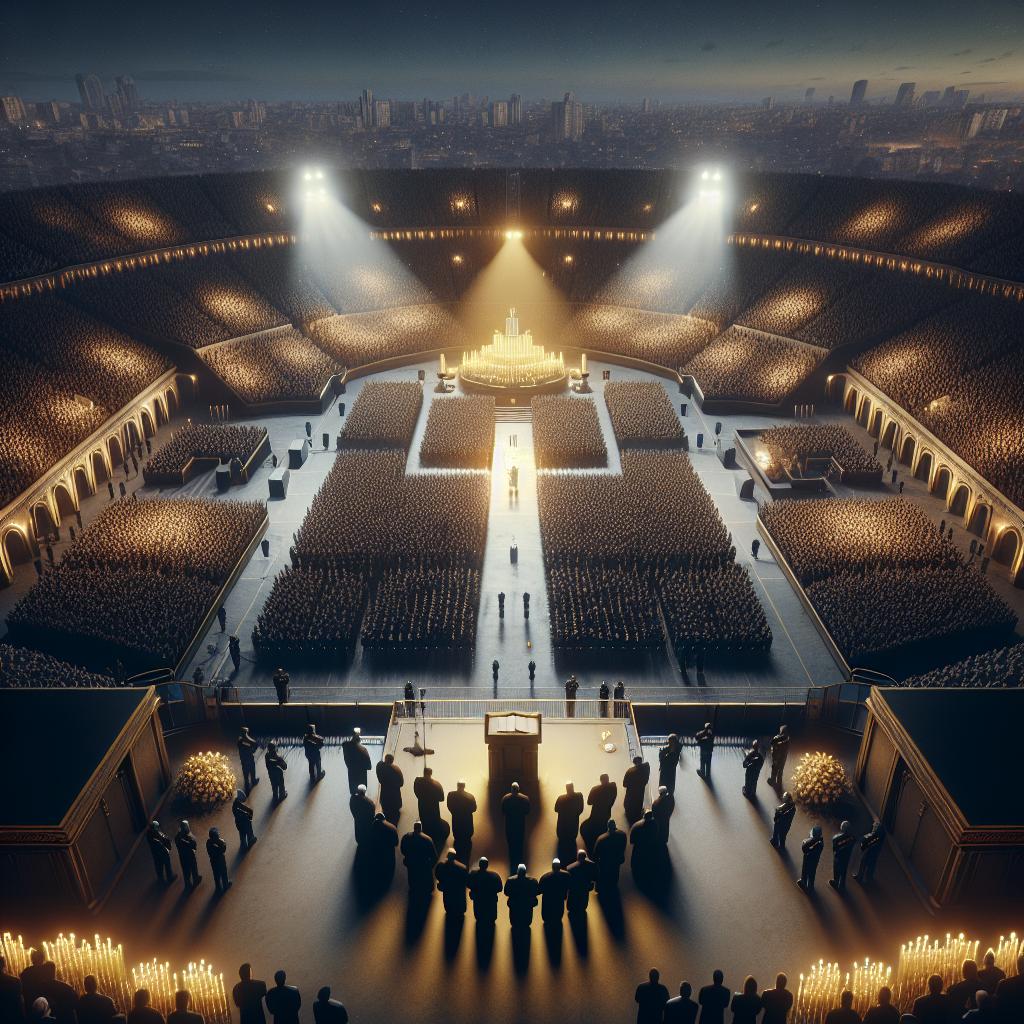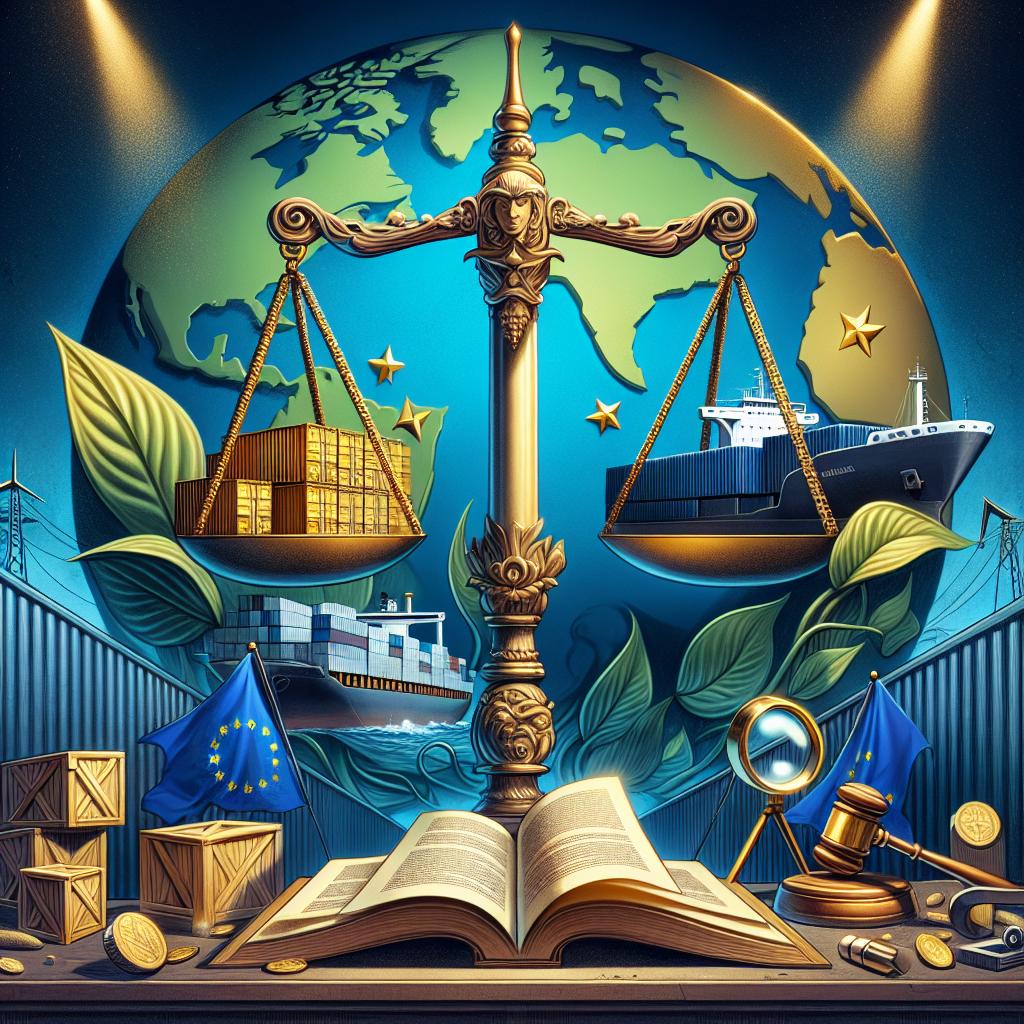Inauguré en octobre 2015, le mémorial du camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, a fêté ses dix ans en octobre 2025 dans un contexte politique tendu et disputé.
Une polémique politique récente
Depuis septembre 2025, le Rassemblement national (RN) a engagé une campagne de dénigrement visant le mémorial et le travail de ses équipes. Des élus RN, à l’Assemblée nationale, au conseil régional d’Occitanie et sur le site même de l’ancien camp, ont tenu des propos acerbes qui réactivent d’anciens conflits politico-mémoriels.
Parmi les accusations relayées figurent les qualificatifs suivants : « temple du wokisme », la mémoire des harkis serait « délibérément effacée », et l’institution véhiculerait des « discours culpabilisateurs » conduisant selon ces opposants à une « trahison de l’histoire ». Ces formules, souvent lancées lors de déclarations publiques, ont largement alimenté le débat sur la gestion et la portée du lieu.
Un lieu sobre et symbolique
Le mémorial est d’apparence volontairement sobre : un monolithe de béton de 210 mètres ancré dans le sol, pensé comme une mémoire enfouie. Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, il cherche à traduire par l’architecture la densité et la durée d’un passé difficile à représenter.
Sur le plan historique, le mémorial retrace ce qui est présenté comme l’histoire du plus grand camp d’internement d’Europe occidentale. Le site se distingue par plusieurs paramètres : une superficie d’environ 6 kilomètres carrés, une longue période d’existence — 1941 à 1964 — et une épaisseur historique marquée, qui croise la guerre d’Espagne, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et les épisodes de la décolonisation.
Le parcours muséographique et les panneaux du mémorial rappellent aussi la diversité des populations internées : près de 50 000 hommes, femmes et enfants y ont été détenus à différents moments, selon les recherches et les archives exploitées par l’équipe du site.
Les origines du camp et les premières internations
Le camp, connu sous le nom de camp Joffre à ses débuts, s’inscrit dans le cadre de la politique d’internement instituée après la défaite de 1940. En juillet 1940, le régime du maréchal Pétain organise et systématise la détention des personnes considérées comme « indésirables ».
À l’hiver 1940-1941, des dizaines de milliers de personnes — pour l’essentiel des réfugiés juifs fuyant les persécutions — sont internées dans les camps de la zone libre, provoquant ce que décrivent les sources contemporaines comme un véritable désastre humanitaire.
Le 14 janvier 1941, un convoi en provenance du camp d’Agde (Hérault) arrive à Rivesaltes. Jusqu’alors camp militaire, le site devient progressivement un lieu d’internement destiné à recevoir des familles étrangères, notamment espagnoles et polonaises, ainsi que des populations nomades, majoritairement de nationalité française.
Mémoire, débats et enjeux
Les critiques récentes posent la question de la place accordée à différentes mémoires — celle des victimes juives, celle des réfugiés espagnols, celle des harkis ou des nomades — au sein d’un lieu qui se veut commémoratif et pédagogique. Les opposants dénoncent une hiérarchisation ou une omission, tandis que les défenseurs du mémorial soutiennent que son discours vise à restituer la complexité historique et la multiplicité des expériences vécues sur le site.
Au-delà des invectives, le débat souligne la difficulté à concilier exigence scientifique, choix muséographiques et enjeux politiques. Le mémorial reste un lieu d’enseignement et de mémoire qui continue d’interroger la société sur les responsabilités passées et sur la manière de les transmettre aux générations présentes et futures.