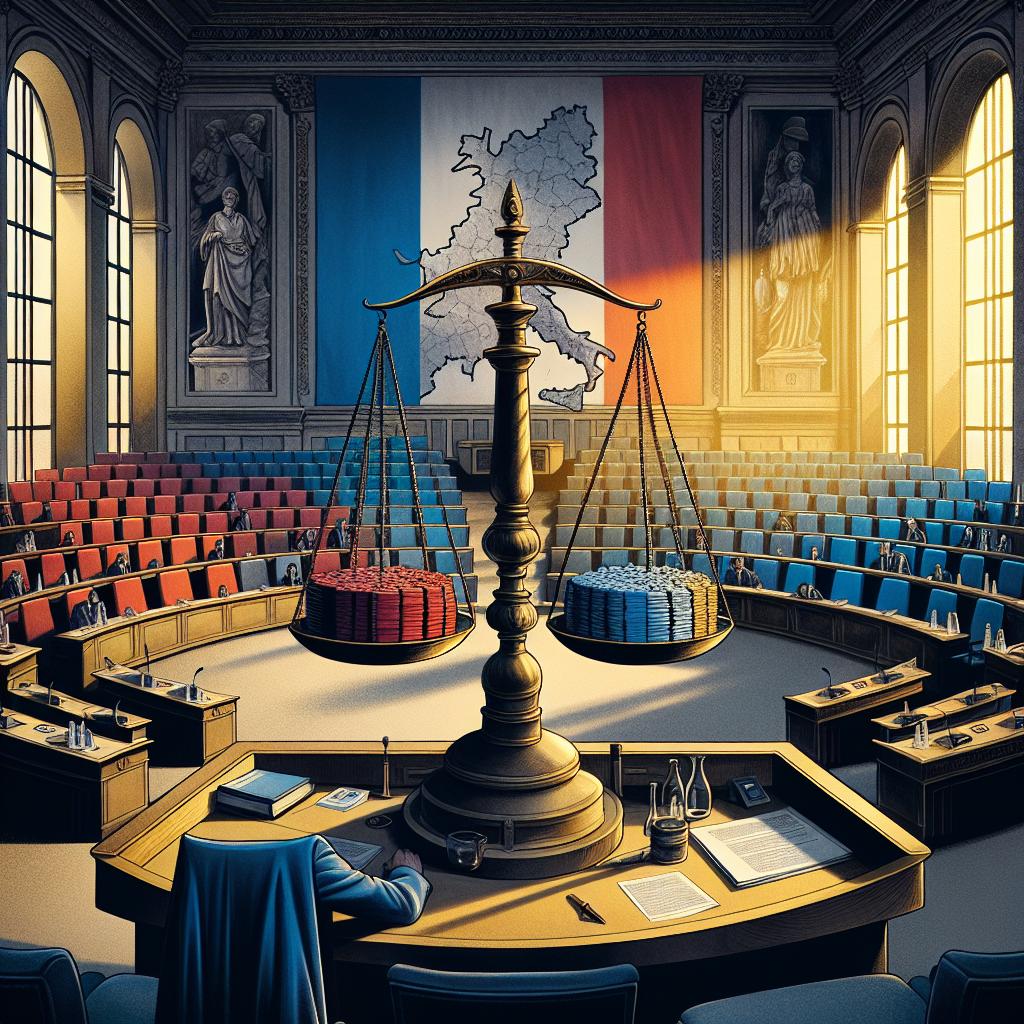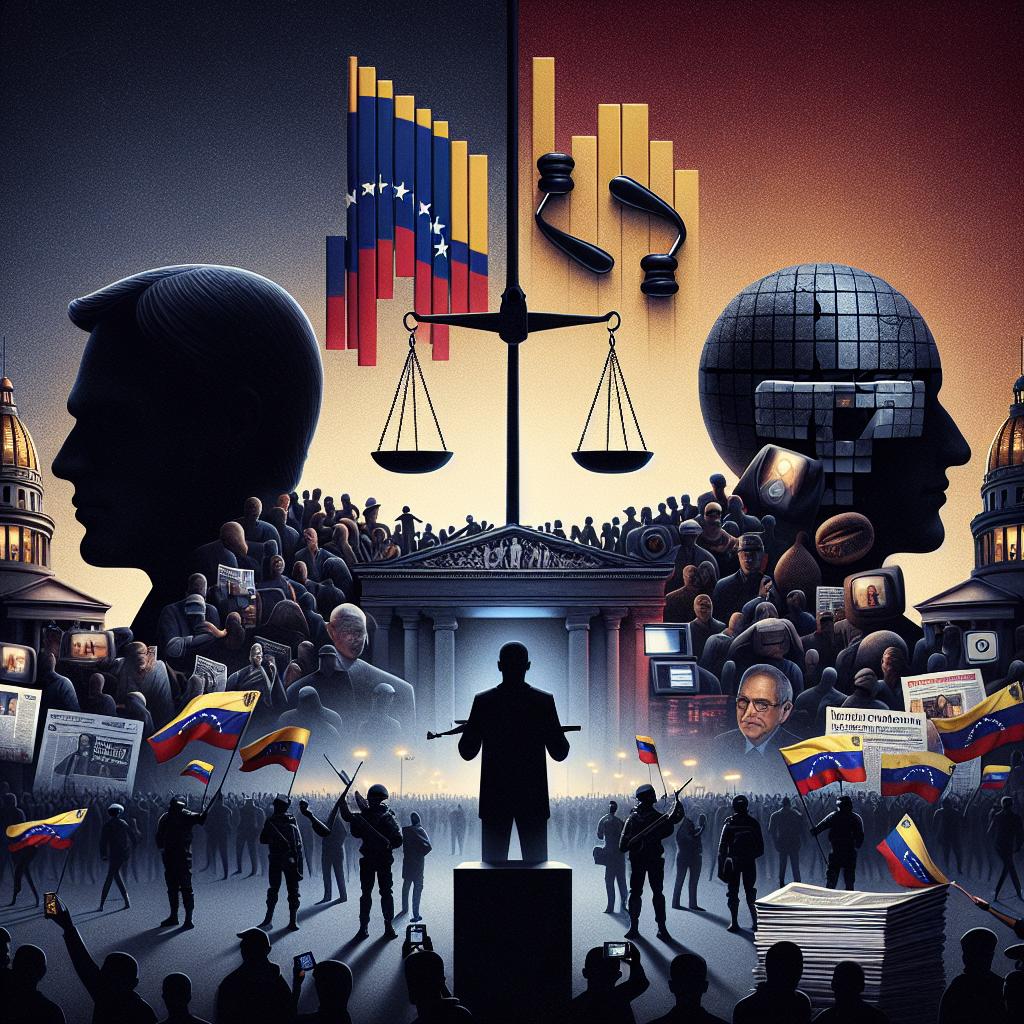En mars 1998, les élections régionales en France ont déclenché une crise politique nationale lorsque, le vendredi 20 mars, quatre présidents de région de droite ont été élus avec des apports de voix venus du Front national (FN). Charles Millon (Rhône-Alpes), Jean‑Pierre Soisson (Bourgogne), Charles Baur (Picardie) et Jacques Blanc (Languedoc‑Roussillon) ont accepté ces soutiens, provoquant une vive polémique sur l’existence d’un éventuel accord caché entre responsables de la droite et l’extrême droite.
Cette série d’alliances a trouvé son paroxysme en Franche‑Comté, où le FN a procédé de façon analogue au bénéfice du candidat centriste Jean‑François Humbert, issu de l’UDF. Contraint par ses propres engagements — il s’était publiquement engagé à « refuser la moindre collusion » avec le parti dirigé alors par Jean‑Marie Le Pen — Humbert a choisi de donner suite à sa parole et de démissionner, geste salué par une partie de la presse de l’époque qui l’a qualifié de « héros républicain ». Le texte d’origine indique que Jean‑François Humbert est mort le 20 novembre à Issoudun (Indre), à l’âge de 73 ans ; l’année du décès n’est pas précisée dans la source fournie.
Le rôle décisif du FN en Franche‑Comté
Le contexte électoral régional explique en grande partie la force de l’intervention du FN. En Franche‑Comté, le scrutin proportionnel à un tour a abouti à une situation d’égalité entre la gauche et la droite : 24 sièges chacun. Les neuf conseillers régionaux du Front national se sont retrouvés arbitres de la désignation du président de région.
Face à cette arithmétique, les options se sont réduites au jeu des majorités imposées par des accords ponctuels. La décision de quelques élus d’accepter des voix d’un parti classé à l’extrême droite a entraîné des réactions immédiates et passionnées, tant au sein des formations politiques qu’auprès de l’opinion publique.
Tensions internes et réactions partisanes
La décision d’accepter ou de rejeter les voix du FN a provoqué des tensions marquées au sein de la droite. Certains colistiers ont désapprouvé la position de Jean‑François Humbert, et les débats en interne sont décrits comme musclés. Ces désaccords montrent que le choix tactique de s’appuyer sur des élus d’extrême droite n’allait pas de soi pour les familles politiques traditionnelles.
À gauche, les conséquences ont été tout aussi importantes. Selon le texte d’origine, la présidence de la région, en cas de victoire de la gauche, serait revenue au Mouvement des citoyens (MDC). Les proches de Jean‑Pierre Chevènement se sont déclarés furieux, mais pour d’autres raisons que l’alliance avec le FN : la ligne suivie par le chef de file du Parti socialiste au conseil régional, Pierre Moscovici, a jeté de l’huile sur le feu. Moscovici, allié au Parti communiste et aux Verts dans ce scrutin, a engagé des discussions avec la droite, ce qui a suscité des critiques et des incompréhensions au sein de la gauche.
Ainsi, les alliances et les négociations post‑électorales ont brouillé les frontières habituelles entre familles politiques et mis en lumière des stratégies contradictoires. L’épisode a révélé l’existence d’un dilemme récurrent : préserver la pureté des positions idéologiques ou accepter des compromis pour accéder aux responsabilités exécutives.
Sur le plan national, l’acceptation par plusieurs présidents de région de soutiens venus de l’extrême droite a alimenté la controverse et intensifié les débats sur la normalisation du FN dans le jeu politique traditionnel. Le cas de la Franche‑Comté, où la démission de Jean‑François Humbert a suivi sa promesse de ne pas s’allier, a offert une image forte et contradictoire dans ce climat déjà tendu.
Sans apporter de jugement définitif, cet épisode de mars 1998 illustre la manière dont des règles électorales particulières et des équilibres locaux peuvent amener des choix politiques lourds de conséquences, tant pour les responsables concernés que pour la perception publique des pratiques partisanes.