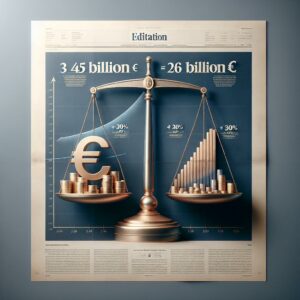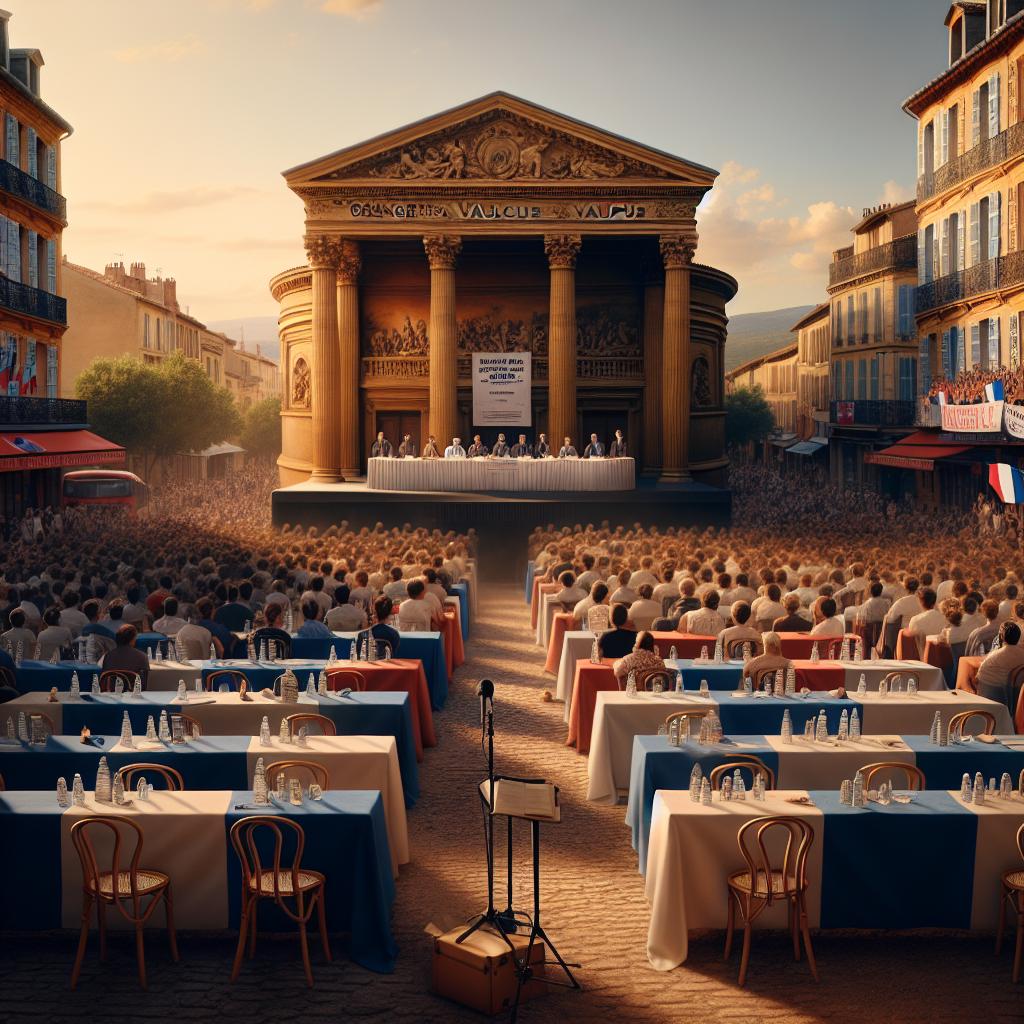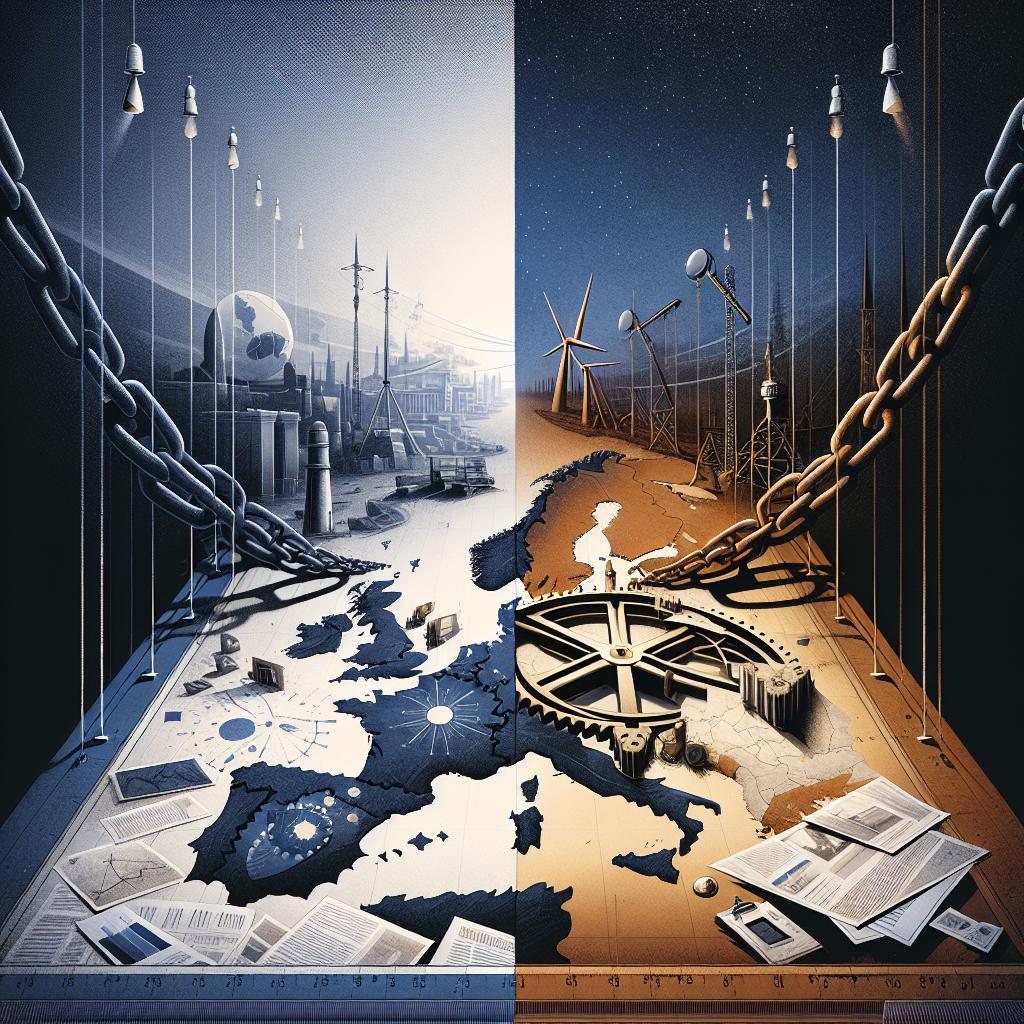À la prison de Nouméa, le Camp-Est concentre une surpopulation carcérale nette : près de 600 détenus s’entassent dans des cellules conçues pour en accueillir 400. Les bâtiments, décrits comme vétustes et hérités du bagne, abritent une population majoritairement kanak — plus de 90 % des personnes détenues selon les éléments disponibles — et constituent le lieu du premier grand affrontement lié à l’insurrection indépendantiste de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie.
La mutinerie du 13 mai 2024
Le 13 mai 2024, alors que des violences éclataient dans la ville de Nouméa, une mutinerie d’ampleur s’est déclenchée l’après-midi à l’intérieur du Camp-Est. Trois surveillants ont été pris en otage au cours de cette révolte, qui a rapidement pris une tournure violente derrière les murs de la prison.
Les autorités ont dépêché des unités d’intervention spécialisées. L’intervention a été conduite par le RAID, force d’élite de la police nationale, qui a réprimé la mutinerie et permis la libération des otages. Cette opération a marqué le début de plusieurs jours de crise au sein de l’établissement pénitentiaire.
Enquête, témoignages et reconstitution
Après plusieurs mois d’enquête, le quotidien Le Monde a reconstitué le déroulé des faits conduisant à la mort d’un détenu identifié par un prénom d’emprunt, James. Selon l’enquête et de multiples témoignages, dont ceux de 13 détenus cités, James serait décédé des suites de blessures subies lors de l’intervention des forces de l’ordre.
Le Monde précise avoir recoupé plusieurs déclarations et éléments d’enquête pour établir cette chronologie. Les informations publiées restent, cependant, soumises à la vérification des autorités et à l’examen de pièces judiciaires qui n’ont pas toutes été rendues publiques au moment du reportage.
Bilan humain et divergences de comptage
La mort de James porte, selon la reconstitution citée, le nombre de décès liés aux émeutes de 2024 à quinze personnes. Le bilan officiel, tel que mentionné dans les éléments disponibles, demeure à 14 tués : 11 Kanak, 2 gendarmes et 1 Caldoche. Les différences entre ces comptes rendent nécessaire une prudence sur les chiffres définitifs, d’autant que « d’autres cas restés dans l’ombre sur le territoire » sont évoqués et pourraient affecter le décompte.
La divergence entre le chiffre avancé par la reconstitution et le bilan officiel illustre la difficulté à établir un total incontestable dans un contexte de violence étendue et de procédures d’enquête en cours. Les autorités compétentes sont les seules habilitées à confirmer définitivement le nombre de victimes après clôture des investigations.
Un contexte carcéral tendu
Le récit des événements s’inscrit dans un contexte de surpopulation et d’infrastructures dégradées au Camp-Est. La présence majoritaire de détenus kanak dans ces bâtiments renvoie à des dynamiques sociales et politiques plus larges qui ont marqué l’île et qui ont contribué à l’explosion de violences en mai 2024.
Les conditions matérielles — promiscuité, vétusté des locaux et ressources limitées — ont été mises en avant par des sources comme des facteurs aggravants lors des périodes de tension. Ces éléments ne dispensent pas, toutefois, d’une enquête indépendante pour établir les responsabilités et comprendre précisément comment l’intervention a entraîné le décès de James.
Le cas souligne aussi les enjeux de transparence et de communication des autorités pénitentiaires et judiciaires dans des moments de crise. La coexistence d’enquêtes journalistiques et d’investigations officielles expose parfois des récits divergents qui obligent à la prudence avant toute affirmation définitive.
En l’état des informations accessibles publiquement, le récit rendu par Le Monde et fondé sur plusieurs témoignages apporte un éclairage sur les circonstances internes à la prison le 13 mai 2024. Mais il reste soumis à vérifications complémentaires et aux suites judiciaires qui pourront, le cas échéant, confirmer ou nuancer ces éléments.