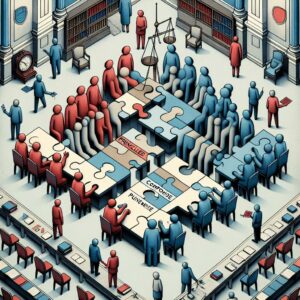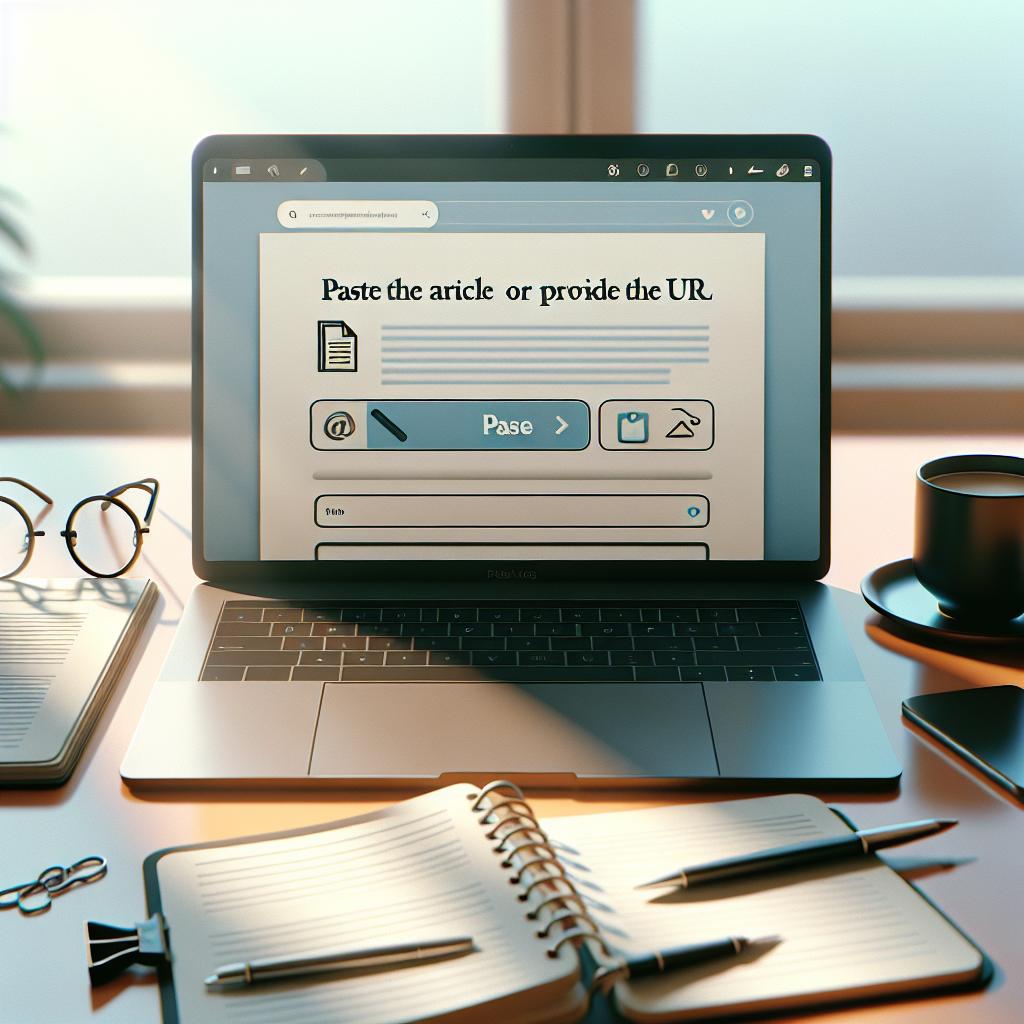Un an après l’abaissement de la vitesse, des résultats partagés
En octobre 2024, la vitesse maximale sur le boulevard périphérique parisien est passée de 70 à 50 km/h sur l’ensemble de l’anneau de 35 km entourant la capitale. Cette décision, prise par la maire de Paris Anne Hidalgo, visait principalement à réduire les nuisances sonores pour les populations riveraines et a suscité une vive opposition politique, notamment de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse (LR).
Le boulevard périphérique est décrit comme l’autoroute urbaine la plus fréquentée d’Europe, avec un trafic quotidien d’environ 1,1 million de véhicules. Selon l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR), près de 600 000 habitants vivent dans un rayon de 500 mètres de part et d’autre de l’anneau. L’APUR publie un rapport d’étape daté du mercredi 24 septembre 2025 qui fait le point sur l’effet de la nouvelle limitation de vitesse et des autres mesures associées.
Bruit : une baisse moyenne, mais des seuils toujours dépassés
L’APUR observe une baisse moyenne du niveau sonore de 2,7 décibels entre octobre 2024 et juin 2025, comparée à la même période l’année précédente. Cette diminution est mesurée sur les indicateurs suivis par l’agence en lien avec la Ville de Paris.
Pour autant, les niveaux sonores restent supérieurs aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif, l’observatoire régional du bruit en Île-de-France, a indiqué à l’Agence France-Presse que 13 000 habitants demeurent en « situation critique », soit 6 000 personnes de moins qu’il y a un an.
Trafic et sécurité : fluidité et moins d’accidents, selon l’APUR
Sur la période étudiée, le trafic a gagné en fluidité. L’APUR relève une diminution moyenne des heures d’embouteillage de 14 % et une baisse du nombre d’accidents dans la même proportion. Ces chiffres témoignent d’effets positifs sur la circulation diurne et sur la sécurité, selon l’agence d’urbanisme.
L’APUR précise également suivre, en collaboration avec la Ville, huit indicateurs afin d’évaluer l’impact global de la mesure. Le rapport d’étape rappelle que, depuis mars 2025, une voie du périphérique a été réservée au covoiturage, disposition présentée comme l’héritage de la « voie olympique ».
Positions contrastées et débats sur le bilan
L’Institut Paris Region, mandaté par la région pour un suivi indépendant à partir de données GPS, adopte une lecture plus réservée des résultats. Selon cet institut, « le seul effet significatif, c’est la diminution de la vitesse la nuit », interprétée comme un signe que la limitation est respectée. L’analyse met en garde contre l’interprétation trop large des effets de la mesure sur d’autres paramètres.
La réduction de la vitesse ne fait pas l’unanimité parmi les élus. Valérie Pécresse a dénoncé la mesure comme « antisociale », affirmant devant le conseil régional qu’elle entraînait une perte de temps pour les usagers évaluée à « 20 000 heures par jour ». Ce chiffre, avancé par la présidente de la région, illustre la focalisation politique sur le coût en temps pour les automobilistes.
Qualité de l’air : un impact difficile à isoler
L’effet de l’abaissement de la vitesse sur la qualité de l’air reste, selon les acteurs cités, difficile à isoler. La pollution atmosphérique dépend de nombreux facteurs météorologiques et d’émissions diverses, ce qui complique l’attribution d’évolutions observées à une seule mesure de vitesse.
Le rapport d’étape de l’APUR et les commentaires des organismes impliqués insistent sur la nécessité de poursuivre le suivi sur le long terme. Ils soulignent qu’une évaluation complète doit combiner plusieurs sources de données et tenir compte des variations saisonnières et climatiques.
Perspectives et points à surveiller
À la date du rapport — mercredi 24 septembre 2025 —, les premiers effets mesurables semblent aller dans le sens des objectifs initiaux : réduction du bruit et amélioration de la fluidité. Cependant, les niveaux sonores demeurent supérieurs aux recommandations de santé publique et un nombre significatif d’habitants reste exposé à des nuisances importantes.
Les prochains rapports devront préciser l’évolution des tendances, en particulier sur la qualité de l’air et l’impact réel des voies réservées au covoiturage. Les autorités locales et régionales continueront de s’appuyer sur des jeux de données distincts, et leurs interprétations divergentes invitent à la prudence avant de tirer des conclusions définitives.
En l’état, la baisse de la vitesse a produit des effets concrets mais partiels; le débat politique et l’exigence d’un suivi approfondi persistent.