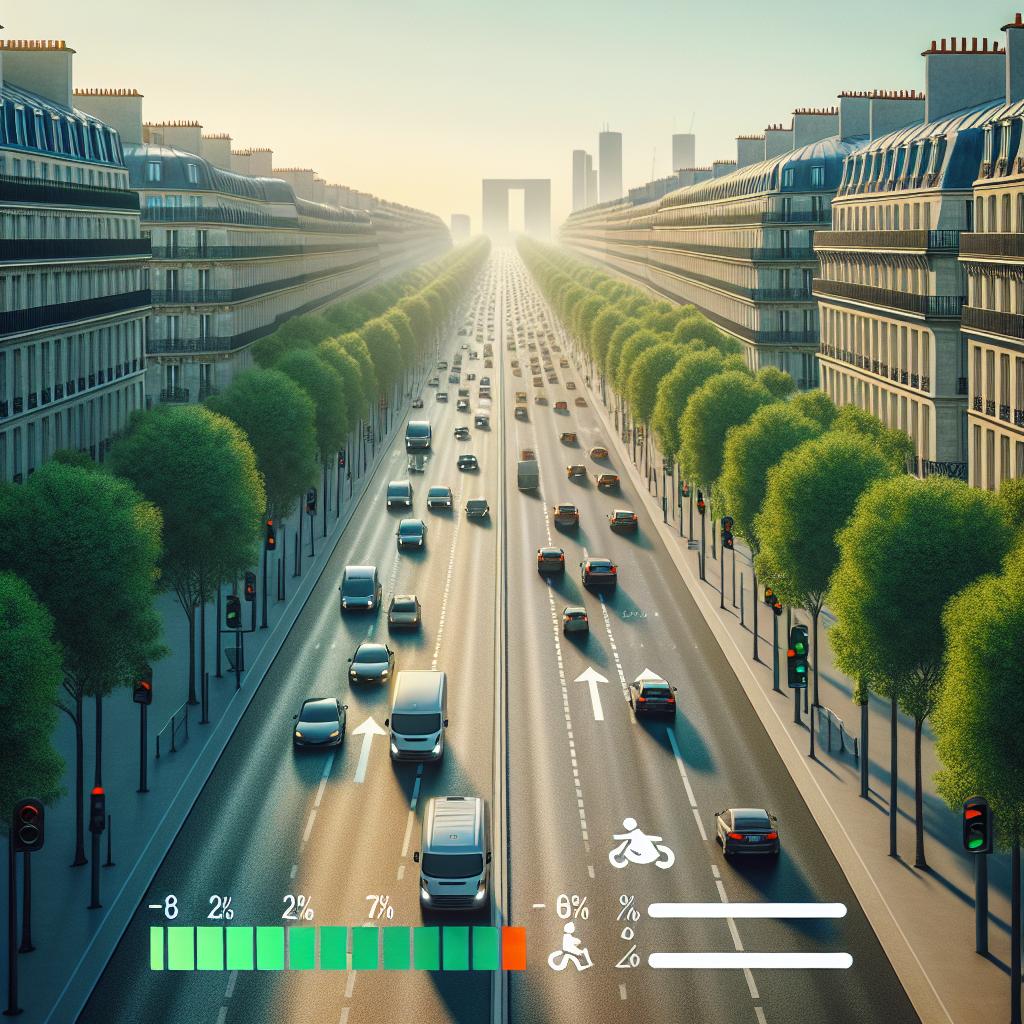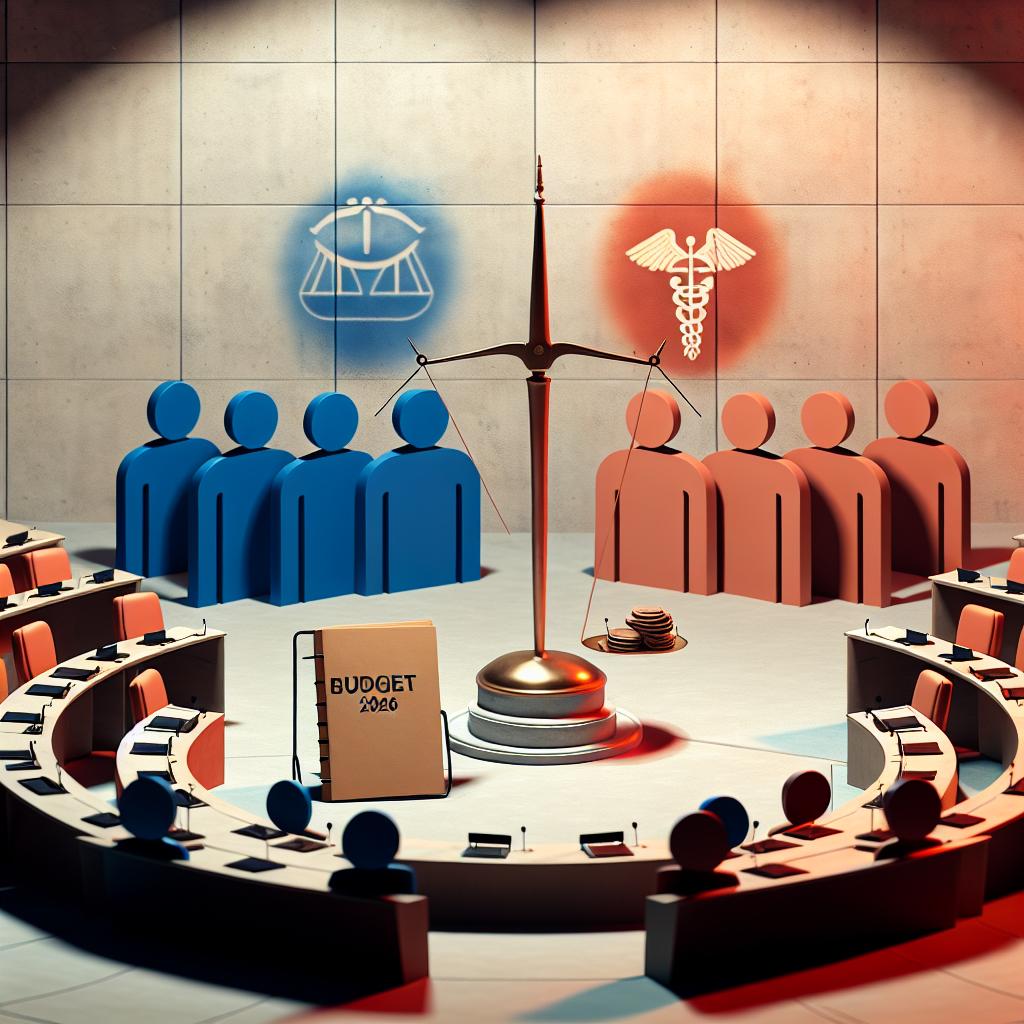Un an après l’abaissement de la vitesse à 50 km/h sur le boulevard périphérique parisien et sept mois après l’instauration d’une voie réservée au covoiturage, deux études récentes proposent des premiers éléments de bilan sur le trafic et la qualité de l’air. Les premières conclusions sont plutôt favorables, mais elles restent partielles et demandent prudence dans leur interprétation.
Ce que montrent les évaluations
Dernière en date, l’évaluation rendue publique mercredi 1er octobre par Airparif — l’organisme indépendant de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France — met en avant des « résultats significatifs » et une « amélioration de la qualité de l’air » aux abords directs du périphérique. L’étude signale en particulier une « baisse moyenne des concentrations en dioxyde d’azote » (NO₂), polluant majoritairement lié au trafic routier et associé à des troubles respiratoires.
Parallèlement, les observations de trafic retenues par Airparif montrent une réduction moyenne de la circulation de l’ordre de 4 % depuis 2023 sur le périphérique. Selon l’organisme, cette baisse dépasse la tendance à long terme observée sur les vingt dernières années et semble liée, au moins en partie, aux mesures récentes : limitation de la vitesse et création d’une voie réservée au covoiturage.
Méthodologie : une « approche par scénarisation »
Pour isoler l’effet des seules mesures de limitation de vitesse et de la voie covoiturage — et mettre ainsi entre parenthèses l’évolution des moteurs et l’influence météorologique — Airparif a utilisé ce qu’il qualifie d’« approche par scénarisation ». Concrètement, l’organisme applique les mesures réelles de pollution relevées en 2023 au niveau de trafic observé en 2025 afin d’estimer l’impact spécifique des changements de circulation.
Cette méthode permet d’affiner l’attribution des évolutions de concentrations de polluants au seul changement de conditions de circulation. Mais il s’agit d’une estimation modélisée et non d’une mesure directe isolant expérimentalement chacune des variables en situation réelle.
Résultats chiffrés et limites de l’analyse
En combinant les données de trafic et la scénarisation, Airparif estime une baisse moyenne des concentrations de NO₂ d’environ −6 %. L’organisme précise toutefois qu’il s’agit d’une estimation résultant de la méthodologie retenue, et non d’une mesure objective inaltérable sur le terrain.
Plusieurs limites apparaissent immédiatement. D’abord, la scénarisation repose sur l’hypothèse de conditions météorologiques et d’émissions autres (par exemple domestiques ou industrielles) constantes, ce qui n’est pas toujours vérifiable. Ensuite, la modélisation transpose des mesures de 2023 sur un contexte de trafic de 2025 : cette opération suppose la comparabilité des relevés et la stabilité des sources hors trafic, hypothèses pouvant introduire des marges d’erreur.
Enfin, les effets de court terme observés aux « abords directs » du périphérique ne rendent pas compte nécessairement des impacts plus larges en Île-de-France, ni des éventuels effets de report du trafic vers d’autres axes. Sur ces points, l’évaluation reste incomplète et appelle des analyses complémentaires.
Interprétation et perspectives
Le signal principal qui se dégage est donc positif : les mesures prises semblent avoir contribué à réduire le trafic et, selon la scénarisation d’Airparif, à diminuer les concentrations de NO₂ aux abords du périphérique. L’ampleur estimée, une baisse moyenne de l’ordre de 6 % du NO₂, reste modeste mais potentiellement significative pour la qualité de l’air locale.
Toutefois, la prudence reste de mise. Les résultats reposent sur des estimations et des hypothèses méthodologiques qui limitent la portée des conclusions. Pour confirmer et affiner le bilan, il faudra des séries de mesures continues, des contrôles complémentaires sur d’autres polluants et des études évaluant d’éventuels déplacements du trafic.
En l’état, ces premières évaluations fournissent un premier indicateur utile pour les décideurs et les riverains, mais elles ne suffisent pas à établir définitivement l’efficacité à long terme des mesures sans analyses supplémentaires et sans suivi rigoureux des conditions réelles de circulation et d’émission.