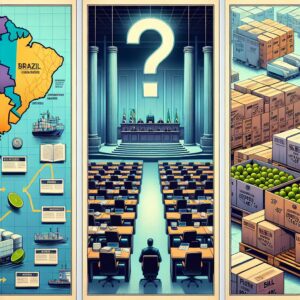Le chercheur chargé d’analyser des ossements découverts au cimetière de Rivesaltes a indiqué aux familles, lundi 27 octobre, que ces restes appartiendraient vraisemblablement à des réfugiés harkis décédés dans le camp de la commune dans les années 1960, selon un communiqué de la préfecture.
Résultats de l’analyse scientifique
Lors d’une réunion tenue à Perpignan, le professeur en anthropologie biologique Pascal Adalian, basé à Marseille, a présenté ses conclusions aux familles. Il a identifié « le nombre minimum d’individus présents dans les ossuaires : au minimum 49 très jeunes enfants, de moins de 3 ans, et trois adultes », et a situé ces décès « au début des années 1960 » grâce à la datation par le carbone, a précisé à l’Agence France-Presse le secrétaire général de la préfecture, Bruno Berthet.
Le total minimal établi par le chercheur — 49 enfants et 3 adultes, soit 52 dépouilles — a été confirmé comme compatible avec les disparitions signalées par les familles. Selon Bruno Berthet, « le nombre d’ossements, ainsi que l’âge au moment de la mort, sont cohérents avec les personnes dont les corps avaient disparu. »
Le professeur Adalian a également rappelé aux 14 représentants de familles présents, en personne ou par visioconférence, « les limites de l’exercice » : son évaluation établit un nombre minimal d’individus, mais n’exclut pas la possibilité qu’il y en ait davantage. « Il a pu aller au maximum de ce que la science lui permet », a résumé M. Berthet. Les échanges avec les familles ont duré environ deux heures.
Découverte et conditions de conservation
À l’automne 2024, des tombes ont été repérées sur le périmètre du camp Joffre, mais, une fois les sépultures ouvertes, elles se sont révélées vides. Le 21 février, lors d’une visite de l’ancienne ministre déléguée à la mémoire Patricia Miralles, les familles ont appris que les dépouilles avaient été déplacées en septembre 1986.
Quatre caisses ont ensuite été retrouvées dans le cimetière communal de Rivesaltes et contenaient « des milliers d’ossements ». Le constat de restes mélangés a rendu plus difficile l’identification individuelle : selon un descendant de harkis présent après la réunion, « il y a des ossements d’une même personne qui ont été retrouvés dans deux caisses différentes, ça montre la sauvagerie avec laquelle ils ont extrait ces corps (…) Mon frère jumeau est dans ce magma d’ossements mélangés. »
Contexte historique et chiffres
Le camp Joffre, à Rivesaltes, a accueilli près de 22 000 harkis — auxiliaires algériens de l’armée française — et leurs familles après l’indépendance de l’Algérie, entre 1962 et 1965. Au moins 146 personnes y sont mortes, dont 101 enfants. Les corps de 60 d’entre eux, parmi lesquels 52 bébés, n’avaient jamais été retrouvés jusqu’à ces découvertes.
Les éléments présentés par l’anthropologue s’inscrivent dans ce cadre historique et viennent corroborer, selon la préfecture, l’hypothèse que les ossements retrouvés appartiennent à des personnes décédées dans le camp pendant cette période.
Réactions familiales et décisions à venir
La réunion a été marquée par l’émotion et les questions pratiques des familles concernant le sort des ossements. Dans les semaines ou les mois à venir, elles devront décider de la destination de ces restes.
Le maire de Rivesaltes a proposé trois emplacements au sein du cimetière communal pour la création d’un lieu de recueillement, ainsi qu’une option supplémentaire sur le terrain de l’ancien camp de réfugiés. Les familles et les autorités locales devront désormais s’accorder sur la suite à donner, en tenant compte des contraintes scientifiques et des souhaits des proches.
Les limites méthodologiques évoquées par le professeur Adalian — notamment l’évaluation d’un « nombre minimum d’individus » et la possibilité de restes dispersés entre plusieurs contenants — soulignent la complexité de l’identification postérieure à des manipulations antérieures des dépouilles.
Les conclusions présentées lundi fournissent toutefois un cadre factuel nouveau pour les familles et les autorités, en rapprochant données archéologiques et dossiers historiques. Elles ouvrent aussi la voie à des décisions administratives et mémorielles, qui devront tenir compte des contraintes scientifiques et des attentes des descendants.