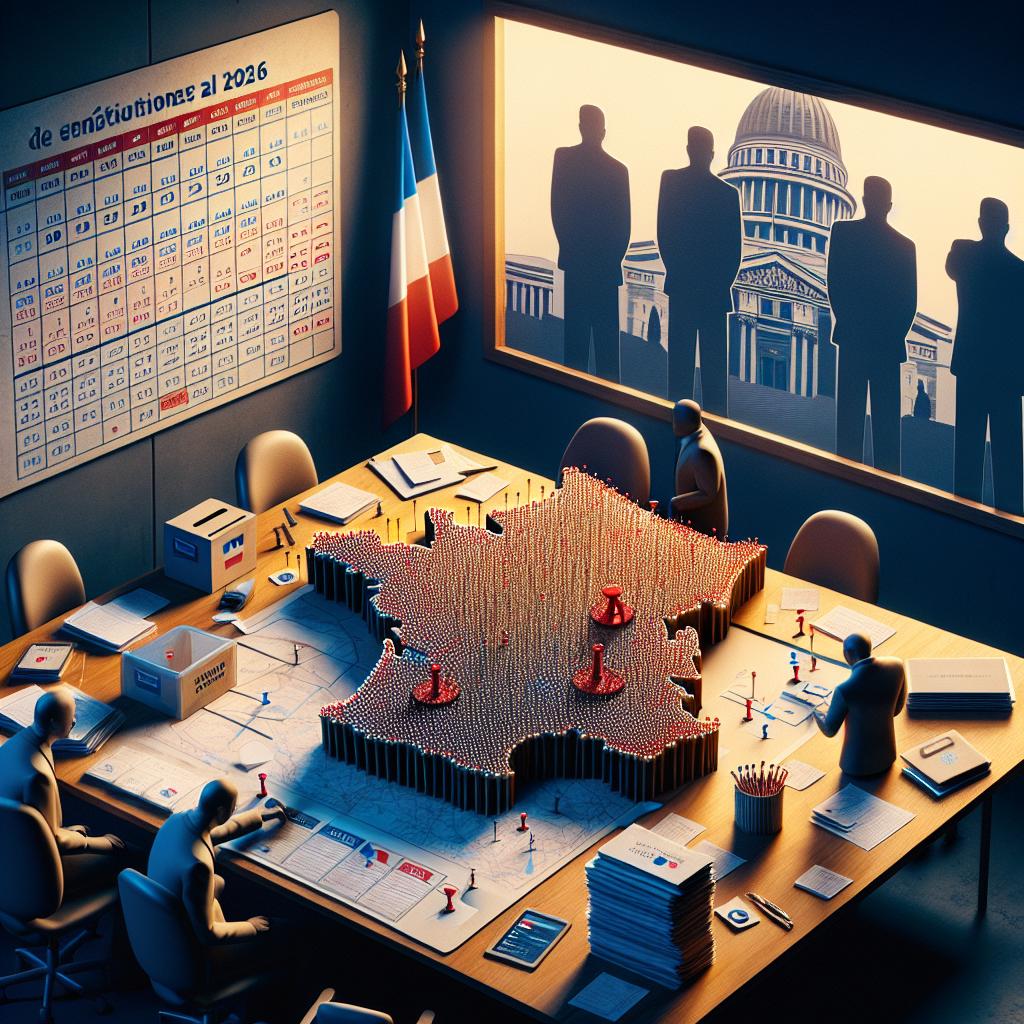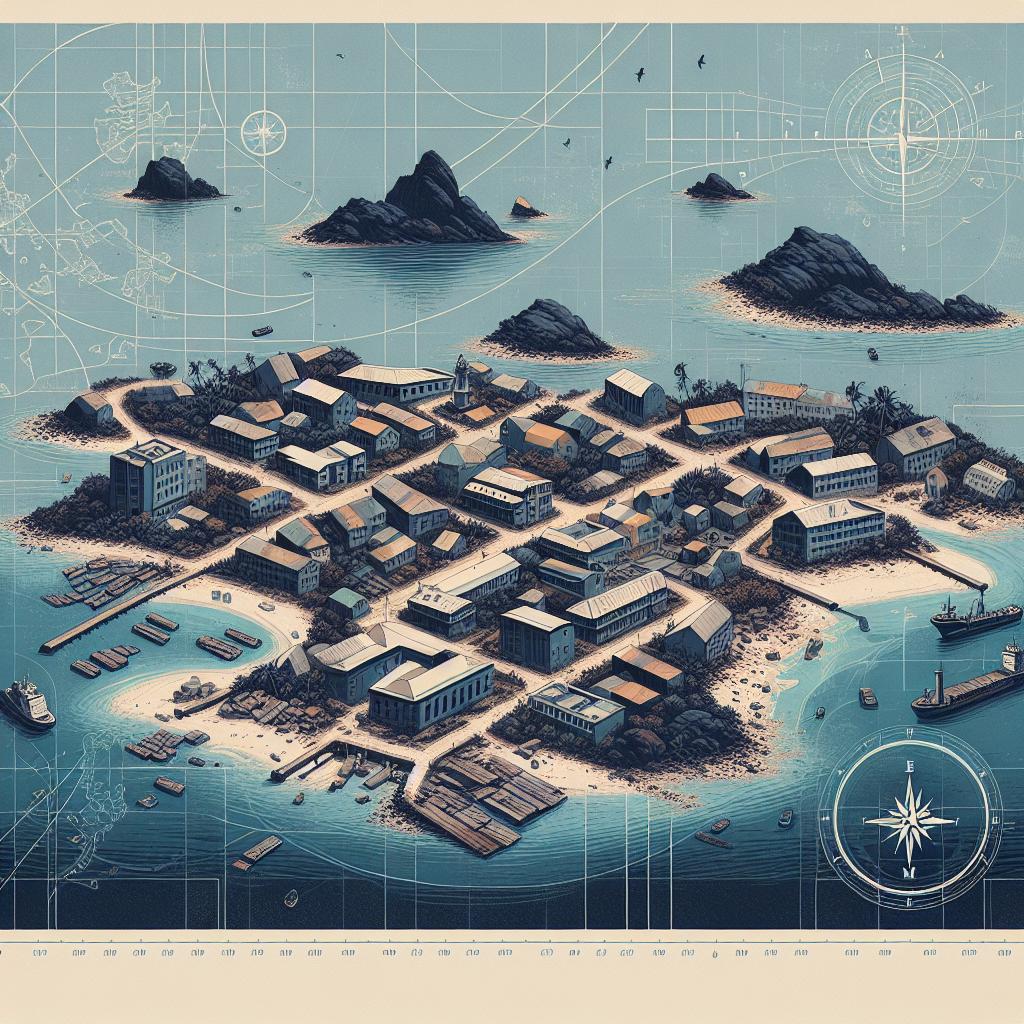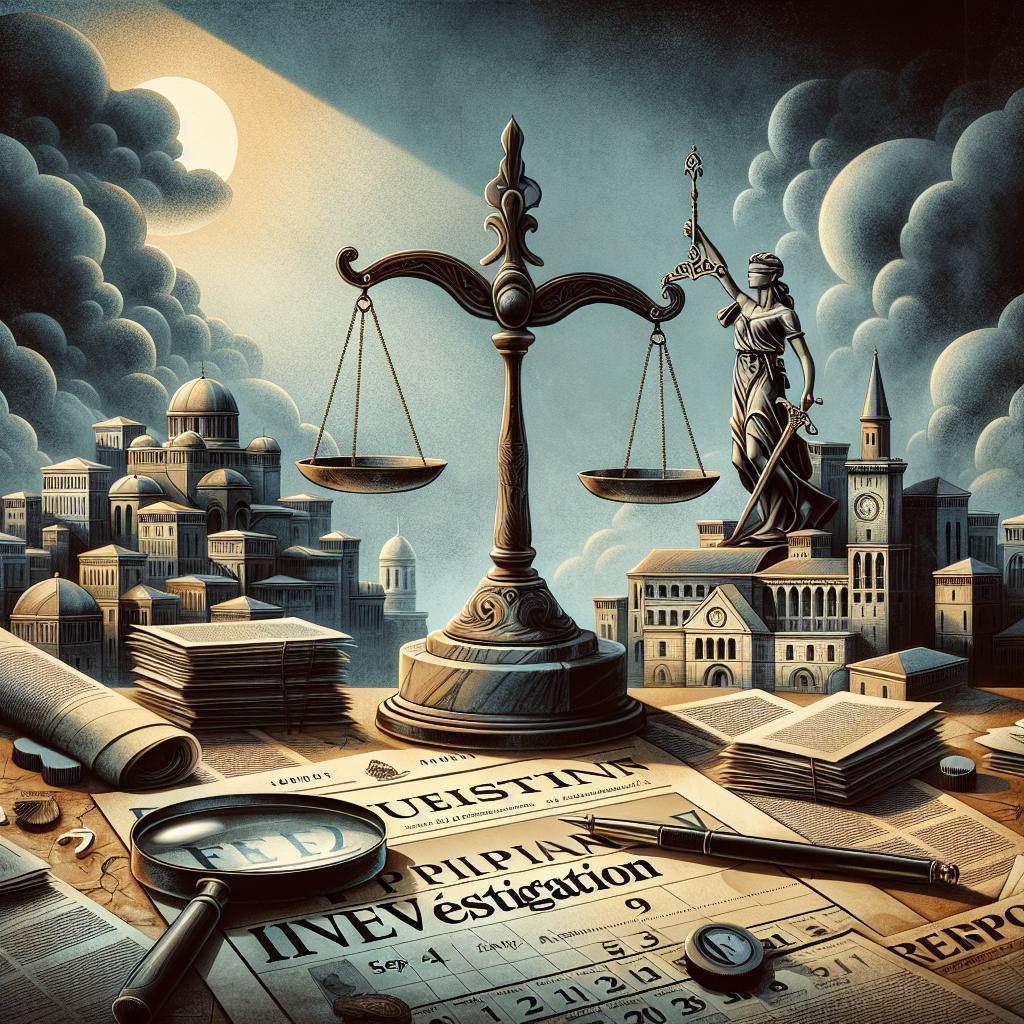Contexte et faits
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt concernant la reconnaissance, par un État membre, d’un mariage conclu légalement entre personnes de même sexe dans un autre État membre. L’affaire a été saisie à la suite d’un litige engagé par deux ressortissants polonais, dont l’un possède également la nationalité allemande.
Le couple s’était marié à Berlin en 2018 alors qu’il résidait en Allemagne, avant de regagner la Pologne. Les autorités polonaises ont refusé la transcription de l’acte de mariage dans le registre d’état civil national, au motif que le droit polonais ne prévoit pas l’institution du mariage entre personnes de même sexe. Les époux ont contesté cette décision et saisi la justice, procédure qui a conduit à une question préjudicielle posée à la CJUE par la Cour administrative suprême polonaise.
Dans le texte initial fourni, la date de l’arrêt de la CJUE apparaît de manière contradictoire : il est fait mention d’un « mardi 25 décembre » et, ailleurs, d’un « 25 novembre ». Je conserve ces indications telles qu’elles figurent dans le document source sans prendre position sur la date exacte.
La décision de la CJUE
La CJUE juge que le refus des autorités nationales de reconnaître, aux fins de l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union, un mariage conclu légalement dans un autre État membre, viole plusieurs droits garantis aux citoyens européens. La Cour relève notamment l’atteinte à la liberté de circulation, à la liberté de séjour et au respect de la vie privée et familiale.
La CJUE précise cependant que cette obligation de reconnaissance, limitée à l’exercice des droits découlant du droit de l’Union, n’oblige pas l’État membre à introduire dans son droit national l’institution du mariage entre personnes de même sexe. Autrement dit, un État peut ne pas légaliser le mariage homosexuel au plan interne, mais il doit, dans certaines circonstances liées à l’application du droit de l’Union, reconnaître le statut marital acquis légalement dans un autre État membre.
La Cour formule cette idée de façon explicite : « Les États membres sont donc obligés de reconnaître, à des fins d’exercice des droits conférés par le droit de l’Union, le statut marital acquis légalement dans un autre État membre. » Cette formulation est reprise dans le communiqué mentionné dans le dossier.
Conséquences et état des lieux dans l’Union européenne
L’arrêt a des implications pratiques pour les ressortissants de l’Union qui se déplacent ou s’installent entre États membres. Il limite la possibilité pour un État de priver un couple marié légalement ailleurs de droits attachés au statut marital lorsque ces droits relèvent du champ du droit de l’Union.
Sur le plan législatif, la situation varie fortement selon les États membres. Selon le texte d’origine, 16 pays de l’Union reconnaissent actuellement le mariage homosexuel, avec les dates d’adoption suivantes : Pays-Bas (2001), Belgique (2003), Espagne (2005), Suède (2009), Portugal (2010), Danemark (2012), France (2013), Luxembourg (2015), Irlande (2015), Malte (2017), Allemagne (2017), Finlande (2017), Autriche (2019), Slovénie (2022), Estonie (2024) et Grèce (2024).
Par ailleurs, 22 pays membres autorisent une forme de partenariat civil (« partenariat enregistré » ou « partenariat civil ») destinée aux couples de même sexe, à l’image du PACS en France. Enfin, cinq États membres de l’Union ne reconnaissent, selon le même document, aucune forme d’union officielle pour les couples homosexuels.
L’arrêt de la CJUE ne modifie pas directement les régimes nationaux du mariage, mais il crée une contrainte d’ordre européen quant à la reconnaissance administrative du statut marital acquis légalement dans un autre État membre lorsque des droits de l’Union sont en jeu. Les conséquences administratives et juridiques concrètes dépendront désormais des autorités nationales et des juridictions applicables, appelées à appliquer la logique de la Cour dans des cas similaires.
Procédure en cours
L’affaire est revenue de la juridiction nationale vers la CJUE dans le cadre d’un renvoi préjudiciel. À présent, il appartient aux juridictions polonaises compétentes d’appliquer la décision de la CJUE au litige individuel, en prenant en compte les limites exprimées par la Cour concernant l’étendue de l’obligation de reconnaissance.
Le litige illustre la tension persistante entre la diversité des régimes matrimoniaux nationaux et l’application uniforme de certains droits au niveau de l’Union européenne.