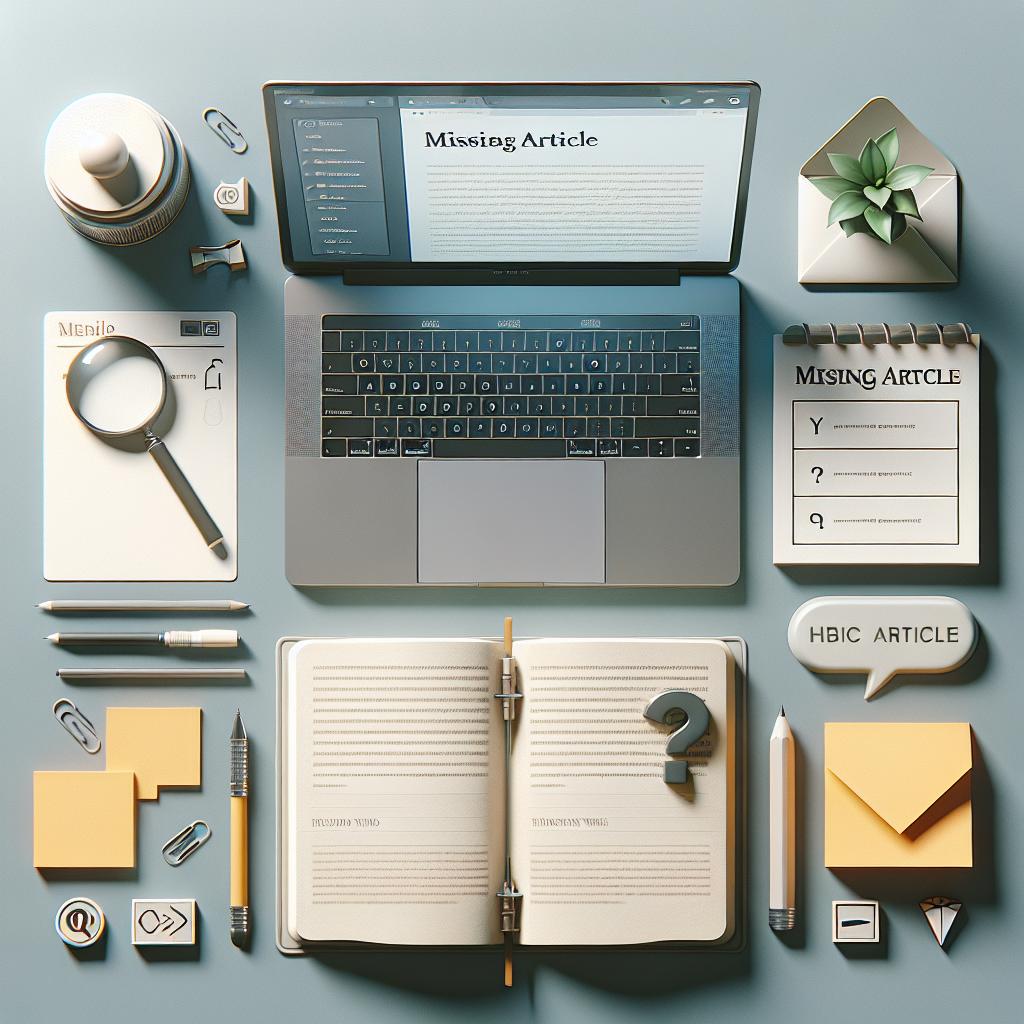Depuis le début de l’année 2025, près de 360 000 hectares de forêt (357 598 ha selon Copernicus) ont déjà été touchés par des incendies sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, indique l’observatoire européen Copernicus. Le phénomène s’inscrit dans un contexte de vagues de chaleur récurrentes qui transforment les feux géants en nouvelles normes plutôt qu’en événements exceptionnels.
Un épisode meurtrier et des dégâts considérables
Dernier exemple en date : un violent incendie s’est déclaré à Ribaute, dans l’Aude, mardi 5 août en fin d’après‑midi. Les dégâts y sont jugés considérables et certains experts estiment déjà qu’il pourrait s’agir du plus grand incendie enregistré en France depuis cinquante ans, selon les éléments rapportés sur place.
« C’est une catastrophe d’une ampleur inédite », a déploré François Bayrou, présenté dans le texte comme Premier ministre, lors d’une visite sur place le 6 août. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué sur la plateforme X : « Nous sommes prêts à mobiliser les ressources de rescEU pour soutenir les efforts ».
Cartographie et chiffres : une hausse notable des départs de feu
Le système européen d’information sur les incendies de forêt (EFFIS) recense 1 478 incendies détectés depuis le début de l’année dans l’Union, un nombre en progression par rapport à la même période de l’année précédente (1 030). La répartition nationale montre que la Roumanie comptait, à la date de publication, 444 feux déclarés, suivie de l’Italie (344) et de la France (238).
À la date du lundi 28 juillet, 236 feux de forêt avaient déjà été relevés en France, rappelle EFFIS. Si le nombre d’occurrences n’est pas automatiquement synonyme de dégâts plus importants, certains petits territoires comme Chypre — qui n’a recensé que trois incendies au 5 août — ont déjà vu 2,30 % de leur territoire partir en fumée. En comparaison, ce taux est de 0,18 % en Italie, 0,52 % en Roumanie et 0,04 % en France.
Ces chiffres doivent être lus au regard de la superficie des pays : la France, avec 638 475 km2 (territoires d’outre‑mer inclus), est le plus vaste pays de l’UE, alors que la Roumanie couvre 238 398 km2 et Chypre 9 253 km2.
La distribution des incendies est inégale : plusieurs États (Slovénie, Slovaquie, Lettonie) n’ont enregistré qu’un seul feu, tandis que la Roumanie, l’Italie et la France concentrent un plus grand nombre de départs. Cinq États membres — Estonie, Lituanie, Luxembourg, Malte et République tchèque — n’avaient, au 6 août, signalé aucun incendie.
Climat, précocité et risques d’extension
La précocité et la multiplication des départs sont mises en relation avec le réchauffement climatique. Le chercheur Julien Ruffault, cité dans Les Colonnes du Monde, rappelle que « les incendies d’aujourd’hui ne sont pas ceux du passé » : ils se déclarent de plus en plus tôt dans la saison et leur caractère extrême est favorisé par les conditions thermiques et d’humidité.
Sur le plan global, l’année 2024 a vu la température moyenne mondiale dépasser le seuil symbolique de +1,5 °C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle, limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris (2015). En Méditerranée, la température de la mer a enregistré une hausse moyenne de +1,74 °C, contribuant à faire de la zone un « hotspot climatique » propice à des événements extrêmes, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) cité dans le texte.
Réponse européenne et coopération opérationnelle
Face à la dégradation de la situation, l’Union européenne renforce son dispositif de prévention et d’intervention pour la saison estivale. Selon un communiqué de la Commission européenne du 26 mai, 641 sapeurs‑pompiers venus de 14 pays européens ont été « stratégiquement positionnés » dans des sites à haut risque en France, Grèce, Portugal et Espagne.
En outre, une flotte de 22 avions spécialisés et 4 hélicoptères est prépositionnée dans 10 États membres afin d’intervenir rapidement, tandis que 19 équipes au sol d’environ 30 pompiers chacune sont maintenues en alerte. Une équipe d’experts est également disponible pour fournir des conseils techniques et évaluer la situation sur le terrain.
Le mécanisme de protection civile de l’UE, qui peut être activé lorsqu’un État ne dispose pas de capacités suffisantes face à une catastrophe, réunit les 27 États membres et 10 pays tiers (Albanie, Bosnie‑Herzégovine, Islande, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Norvège, Serbie, Turquie, Ukraine). Toutes ces actions sont coordonnées via le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC), opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La multiplication des feux et l’ampleur des dégâts montrent l’importance d’une coopération renforcée, tant pour la prévention que pour la capacité de réponse immédiate face à des épisodes qui, selon les observations, se normalisent sous l’effet du réchauffement.