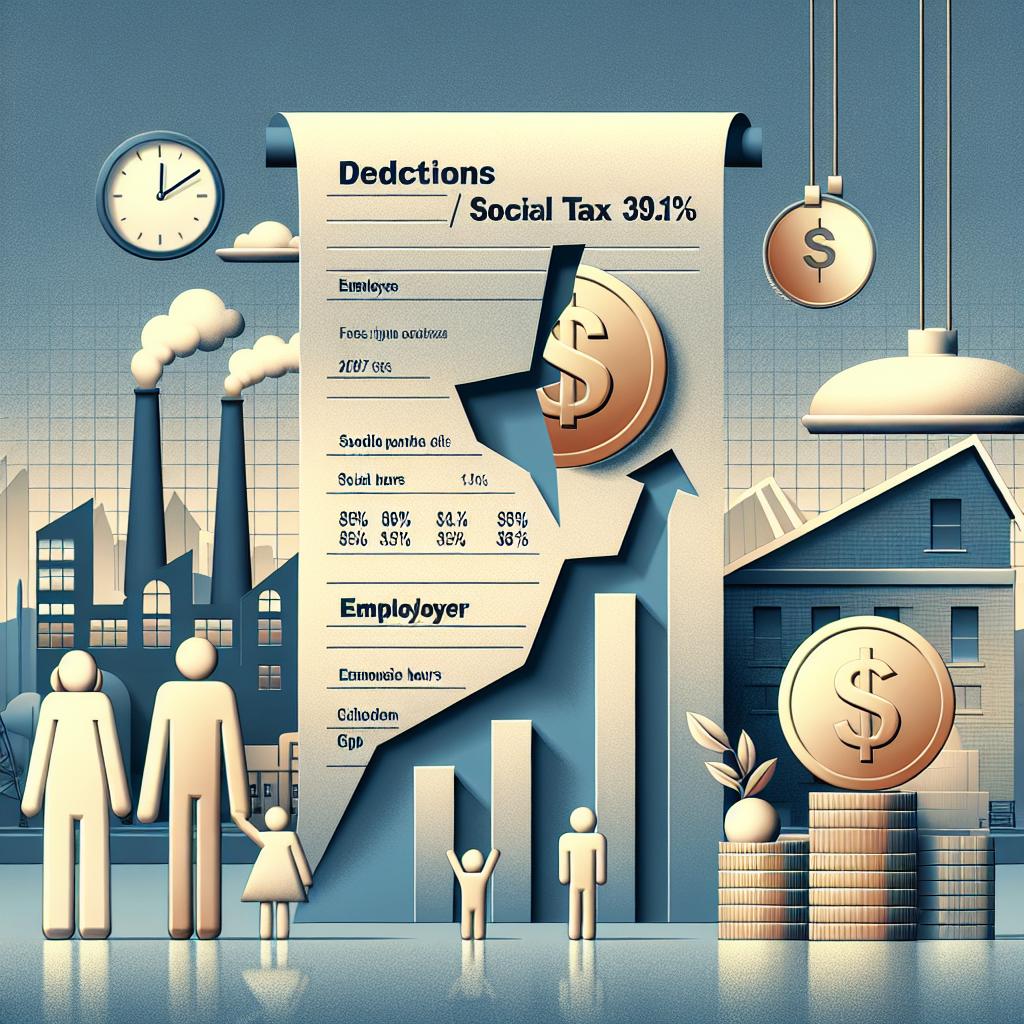La question de la décarbonation du transport aérien revient régulièrement dans le débat public. Au sein de l’Union européenne, l’intervention politique s’inscrit dans le cadre du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : l’UE partage la compétence en matière de transports avec les États membres et intervient lorsque les enjeux dépassent le seul périmètre national.
Historiquement centrée sur la construction du marché intérieur et la libre circulation, la politique européenne des transports intègre désormais la protection de l’environnement au cœur de ses décisions. Dans ce contexte, l’aviation fait l’objet d’objectifs et de règles visant à réduire les émissions tout en préservant l’équité concurrentielle sur le marché.
Le règlement ReFuelEU Aviation et ses objectifs
Adopté en 2023, le règlement ReFuelEU Aviation impose une feuille de route contraignante pour l’introduction progressive de carburants d’aviation durables (SAF) sur les aires de service européennes. Depuis le 1er janvier 2025, les fournisseurs desservant des aéroports de l’Union doivent intégrer au minimum 2 % de SAF dans le carburant mis à disposition.
Ces exigences augmentent ensuite : 6 % en 2030 puis, à horizon 2050, 70 % de SAF. Le texte fixe également une part minimale d’e‑kérosène (carburant synthétique produit à partir d’électricité renouvelable et de CO2 capté) : 1,2 % en 2030 puis 35 % en 2050.
L’objectif global affiché par les institutions européennes consiste à réduire les émissions nettes du secteur aérien de 55 % d’ici 2030, puis de 65 à 70 % d’ici 2050, par rapport à un scénario sans mesures.
Quelles filières pour remplacer le kérosène ?
Les SAF sont conçus pour être des « drop‑in » : ils remplacent le kérosène sans modification technique des avions et peuvent être mélangés au carburant fossile actuel, jusqu’à 50 % dans certains cas. Deux voies dominent aujourd’hui.
La première, déjà opérationnelle, repose sur les biocarburants de deuxième génération fabriqués à partir de résidus agricoles (colza, tournesol, betteraves, canne à sucre), d’huiles de cuisson usagées ou de graisses animales. Ces filières présentent un impact climatique très variable selon l’origine et les modes de production.
La seconde voie, l’e‑kérosène, est encore marginale : il est produit par synthèse à partir d’électricité renouvelable et de dioxyde de carbone capté. Ce procédé apparaît prometteur à condition d’utiliser exclusivement de l’électricité renouvelable, mais il reste actuellement très coûteux et éloigné d’une production industrielle de masse.
Une étude de Transport & Environment (T&E) publiée en janvier 2024 recensait 45 projets d’e‑kérosène dans l’Espace économique européen (EEE) : 25 projets industriels et 20 projets pilotes. Les 25 projets industriels viseraient 1,7 million de tonnes d’e‑kérosène à l’horizon 2030, soit plus que les quelque 600 000 tonnes exigées par ReFuelEU. Selon la même étude, une telle production permettrait d’alimenter environ 7 000 vols Paris–New York et d’éviter 4,6 millions de tonnes de CO2. Toutefois, à ce stade aucun projet n’a encore franchi l’étape décisive d’investissement et de lancement des travaux.
Freins économiques, industriels et structurels
Le coût et la disponibilité du SAF sont au centre des préoccupations des compagnies. D’après des données de l’IATA citées dans le texte, le SAF coûte entre deux et cinq fois plus cher que le kérosène fossile. Ce surcoût est difficile à absorber par des transporteurs compétitifs aux marges souvent limitées et peut se traduire par une hausse du prix des billets.
La production mondiale reste aujourd’hui très faible : en 2024, elle ne représentait que 0,53 % de la consommation de carburant d’aviation, contre 0,2 % en 2023, selon l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Pour atteindre les objectifs de 2030, la production actuelle devrait être multipliée par dix en l’espace de quelques années.
La montée en puissance bute aussi sur des tensions sur les ressources énergétiques et les matières premières (électricité renouvelable, huiles usagées, biomasse). Le marché naissant expose les compagnies à des contrats courts et au risque d’engagements longs avec des fournisseurs peu connus, ce qui explique la prudence de certains acteurs.
Politiques nationales et leviers complémentaires
La France a, par exemple, adopté une feuille de route nationale (CAD) dès 2020, avec des objectifs de substitution repris ensuite par ReFuelEU : 2 % en 2025 et 5 % en 2030. Des mesures fiscales incitatives ont aussi été mises en place, comme la taxe incitative sur les énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT) en 2022, qui a renforcé la dynamique nationale et favorisé la création d’outils numériques de traçabilité.
Pour la Commission européenne, les SAF constituent aujourd’hui la solution la plus avancée et immédiatement disponible pour réduire les émissions sur les vols moyen et long‑courrier. Mais ils ne suffiront pas seuls : la décarbonation exigera aussi d’améliorer l’efficacité énergétique des avions, d’instaurer une fiscalité du carburant plus équitable, de renforcer le recours au train à grande vitesse et de limiter certains trajets très polluants, comme les courts‑courriers et les jets privés.
Le 16 juillet 2025, Willie Walsh, directeur général de l’IATA, a appelé l’Union européenne à « réévaluer » ses objectifs de décarbonation en invitant à d’abord vérifier la capacité de production réelle des carburants verts avant de fixer des cibles contraignantes.
En conclusion, les carburants durables sont une pièce maîtresse de la transition du secteur aérien européen, mais pas l’unique solution. Leur déploiement nécessite des innovations technologiques, des investissements massifs et des choix collectifs qui associent régulation, soutien public et adaptation du marché.