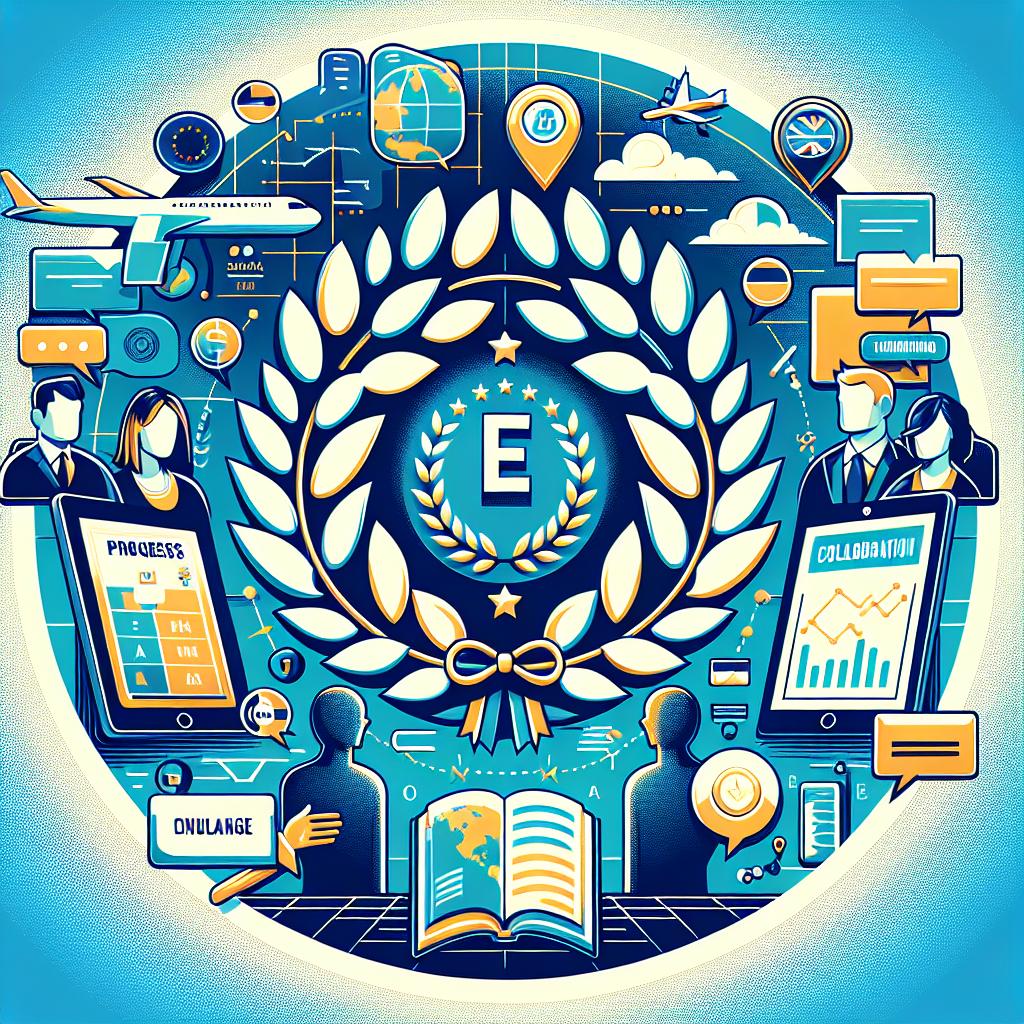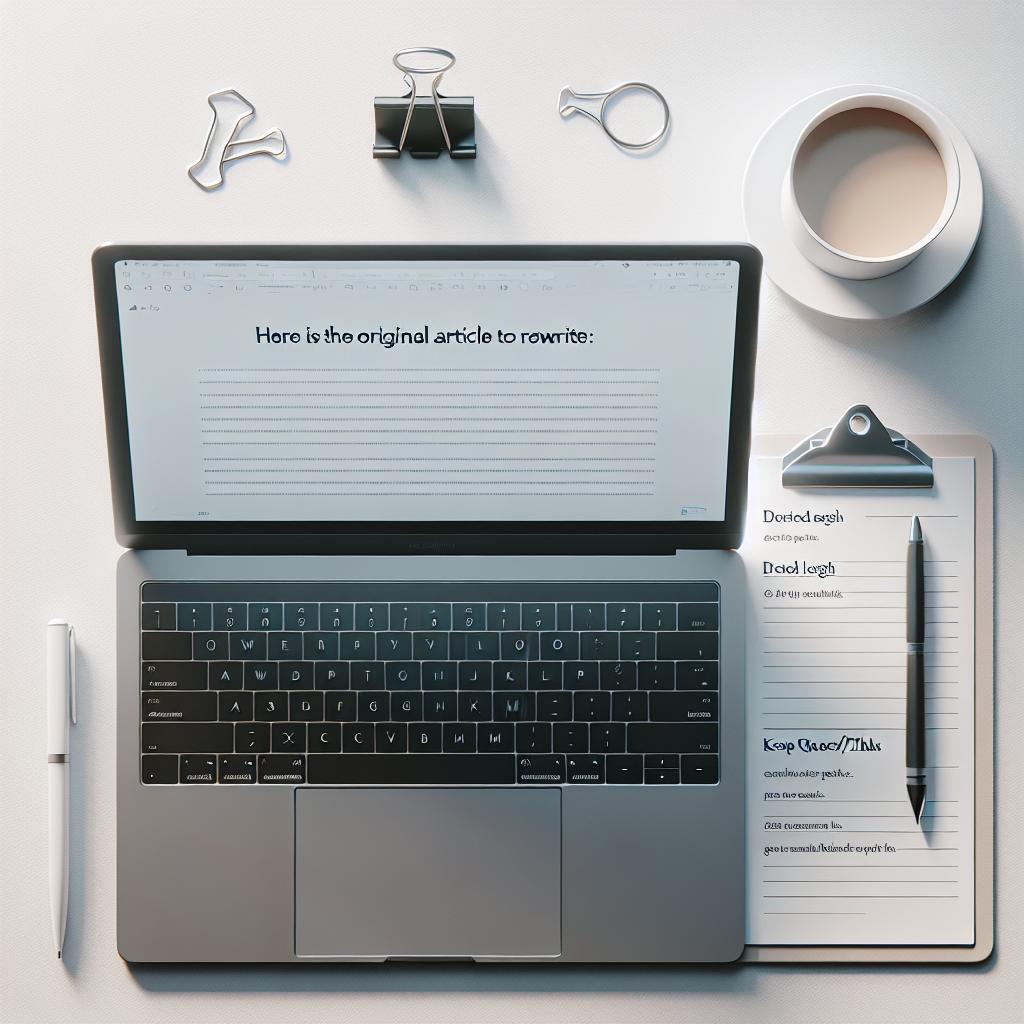Tous les cinq ans, l’Agence européenne de l’environnement (AEE) publie son rapport sur l’état de l’environnement en Europe. Celui dévoilé le 29 septembre 2025 dresse un tableau préoccupant : quelque 81 % des habitats protégés sont en « mauvais ou très mauvais état », tandis que 60 à 70 % des sols sont dégradés.
« Ce rapport nous rappelle avec force que l’Europe doit maintenir le cap et même accélérer ses ambitions en matière de climat et d’environnement », a commenté la vice-présidente de la Commission européenne Teresa Ribera, responsable de la Transition propre, juste et compétitive.
Pressions sur la biodiversité et la ressource en eau
L’AEE met en avant une biodiversité sous pression, et identifie la ressource en eau comme particulièrement menacée. Selon le rapport, le stress hydrique affecte 30 % du territoire européen et 34 % de la population.
L’agriculture apparaît comme la source de pression la plus importante sur les eaux de surface et souterraines. Le ruissellement des engrais et des pesticides, note le rapport, « dégrade la qualité de l’eau, favorise la croissance excessive d’algues, appauvrit les niveaux d’oxygène et entraîne la perte de la vie aquatique ».
Climat : impacts humains, économiques et progrès contrastés
Sur le plan climatique, l’AEE rappelle que le changement climatique frappe l’Europe deux fois plus vite que la moyenne mondiale et que ses effets se traduisent déjà par une multiplication des catastrophes naturelles. Entre 1980 et 2023, les événements extrêmes (canicules, inondations, feux de forêt, glissements de terrain) ont causé plus de 240 000 morts sur le continent. Rien qu’en 2022, plus de 70 000 décès ont été attribués aux vagues de chaleur.
Le coût économique est lui aussi élevé : depuis 1980, les pertes liées aux catastrophes climatiques atteignent 738 milliards d’euros dans l’Union européenne, dont 162 milliards pour la période 2021-2023. À titre d’exemple, les inondations ont coûté 16 % du PIB à la Slovénie en 2023, un niveau qualifié d’exceptionnel par le rapport.
Dans le cadre de l’Accord de Paris signé en 2015, les signataires, dont l’Union européenne, se sont engagés à respecter des objectifs communs fondés sur les rapports scientifiques, notamment ceux du GIEC. L’AEE souligne que ces engagements ont produit des progrès réels mais encore insuffisants.
L’agence rappelle des avancées notables : conformément aux objectifs du Pacte vert, les émissions de CO2 des Vingt-Sept devaient baisser de 55 % en 2030 (par rapport à 1990). En 2023, ces émissions avaient déjà reculé de 37 % et, d’après l’AEE, les actions engagées devraient permettre d’approcher cet objectif.
Entre 2005 et 2023, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale a doublé pour atteindre 24 %, et les émissions carbonées du secteur concerné ont été réduites de moitié. L’industrie et le bâtiment ont également contribué à ces baisses.
Cependant, les transports et l’agriculture restent des points faibles : leurs émissions n’ont reculé que de 6 % et 7 % respectivement sur la période 2005-2023.
Santé publique et urgence d’agir
Sur le plan sanitaire, les politiques européennes ont permis de réduire de 45 % les décès liés aux particules fines entre 2005 et 2022. Malgré cela, l’AEE rappelle qu' »10 % des morts prématurées en Europe sont encore dues à l’exposition à la pollution de l’air, de l’eau et des sols, au bruit et aux produits chimiques nocifs ».
L’agence insiste sur l’urgence d’une mise en œuvre renforcée des politiques environnementales existantes. Catherine Ganzleben, chargée des Transitions durables et équitables à l’AEE, souligne : « La survie de l’humanité dépend d’une nature de haute qualité. »
Teresa Ribera a insisté sur la dimension stratégique et économique de la protection de la nature : « La protection de la nature n’est pas un coût. Il s’agit d’un investissement dans la compétitivité, la résilience et le bien‑être des citoyens européens. »
Le rapport intervient à un moment charnière, alors que des facteurs géopolitiques et économiques — cités par l’AEE — recentrent parfois l’attention politique : la guerre en Ukraine, le retour de figures politiques internationales et la concurrence mondiale sont mentionnés comme des éléments susceptibles de ralentir ou de modifier les priorités nationales et européennes.
Selon l’AEE, plus l’action sera retardée, plus les coûts humains, économiques et sociaux s’alourdiront. Reste désormais à traduire ce constat et ces engagements en actes concrets, face à des défis multiples et à un horizon qui, pour l’agence, nécessite des décisions rapides et ambitieuses.