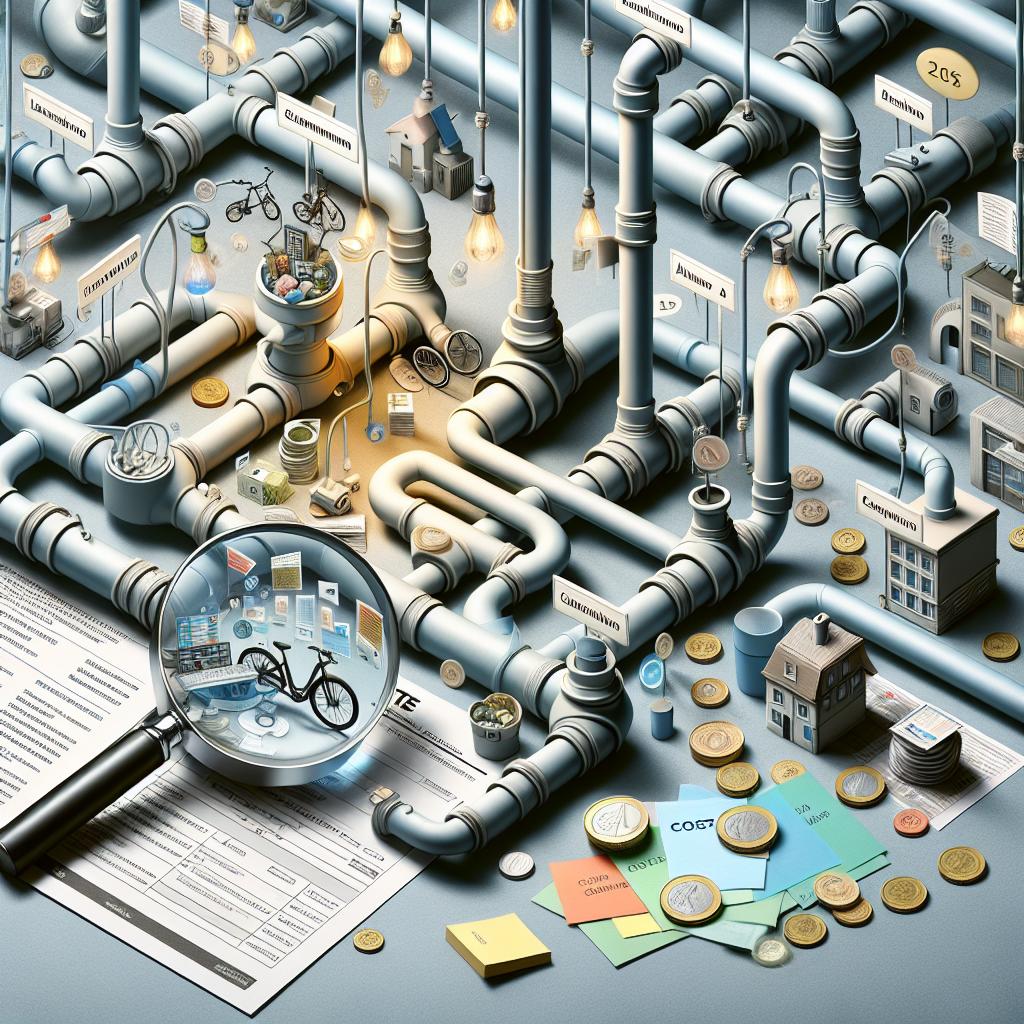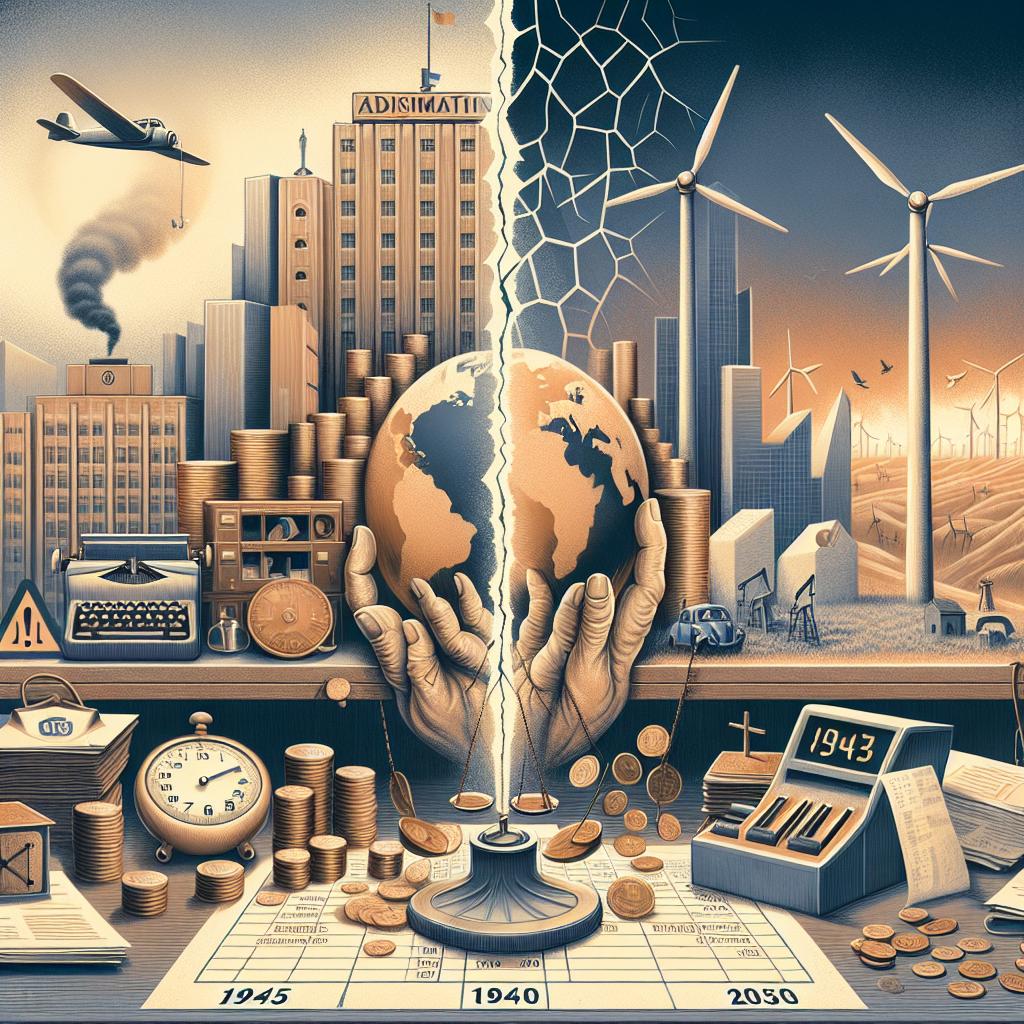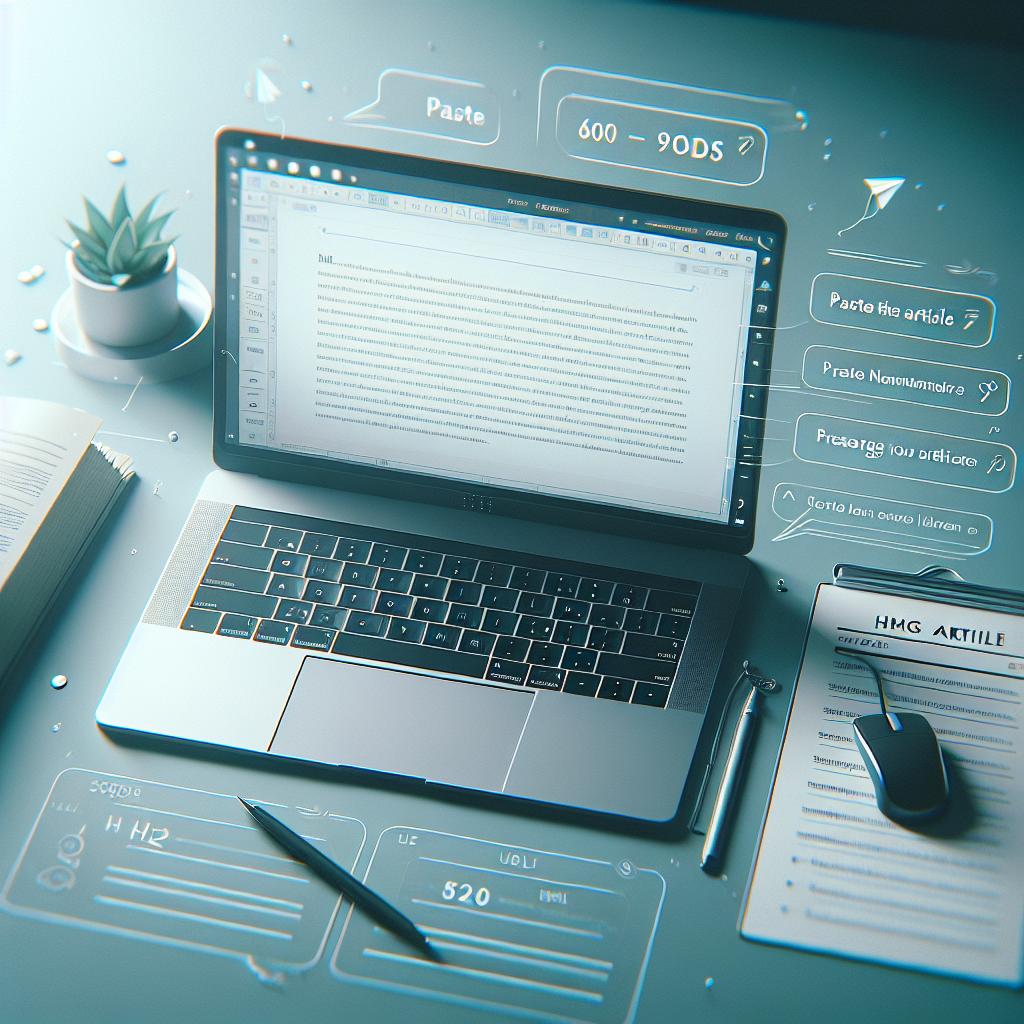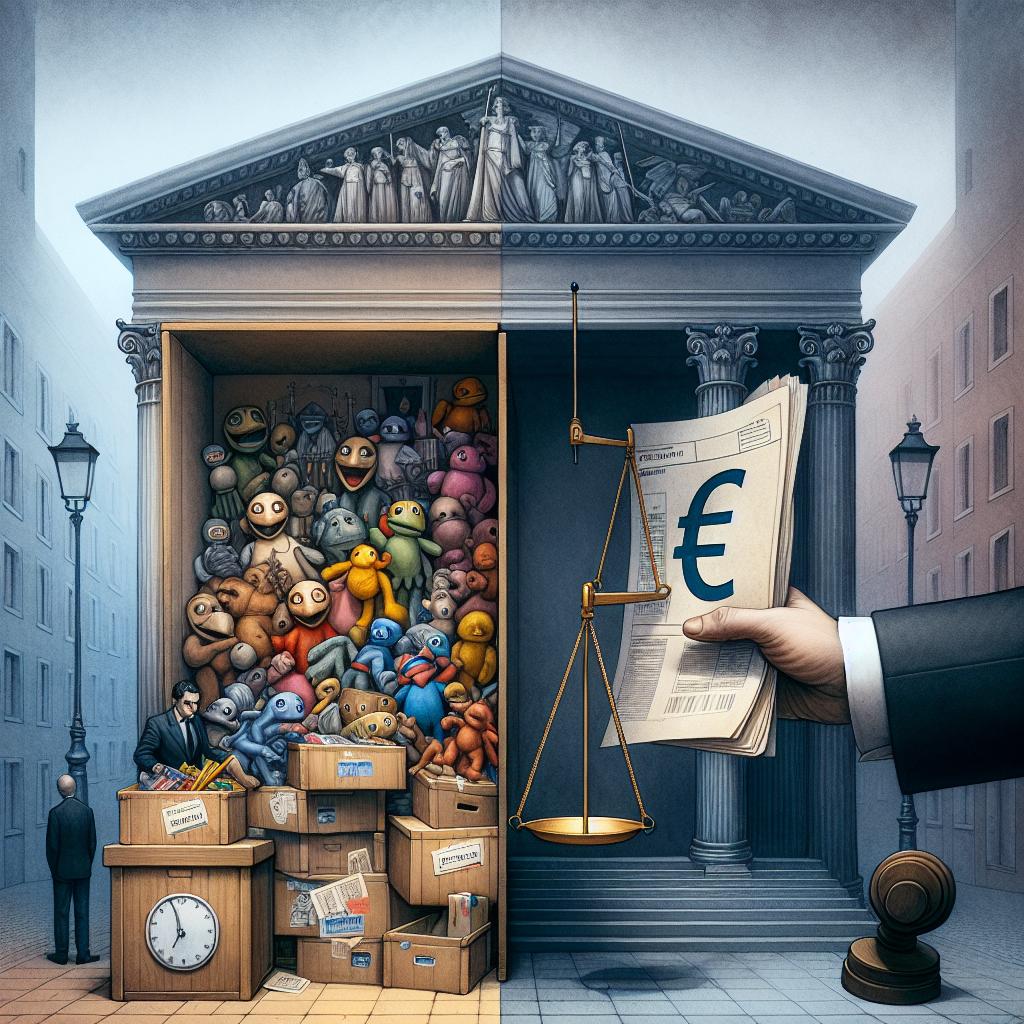La réélection de Donald Trump suscite, au-delà des félicitations diplomatiques, une vive inquiétude chez de nombreux responsables européens. Certains dirigeants — Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Olaf Scholz — ont certes salué la victoire, mais l’issue du scrutin du 5 novembre 2024 place l’Union européenne devant une série de défis commerciaux, géopolitiques et climatiques potentiellement majeurs pour le continent.
Un bras de fer commercial et tarifaire aux multiples rebonds
Les relations commerciales transatlantiques ont connu une succession de mesures, de menaces et de revirements depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain a instauré le 10 février 2025 une taxe de 25 % sur l’acier et l’aluminium, entrée en vigueur le 12 mars, puis a signé un décret le 3 juin doublant ces droits à 50 % sur les importations d’acier et d’aluminium — y compris celles provenant de l’Union européenne, selon le texte cité.
Parallèlement, l’administration a évoqué en avril l’instauration de droits « réciproques » à 20 % ou plus sur certains produits européens, et Donald Trump a même évoqué un prétendu déficit commercial de 300 milliards de dollars avec le « Vieux Continent ». Sur les chiffres vérifiables, la Commission européenne indique un déficit (en biens) de 158 milliards d’euros en 2023, montant qui aurait dépassé 183 milliards d’euros fin novembre 2024.
Face à ces annonces, Bruxelles a multiplié les ripostes et les menaces de contre‑mesures. Le 27 juillet, un accord commercial a été conclu prévoyant que les exportations européennes seraient majoritairement taxées à hauteur de 15 % ; l’Union a ensuite conditionné l’application de sanctions à l’échec des négociations, chiffrant des mesures de représailles à 93 milliards d’euros et envisageant une mise en œuvre le 7 août en cas d’impasse.
Plusieurs produits stratégiques ont été explicitement exclus ou ciblés au cours des échanges : équipements aéronautiques, semi‑conducteurs, matières premières critiques, ainsi qu’une série de produits agricoles, chimiques et cosmétiques. Le 24 juillet, l’Union européenne a finalement annoncé une nouvelle série de mesures de représailles chiffrées à 93 milliards d’euros, à activer en cas d’échec des négociations.
Sur le plan procédural, un porte‑parole de l’exécutif européen, Olof Gill, a déclaré que « la Commission a adopté aujourd’hui la procédure juridique nécessaire pour suspendre la mise en œuvre de nos contremesures européennes », marquant la volonté de Bruxelles de maintenir ouvertes les voies du dialogue tout en conservant des leviers juridiques.
Sécurité, industrie de défense et relation avec l’OTAN
L’alternance politique à Washington a poussé l’UE à renforcer ses ambitions en matière de sécurité. Le 4 mars, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a présenté un plan — initialement baptisé « ReArm Europe », désormais appelé « Readiness2030 » — visant à rendre l’Europe « plus sûre et résiliente ». Ce projet prévoit, selon le texte, une enveloppe de près de 800 milliards d’euros à mobiliser sur cinq ans pour moderniser les capacités militaires des Vingt‑Sept.
Un volet majeur du financement consiste en la création d’un instrument de prêt de 150 milliards d’euros, nommé « SAFE », destiné à aider les États membres à acquérir des équipements militaires européens et à renforcer l’interopérabilité.
Sur le front de l’OTAN, Donald Trump a de nouveau mis la pression pour que les alliés accroissent leurs dépenses : il a demandé que les membres consacrent jusqu’à 5 % de leur PIB — objectif jugé irréaliste par beaucoup — tandis que le compromis issu du sommet de La Haye du 26 juin 2025 prévoit une montée progressive vers 5 % d’ici 2035, avec 1,5 % dédiés à la sécurité nationale. La Pologne a déjà dépassé largement l’objectif en 2024, avec un niveau de dépenses de 4,1 % du PIB.
Sur le plan économique bilatéral, la relation reste dense : selon le Trésor français, les échanges de biens et services entre la France et les États‑Unis ont atteint 153,1 milliards de dollars en 2023, et la France demeure un investisseur majeur outre‑Atlantique.
Ukraine, matières premières et diplomatie à géométrie variable
L’avenir de l’aide américaine à l’Ukraine et les négociations avec la Russie figurent parmi les sujets qui inquiètent le plus les Européens. Le milliardaire (Donald Trump) a, selon le récit, joué de l’instrument de l’aide militaire comme levier de pression, suspendant temporairement des livraisons pour obtenir des concessions et négocier des cessez‑le‑feu partiels. Ces décisions ont alimenté des tensions, notamment lors d’une rencontre houleuse à la Maison‑Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 28 février.
Le dossier des minerais stratégiques présents en Ukraine, dont une partie se situe en zones occupées, est également au cœur des discussions : Washington a cherché des accords pour accéder à ces ressources, mais la négociation reste difficile et incertaine.
Climat et régulation numérique : points de friction supplémentaires
La politique climatique américaine annoncée par Donald Trump indique une priorité au développement des énergies fossiles — forage, pipelines — et un retour sur certaines normes antipollution dans l’automobile. Le 11 novembre 2024, le président élu a désigné Lee Zeldin à la tête de l’EPA ; sur X, Zeldin a indiqué vouloir « rétablir la domination énergétique américaine, revitaliser l’industrie automobile » et faire des États‑Unis un leader mondial de l’intelligence artificielle.
Bruxelles a réaffirmé son attachement à l’Accord de Paris : Ursula von der Leyen a rappelé que « l’Accord de Paris demeure le meilleur espoir de l’humanité tout entière ». Sur le numérique, l’Union a renforcé la modération et limité la domination des géants du web avec le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), provoquant des critiques et, selon des médias, des réactions publiques d’acteurs américains — dont Mark Zuckerberg.
Conclusion
Entre dialogues, menaces tarifaires, préparation militaire renforcée et désaccords sur le climat et le numérique, la relation UE‑États‑Unis entre dans une phase d’incertitude accrue. Bruxelles conjugue aujourd’hui coopération stratégique et préparation à des mesures de riposte, tout en laissant ouvertes les voies juridiques et diplomatiques pour désamorcer un conflit commercial et préserver les intérêts économiques et sécuritaires européens.