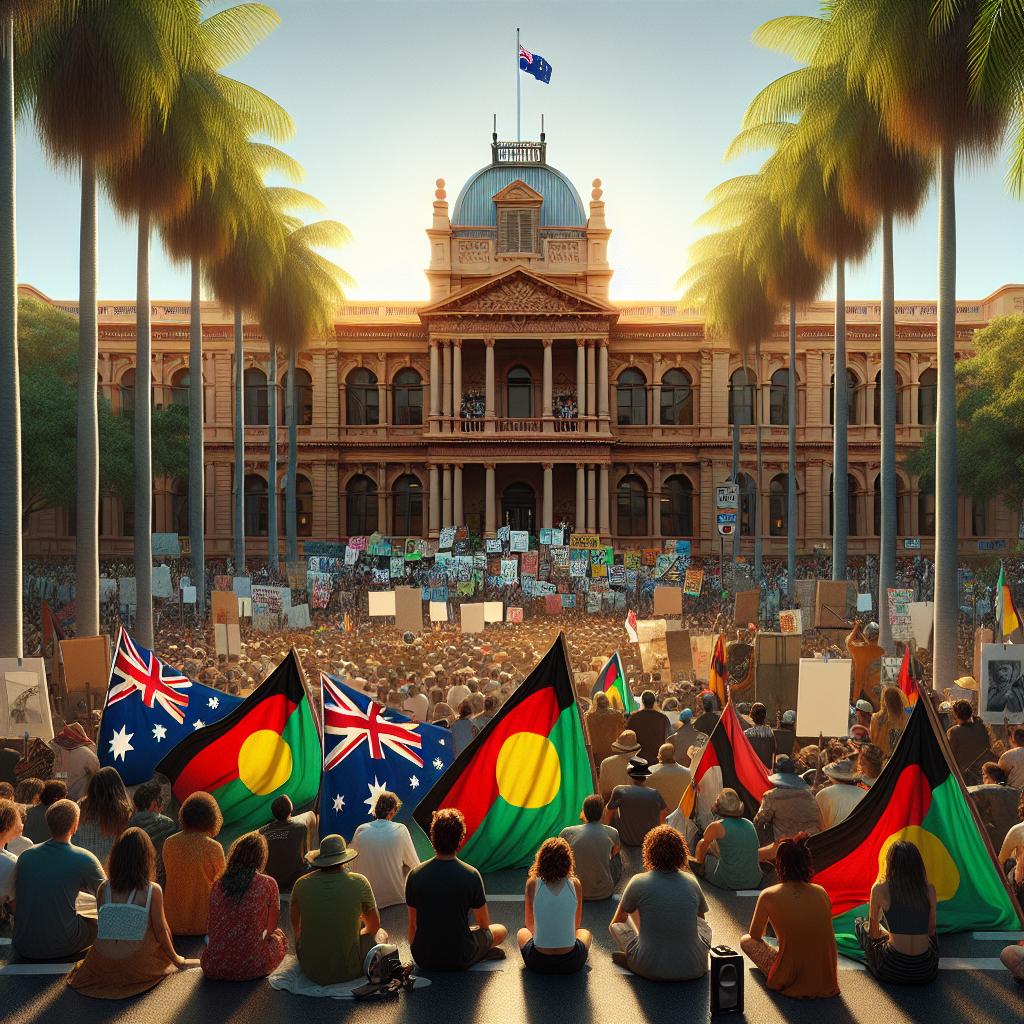Le 16 juillet, la Commission européenne a présenté ses propositions pour le prochain cadre financier pluriannuel 2028–2034. Présenté par ses auteurs comme une démarche de « simplification », ce texte modifie profondément l’organisation des instruments de financement européens et pose d’importantes questions pour les régions ultrapériphériques (RUP) françaises : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint‑Martin.
La proposition : un instrument national unique
La Commission propose de regrouper plusieurs politiques sectorielles — politique de cohésion, politique agricole commune (PAC) et politique de la pêche — au sein d’un instrument national baptisé « plans de partenariat ». Concrètement, les lignes budgétaires distinctes qui existent aujourd’hui seraient remplacées par des enveloppes gérées au niveau national et déclinées ensuite par État membre.
Selon le texte initial, ce changement doit permettre de réduire la complexité administrative et d’aligner les financements sur des priorités nationales. Dans la pratique, il introduit une logique de programmation nationale qui atténue la visibilité et la garantie de financements dédiés aux territoires bénéficiant aujourd’hui de dispositifs spécifiques.
Que devient l’article 349 TFUE et les dispositifs spécifiques ?
L’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) reconnaît formellement les contraintes structurelles des RUP — insularité, éloignement, vulnérabilité économique — et a servi de base juridique pour des dispositifs compensatoires. Le projet de la Commission est perçu par certains acteurs comme susceptible de « vider de sa substance » cette reconnaissance en supprimant les lignes budgétaires ciblées.
Plusieurs mécanismes ciblés seraient concernés : le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) pour l’agriculture, les plans de compensation spécifiques à la pêche, les allocations issues du Fonds européen de développement régional (FEDER) en faveur des RUP et le cofinancement majoré qui augmente la part financée par l’Union pour ces régions.
Impacts budgétaires chiffrés
Les chiffres repris dans le texte de la Commission laissent apparaître un resserrement notable des moyens. Selon les projections mentionnées, la France recevrait 3,7 milliards d’euros pour l’ensemble de ses régions « les moins développées » sur la période 2028–2034, contre 3,45 milliards d’euros pour les seules RUP sur la période actuelle.
La Commission indique en outre que cette enveloppe serait partagée entre trois régions métropolitaines — Limousin, Picardie, Lorraine (soit environ six millions d’habitants) — et les RUP françaises (environ deux millions d’habitants). Dans la lecture qui en est faite par les représentants des outre‑mer, cela se traduit par une baisse substantielle des moyens spécifiquement affectés aux territoires ultramarins.
Conséquences et incertitudes
Si les propositions étaient adoptées en l’état, les RUP perdraient l’assurance de bénéficier de financements contractualisés et ciblés pour compenser leurs handicaps structurels. La disparition des lignes budgétaires dédiées rendrait plus incertain le niveau et la nature des aides disponibles pour l’agriculture, la pêche et les investissements régionaux.
Le passage à des « plans de partenariat » nationaux déplace par ailleurs une partie des arbitrages au niveau des États membres, ce qui modifie la relation directe entre l’Union et les territoires ultramarins. Le document de la Commission met en avant une simplification administrative ; les opposants y voient, eux, une renationalisation des politiques européennes.
Le calendrier, les modalités précises de transition et les compensations éventuelles restent à préciser au fil des négociations entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Le texte présenté le 16 juillet ouvre une phase de débats qui déterminera l’ampleur des changements et leurs effets concrets pour les régions ultrapériphériques françaises.