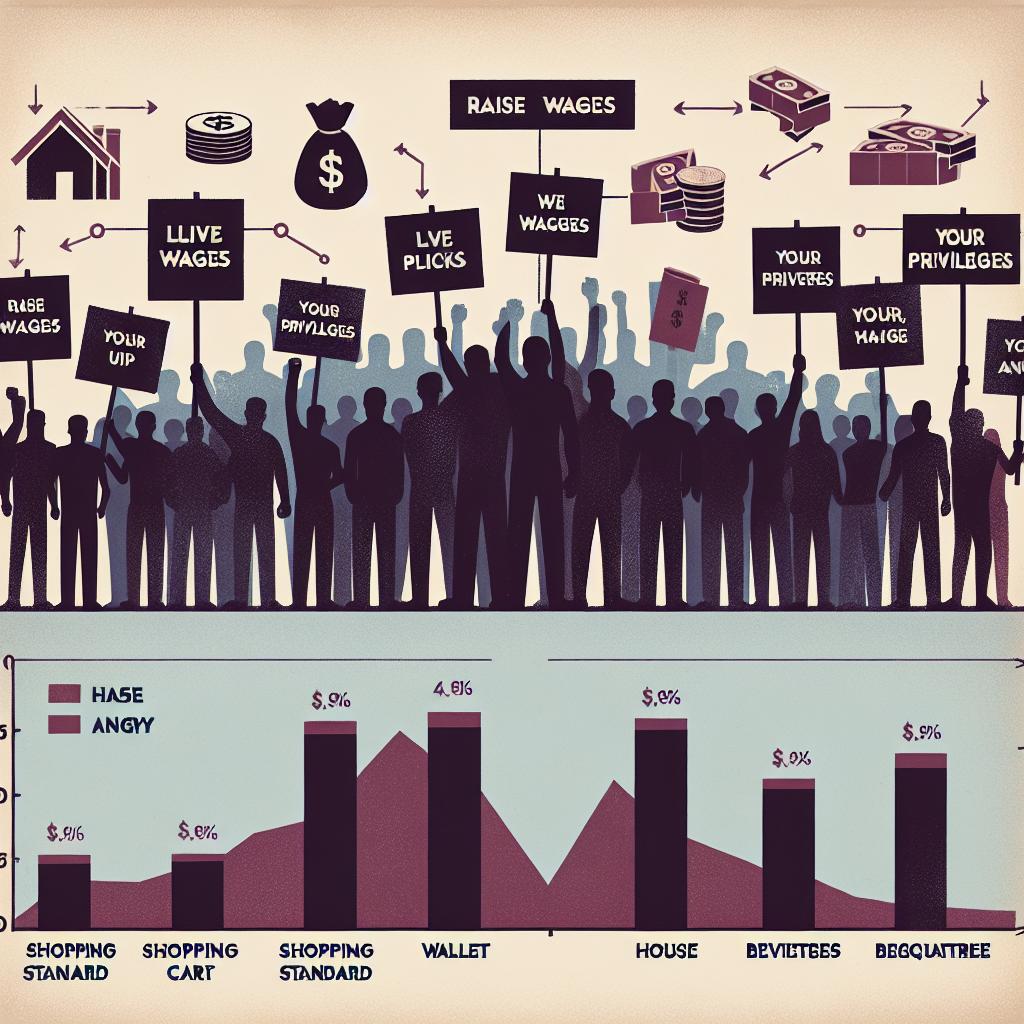Un débat remis sur la table
La « taxe Zucman » relance le clivage traditionnel entre droite et gauche sur la fiscalité du patrimoine, écrivent les auteurs de cette tribune commune. Ceux-ci rappellent avoir occupé, l’un comme président et l’autre comme rapporteure générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale, une position visant à éclairer les choix publics à partir de données précises — parfois difficiles à obtenir auprès des gouvernements. C’est dans cet esprit qu’ils signent aujourd’hui leur intervention.
Évolution historique des impôts sur la fortune
Depuis les années 1980, l’imposition du patrimoine français a connu plusieurs transformations. L’impôt sur les grandes fortunes (IGF) de 1982 a laissé la place, après plusieurs réformes, à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) puis, plus récemment, à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). À travers ces changements, deux principes récurrents se dégagent : l’exonération des outils professionnels et la fixation d’un taux d’impôt susceptible d’être supporté par les revenus du patrimoine sans obliger à la liquidation des actifs.
Dès la création de l’IGF en 1982, l’exonération de l’actif professionnel s’est imposée, même si sa délimitation n’a jamais été totalement tranchée. En 1988, le rétablissement de l’ISF sous le gouvernement de Michel Rocard a introduit un mécanisme de plafonnement destiné à limiter la charge fiscale : le total de l’ISF, de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée (CSG) ne devait pas dépasser 50 % du revenu personnel annuel.
Les limites du plafonnement et les réponses législatives
La mise en œuvre de ce plafonnement a soulevé une question centrale : comment définir le « revenu personnel » lorsque les dirigeants et détenteurs d’entreprises disposent d’une grande latitude dans la gestion et la mise en valeur de leurs revenus ? Face à des pratiques d’optimisation fiscale, le législateur a réagi. En 1995, un « plafonnement du plafonnement » a été instauré pour contrer certaines échappatoires, mesure qui a été maintenue par Philippe Seguin lors de son mandat à la présidence de l’Assemblée nationale malgré des pressions politiques.
Ces étapes illustrent la difficulté récurrente des gouvernements à conjurer les montages fiscaux qui cherchent à réduire l’assiette ou le montant effectif de l’impôt, tout en respectant les principes posés lors des réformes antérieures.
Le pacte Dutreil et l’exonération de l’actif professionnel
À partir de 2003, le périmètre des actifs professionnels exonérés s’est élargi avec l’entrée en vigueur du pacte Dutreil. Conçu pour préserver la transmission et l’intégrité du capital des entreprises familiales patrimoniales, notamment les entreprises de taille intermédiaire, ce dispositif propose une exonération partielle en contrepartie d’engagements de conservation des titres.
Concrètement, des actionnaires familiaux qui s’engagent à conserver leurs titres pendant au moins six ans peuvent bénéficier d’une exonération équivalente à 75 % de la valeur de leurs actifs concernés. Ce mécanisme a favorisé la continuité des entreprises familiales entre générations, mais il a aussi généré des montages d’optimisation et des difficultés opérationnelles pour l’administration fiscale, notamment pour identifier et caractériser les « holdings animatrices » qui détiennent et animent des titres.
Des règles aux limites opérationnelles
Le fil conducteur de ces évolutions est double : protéger l’outil professionnel et calibrer la charge fiscale pour qu’elle reste supportable par les revenus du patrimoine. En pratique, ces objectifs rencontrent des limites techniques et juridiques. La définition juridique des actifs professionnels exonérés, la qualification des structures de détention et la mesure des revenus personnels sont restées des zones d’incertitude et d’intervention administrative régulière.
Les auteurs de la tribune insistent sur la nécessité d’appuyer les choix publics sur des données fiables et complètes. Ils soulignent implicitement que l’absence ou la difficulté d’accès à certaines informations a, par le passé, compliqué l’évaluation des effets réels des dispositifs et des réformes fiscales.
Sans proposer ici de nouvelle mesure détaillée, la tribune rappelle que toute réforme de la taxation du patrimoine doit composer avec des principes anciens — non taxation de l’outil professionnel et soutenabilité du paiement — tout en tenant compte des choix d’écriture fiscale et des pratiques d’optimisation qui ont façonné le paysage depuis 1982.